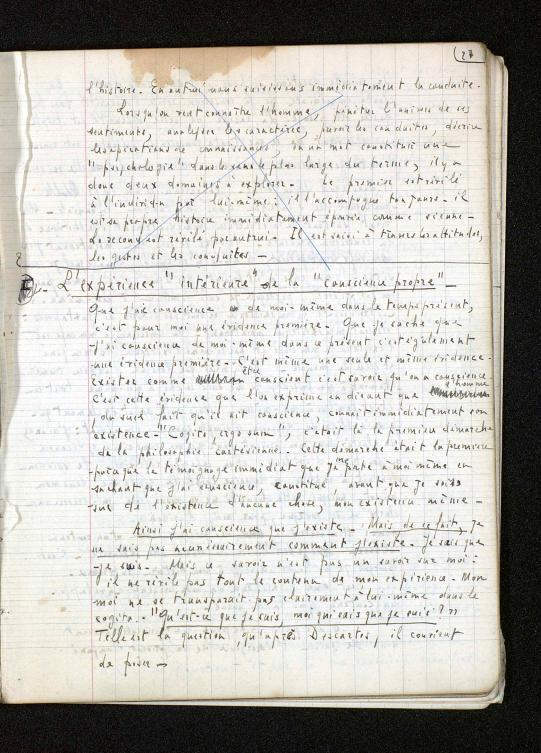 [0005]
[0005]
l’histoire. En autrui nous saisissons immédiatement la conduite. Lorsqu’on veut connaître
l’homme, pénétrer l’univers de ses sentiments, analyser les caractères, prévoir les conduites,
décrire les opérations de connaissance, en un mot constituer une “psychologie” dans le sens le
plus large du terme, il y a donc deux domaines à explorer. Le premier est révélé à l’individu
par lui-même: il l’accompagne toujours, il est sa propre histoire immédiatement éprouvée
comme sienne. Le second est révélé par autrui. Il est saisi à travers les attitudes, les gestes et
les conduites.
I
L’expérience "intérieure" de la "conscience propre"
Que j’aie conscience de moi-même dans le temps présent, c’est pour moi une évidence première. Que je sache que j’ai conscience de moi-même dans ce présent c’est également une évidence première. C’est même une seule et même évidence. Exister comme être conscient c’est savoir qu’on a conscience. C’est cette évidence que l’on exprime en disant que l’homme, du seul fait qu’il ait conscience, connaît immédiatement son existence. "Cogito, ergo sum", c’était là la première démarche de la philosophie cartésienne. Cette démarche était la première parce que le témoignage immédiat que je me porte à moi-même en sachant que j’ai conscience, constitue, avant que je sois sûr de l’existence d’aucune chose, mon existence même.
Ainsi j’ai conscience que j’existe. Mais de ce fait, je ne sais pas nécessairement comment j’existe. Je sais que je suis. Mais ce savoir n’est pas un savoir sur moi : il ne révèle pas tout le contenu de mon expérience. Mon moi ne se transparaît pas clairement à lui-même dans le cogito. "Qu’est-ce que je suis, moi qui sais que je suis ?". Telle est la question, qu’après Descartes, il convient de poser.
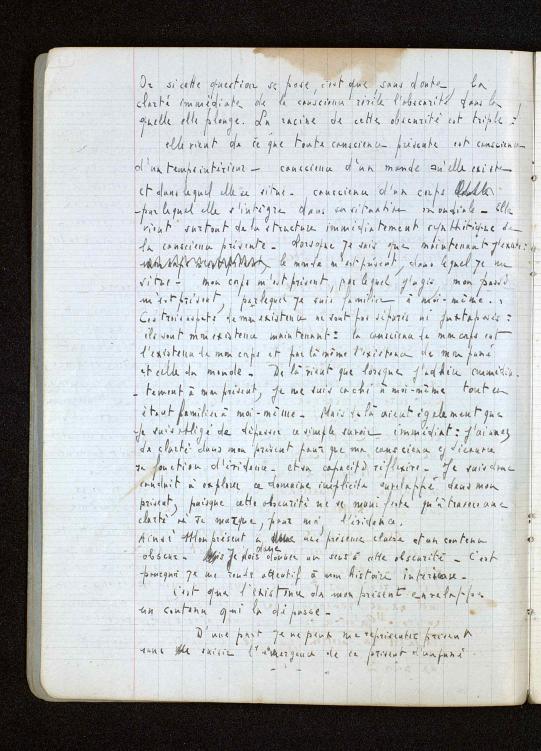 [0006]
Or si cette question se pose, c’est que, sans doute, la clarté immédiate de la conscience révèle
l’obscurité dans laquelle elle plonge. La racine de cette obscurité est triple : elle vient de ce
que toute conscience présente est conscience d’un temps intérieur, conscience d’un monde où
elle existe et dans lequel elle se situe, conscience d’un corps par lequel elle s’intègre dans sa
situation mondaine. Elle vient surtout de la structure immédiatement synthétique de la
conscience présente. Lorsque je sais que maintenant j’existe : le monde m’est présent, dans
lequel je me situe, mon corps m’est présent, par lequel j’agis, mon passé m’est présent, par
lequel je suis familier à moi-même. Ces trois aspects de mon existence ne sont pas séparés ni
juxtaposés : ils sont mon existence maintenant : la conscience de mon corps est l’existence de
mon corps et par là même l’existence de mon passé et celle du monde. De là vient que lorsque
j’adhère immédiatement à mon présent, je me suis caché à moi-même tout en étant familier à
moi-même. Mais de là vient également que je suis obligé de dépasser ce simple savoir
immédiat : j’ai assez de clarté dans mon présent pour que ma conscience y découvre sa
fonction d’évidence, et sa capacité réflexive. Je suis donc conduit à explorer ce domaine
implicite enveloppé dans mon présent, puisque cette obscurité ne se manifeste qu’à travers
une clarté où je marque, pour moi, l’évidence.
[0006]
Or si cette question se pose, c’est que, sans doute, la clarté immédiate de la conscience révèle
l’obscurité dans laquelle elle plonge. La racine de cette obscurité est triple : elle vient de ce
que toute conscience présente est conscience d’un temps intérieur, conscience d’un monde où
elle existe et dans lequel elle se situe, conscience d’un corps par lequel elle s’intègre dans sa
situation mondaine. Elle vient surtout de la structure immédiatement synthétique de la
conscience présente. Lorsque je sais que maintenant j’existe : le monde m’est présent, dans
lequel je me situe, mon corps m’est présent, par lequel j’agis, mon passé m’est présent, par
lequel je suis familier à moi-même. Ces trois aspects de mon existence ne sont pas séparés ni
juxtaposés : ils sont mon existence maintenant : la conscience de mon corps est l’existence de
mon corps et par là même l’existence de mon passé et celle du monde. De là vient que lorsque
j’adhère immédiatement à mon présent, je me suis caché à moi-même tout en étant familier à
moi-même. Mais de là vient également que je suis obligé de dépasser ce simple savoir
immédiat : j’ai assez de clarté dans mon présent pour que ma conscience y découvre sa
fonction d’évidence, et sa capacité réflexive. Je suis donc conduit à explorer ce domaine
implicite enveloppé dans mon présent, puisque cette obscurité ne se manifeste qu’à travers
une clarté où je marque, pour moi, l’évidence.
Ainsi mon présent a une présence claire et un contenu obscur. Je dois donc donner un sens à cette obscurité. C’est pourquoi je me rends attentif à mon histoire intérieure. C’est que l’existence de mon présent enveloppe un contenu qui la dépasse.
D’une part, je ne peux me représenter présent sans saisir l’émergence de ce présent
d’un passé
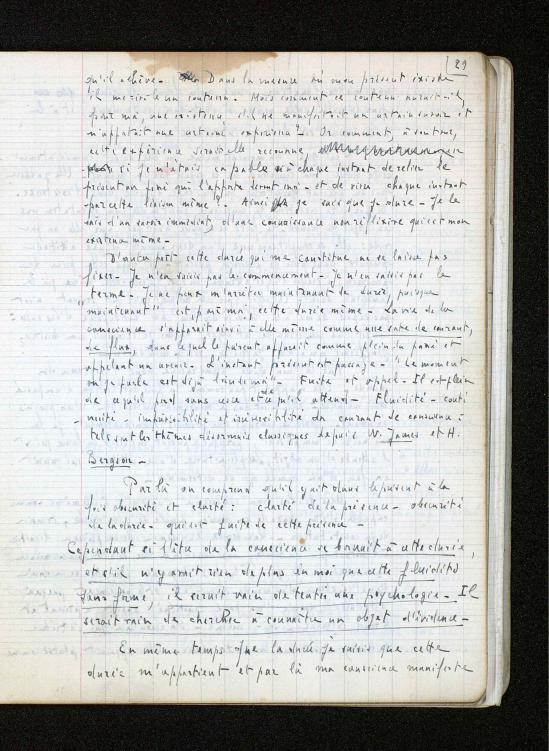 [0007]
qu’il achève. Dans la mesure où mon présent existe, il me révèle un contenu.
Mais comment ce contenu aurait-il pour moi, une existence, s’il ne manifestait un certain
savoir et n’apportait une certaine expérience ? Or comment, à son tour, cette expérience serait-
elle reconnue, si je n’étais capable à chaque instant de relier le présent au passé qui l’apporte
devant moi – et de vivre chaque instant par cette liaison même ? Ainsi je sais que je dure. Je le
sais d’un savoir immédiat, d’une connaissance non réflexive qui est mon existence même.
D’autre part cette durée qui me constitue ne se laisse pas fixer. Je n’en saisis pas le
commencement. Je n’en saisis pas le terme. Je ne peux m’arrêter maintenant de durer, puisque
"maintenant" est, pour moi, cette durée même. La vie de la conscience s’apparaît ainsi à elle-
même comme une sorte de courant de flux , dans lequel le présent apparaît comme plein du
passé et appelant un avenir. L’instant présent est passage. "Le moment où je parle est déjà
loin de moi". Fuite et appel. Il est plein de ce qu’il perd sans cesse et de ce qu’il attend.
Fluidité – continuité – imprévisibilité et irréversibilité du courant de conscience – tels sont les
thèmes désormais classiques depuis W. James et H. Bergson.
[0007]
qu’il achève. Dans la mesure où mon présent existe, il me révèle un contenu.
Mais comment ce contenu aurait-il pour moi, une existence, s’il ne manifestait un certain
savoir et n’apportait une certaine expérience ? Or comment, à son tour, cette expérience serait-
elle reconnue, si je n’étais capable à chaque instant de relier le présent au passé qui l’apporte
devant moi – et de vivre chaque instant par cette liaison même ? Ainsi je sais que je dure. Je le
sais d’un savoir immédiat, d’une connaissance non réflexive qui est mon existence même.
D’autre part cette durée qui me constitue ne se laisse pas fixer. Je n’en saisis pas le
commencement. Je n’en saisis pas le terme. Je ne peux m’arrêter maintenant de durer, puisque
"maintenant" est, pour moi, cette durée même. La vie de la conscience s’apparaît ainsi à elle-
même comme une sorte de courant de flux , dans lequel le présent apparaît comme plein du
passé et appelant un avenir. L’instant présent est passage. "Le moment où je parle est déjà
loin de moi". Fuite et appel. Il est plein de ce qu’il perd sans cesse et de ce qu’il attend.
Fluidité – continuité – imprévisibilité et irréversibilité du courant de conscience – tels sont les
thèmes désormais classiques depuis W. James et H. Bergson.
Par là on comprend qu’il y ait dans le présent à la fois obscurité et clarté : clarté de la présence – obscurité de la durée – qui est fuite de cette présence.
Cependant si l’être de la conscience se bornait à cette durée, et s’il n’y avait rien de plus en moi que cette fluidité sans forme, il serait vain de tenter une psychologie. Il serait vain de chercher à connaître un objet d’évidence.
En même temps que la durée je saisis que cette durée m’appartient et par là ma
conscience manifeste
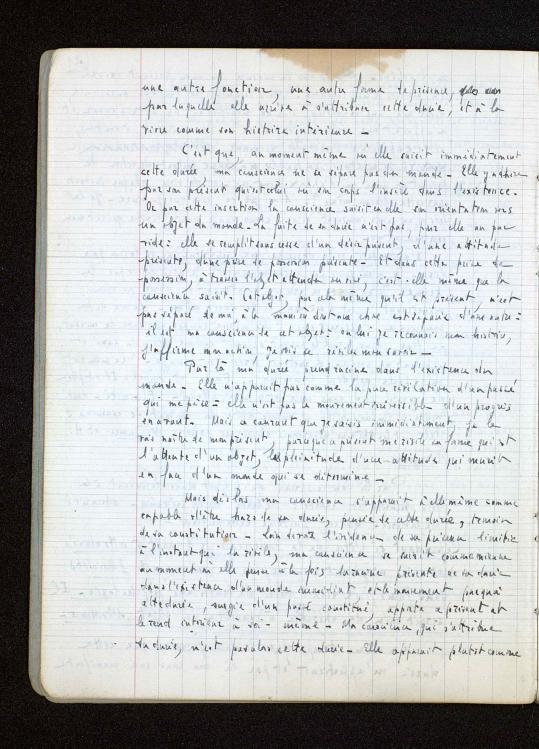 [0008]
une autre fonction, une autre forme de présence, par laquelle elle
arrive à s’attribuer cette durée, et à la vivre comme son histoire intérieure.
[0008]
une autre fonction, une autre forme de présence, par laquelle elle
arrive à s’attribuer cette durée, et à la vivre comme son histoire intérieure.
C’est que, au moment même où elle saisit immédiatement cette durée, ma conscience ne se sépare pas du monde. Elle y adhère par son présent qui est celui où son corps l’insère dans l’existence. Or, par cette insertion, la conscience saisit en elle son orientation vers un objet du monde. La fuite de sa durée n’est pas, pour elle un pur vide : elle se remplit sans cesse d’un désir présent, d’une attitude présente, d’une prise de possession présente. Et dans cette prise de possession, à travers l’objet attendu ou visé, c’est elle-même que la conscience saisit. Cet objet, par cela même qu’il est présent, n’est pas séparé de moi, à la manière dont une chose est séparée d’une autre : il est ma conscience de cet objet : en lui je reconnais mon histoire, j’affirme mon action, je vois se révéler mon savoir.
Par là ma durée prend racine dans l’existence du monde. Elle n’apparaît pas comme la pure révélation d’un passé qui me pèse : elle n’est pas le mouvement irréversible d’un progrès en avant. Mais ce courant que je saisis immédiatement, je le vois naître de mon présent, parce que ce présent me révèle sa forme qui est l’attente d’un objet, la plénitude d’une attitude qui mûrit en face d’un monde qui se détermine.
Mais dès lors ma conscience s’apparaît à elle-même comme capable d’être hors de sa
durée, pensée de cette durée, témoin de sa constitution. Loin de voir l’évidence de sa présence
limitée à l’instant qui la révèle, ma conscience se saisit comme mienne au moment où elle
pense à la fois la racine présente de sa durée dans l’existence d’un monde immédiat, et le
mouvement par quoi cette durée, surgie d’un passé constitué, apporte ce présent et le rend
intérieur à soi-même. Ma conscience, qui s’attribue sa durée, n’est pas alors cette durée. Elle
apparaît plutôt comme
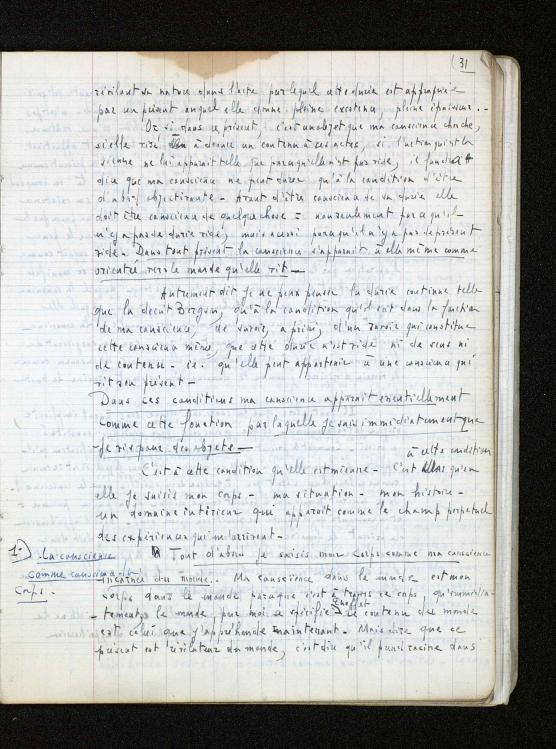 [0009]
révélant sa nature dans l’acte par lequel cette durée est
appropriée par un présent auquel elle donne pleine existence, pleine épaisseur.
[0009]
révélant sa nature dans l’acte par lequel cette durée est
appropriée par un présent auquel elle donne pleine existence, pleine épaisseur.
Or si dans ce présent, c’est un objet que ma conscience cherche, si elle vise à donner un contenu à ses actes, si l’action qui est la sienne ne lui apparaît telle que parce qu’elle n’est pas vide, il faudrait dire que ma conscience ne peut durer qu’à la condition d’être d’abord objectivante. Avant d’être conscience de sa durée elle doit être conscience de quelque chose : non seulement parce qu’il n’y a pas de durée vide, mais aussi parce qu’il n’y a pas de présent vide. Dans tout présent la conscience s’apparaît à elle-même comme orientée vers le monde qu’elle vit.
Autrement dit je ne peux penser la durée continue telle que la décrit Bergson, qu’à la condition qu’il soit dans la fonction de ma conscience, de savoir, a priori, d’un savoir qui constitue cette conscience même, que cette durée n’est vide ni de sens ni de contenu – i.e. qu’elle peut appartenir à une conscience qui vit son présent.
Dans ces conditions ma conscience apparaît essentiellement comme cette fonction par laquelle je sais immédiatement que je vis pour des objets.
C’est à cette condition qu’elle est mienne. C’est à cette condition qu’en elle je saisis mon corps – ma situation – mon histoire – un domaine intérieur qui apparaît comme le champ perpétuel des expériences qui m’arrivent.
1°) La conscience comme conscience du corps.
Tout d’abord je saisis mon corps comme ma conscience incarnée du monde. Ma conscience
dans le monde est mon corps dans le monde parce que c’est à travers ce corps,
qu’immédiatement, le monde, pour moi, se spécifie. En effet, le contenu du monde est celui
que j’appréhende maintenant. Mais dire que ce présent est révélateur du monde, c’est dire
qu’il prend racine dans
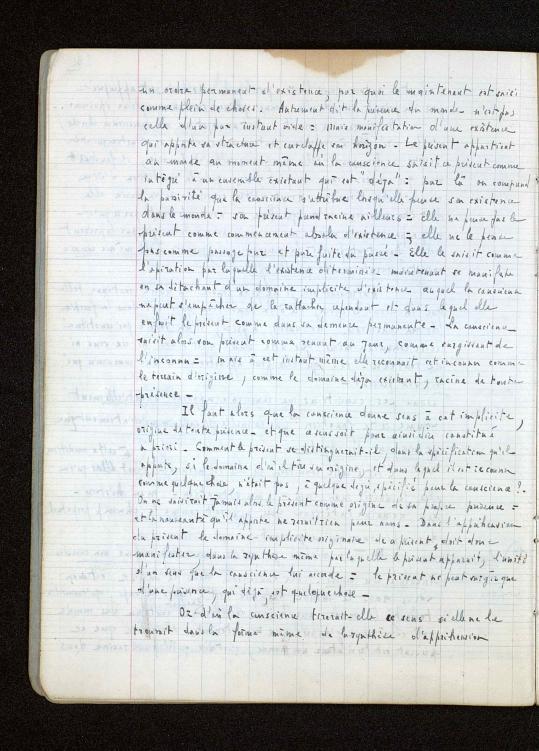 [0010]
un ordre permanent d’existence, par quoi le maintenant est saisi
comme plein de choses. Autrement dit la présence du monde – n’est pas celle d’un pur instant
vide : mais manifestation d’une existence qui apporte sa structure et enveloppe son horizon.
Le présent appartient au monde au moment même où la conscience saisit ce présent comme
intégré à un ensemble existant qui est “ déjà ” : par là on comprend la passivité que la
conscience s’attribue lorsqu’elle pense son existence dans le monde : son présent prend racine
ailleurs : elle ne pense pas le présent comme commencement absolu d’existence : elle ne le
pense pas comme passage pur et pure fuite du passé. Elle le saisit comme l’opération par
laquelle l’existence déterminée maintenant se manifeste en se détachant d’un domaine
implicite d’existence auquel la conscience ne peut s’empêcher de la rattacher cependant et
dans lequel elle enfouit le présent comme dans sa demeure permanente. La conscience saisit
alors son présent comme venant au jour, comme surgissant de l’inconnu : mais à cet instant
même elle reconnaît cet inconnu comme le terrain d’origine, comme le domaine déjà existant,
racine de toute présence.
[0010]
un ordre permanent d’existence, par quoi le maintenant est saisi
comme plein de choses. Autrement dit la présence du monde – n’est pas celle d’un pur instant
vide : mais manifestation d’une existence qui apporte sa structure et enveloppe son horizon.
Le présent appartient au monde au moment même où la conscience saisit ce présent comme
intégré à un ensemble existant qui est “ déjà ” : par là on comprend la passivité que la
conscience s’attribue lorsqu’elle pense son existence dans le monde : son présent prend racine
ailleurs : elle ne pense pas le présent comme commencement absolu d’existence : elle ne le
pense pas comme passage pur et pure fuite du passé. Elle le saisit comme l’opération par
laquelle l’existence déterminée maintenant se manifeste en se détachant d’un domaine
implicite d’existence auquel la conscience ne peut s’empêcher de la rattacher cependant et
dans lequel elle enfouit le présent comme dans sa demeure permanente. La conscience saisit
alors son présent comme venant au jour, comme surgissant de l’inconnu : mais à cet instant
même elle reconnaît cet inconnu comme le terrain d’origine, comme le domaine déjà existant,
racine de toute présence.
Il faut alors que la conscience donne sens à cet implicite, origine de toute présence, et que ce sens soit pour ainsi dire constitué a priori. Comment le présent se distinguerait-il, dans la spécification qu’il apporte, si le domaine d’où il tire son origine, et dans lequel il est reconnu comme quelque chose, n’était pas, à quelque degré, spécifié pour la conscience ? On ne saisirait jamais alors le présent comme origine de sa propre présence, et la nouveauté qu’il apporte ne serait rien pour nous. Dans l’appréhension du présent, le domaine implicite originaire de ce présent doit donc manifester, dans la synthèse même par laquelle le présent apparaît, l’unité d’un sens que la conscience lui accorde : le présent ne peut surgir que d’une présence, qui déjà, est quelque chose.
Or d’où la conscience tirerait-elle ce sens si elle ne le trouvait dans la forme même de
la synthèse d’appréhension
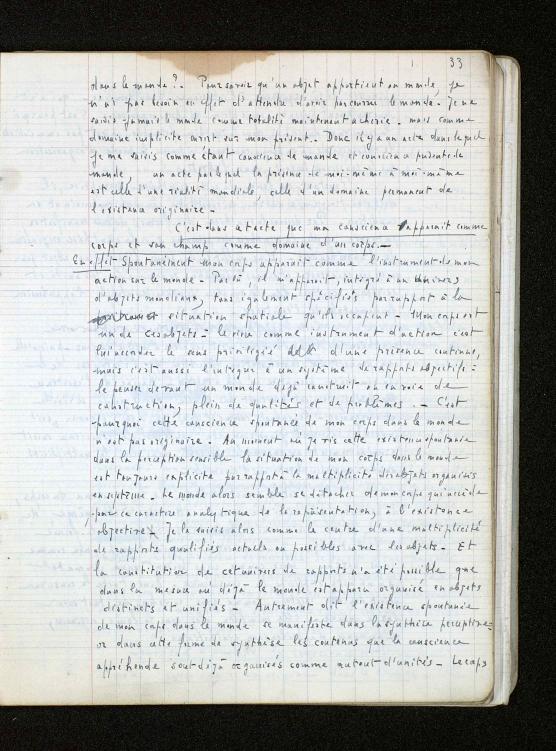 [0011]
dans le monde ? Pour savoir qu’un objet appartient au
monde, je n’ai pas besoin en effet d’attendre d’avoir parcouru le monde. Je ne saisis jamais le
monde comme totalité maintenant achevée – mais comme domaine implicite ouvert sur mon
présent. Donc il y a un acte dans lequel je me saisis comme étant conscience de monde et
conscience présente de monde, un acte par lequel la présence de moi-même à moi-même est
celle d’une réalité mondaine, celle d’un domaine permanent de l’existence originaire.
[0011]
dans le monde ? Pour savoir qu’un objet appartient au
monde, je n’ai pas besoin en effet d’attendre d’avoir parcouru le monde. Je ne saisis jamais le
monde comme totalité maintenant achevée – mais comme domaine implicite ouvert sur mon
présent. Donc il y a un acte dans lequel je me saisis comme étant conscience de monde et
conscience présente de monde, un acte par lequel la présence de moi-même à moi-même est
celle d’une réalité mondaine, celle d’un domaine permanent de l’existence originaire.
C’est dans cet acte que ma conscience apparaît comme corps et son champ comme domaine du corps.
En effet, spontanément, mon corps apparaît comme l’instrument de mon action sur le monde.
Par là, il m’apparaît, intégré à un univers d’objets mondains, tous également spécifiés par
rapport à la situation spatiale qu’ils occupent. Mon corps est un de ces objets : le vivre comme
instrument d’action c’est lui accorder le sens privilégié d’une présence continue, mais c’est
aussi l’intégrer à un système de rapports objectifs : le penser devant un monde déjà construit
ou en voie de construction, plein de qualités et de problèmes. C’est pourquoi cette conscience
spontanée de mon corps dans le monde n’est pas originaire. Au moment où je vis cette
existence spontanée dans la perception sensible, la situation de mon corps dans le monde est
toujours explicite par rapport à la multiplicité des objets organisés en système. Le monde alors
semble se détacher de mon corps qui accède, par ce caractère analytique de la représentation, à
l’existence objective. Je le saisis alors comme le centre d’une multiplicité de rapports qualifiés
actuels ou possibles avec les objets. Et la constitution de cet univers de rapports n’a été
possible que dans la mesure où déjà le monde est apparu organisé en objets distincts et unifiés.
Autrement dit, l’existence spontanée de mon corps dans le monde se manifeste dans la
synthèse perceptive, or dans cette forme de synthèse les contenus que la conscience
appréhende sont déjà organisés comme autant d’unités. Le corps
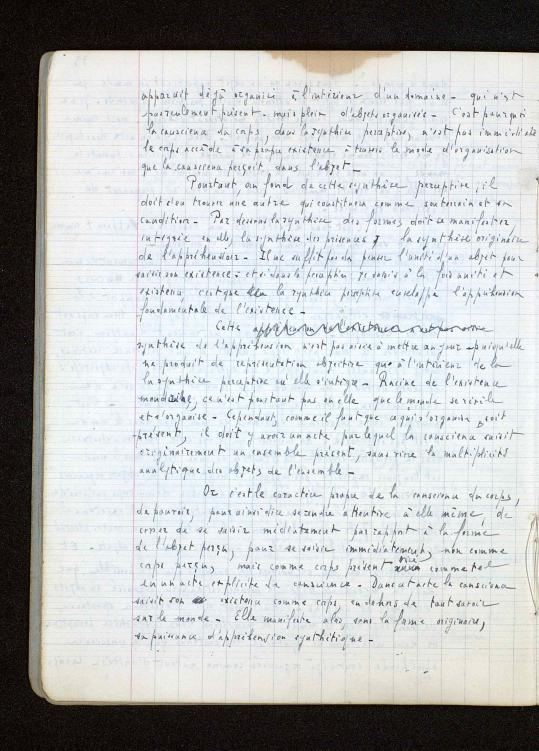 [0012]
apparaît déjà organisé à
l’intérieur d’un domaine , qui n’est pas seulement présent, mais plein d’objets. C’est pourquoi
la conscience du corps, dans la synthèse perceptive, n’est pas immédiate : le corps accède à sa
propre existence à travers le mode d’organisation que la conscience perçoit dans l’objet.
[0012]
apparaît déjà organisé à
l’intérieur d’un domaine , qui n’est pas seulement présent, mais plein d’objets. C’est pourquoi
la conscience du corps, dans la synthèse perceptive, n’est pas immédiate : le corps accède à sa
propre existence à travers le mode d’organisation que la conscience perçoit dans l’objet.
Pourtant, au fond de cette synthèse perceptive, il doit s’en trouver une autre qui constituera comme son terrain et sa condition. Par-dessous la synthèse des formes doit se manifester, intégrée en elle, la synthèse des présences : la synthèse originaire de l’appréhension. Il ne suffit pas de penser l’unité d’un objet pour saisir son existence : et si, dans la perception, je saisis à la fois unité et existence, c’est que la synthèse perceptive enveloppe l’appréhension fondamentale de l’existence.
Cette synthèse de l’appréhension n’est pas aisée à mettre au jour puisqu’elle ne produit de représentation objective qu’à l’intérieur de la synthèse perceptive où elle s’intègre. Racine de l’existence mondaine, ce n’est pourtant pas en elle que le monde se révèle et s’organise. Cependant, comme il faut que ce qui s’organise soit présent, il doit y avoir un acte par lequel la conscience saisit originairement un ensemble présent, sans vivre la multiplicité analytique des objets de l’ensemble.
Or c’est le caractère propre de la conscience du corps, de pouvoir, pour ainsi dire se rendre attentive à elle-même, de cesser de se saisir médiatement par rapport à la forme de l’objet perçu, pour se saisir immédiatement, non comme corps perçu, mais comme corps présent visé comme tel en un acte explicite de conscience. Dans cet acte, la conscience saisit son existence comme corps, en dehors de tout savoir sur le monde. Elle manifeste alors, sous la forme originaire, sa puissance d’appréhension synthétique.
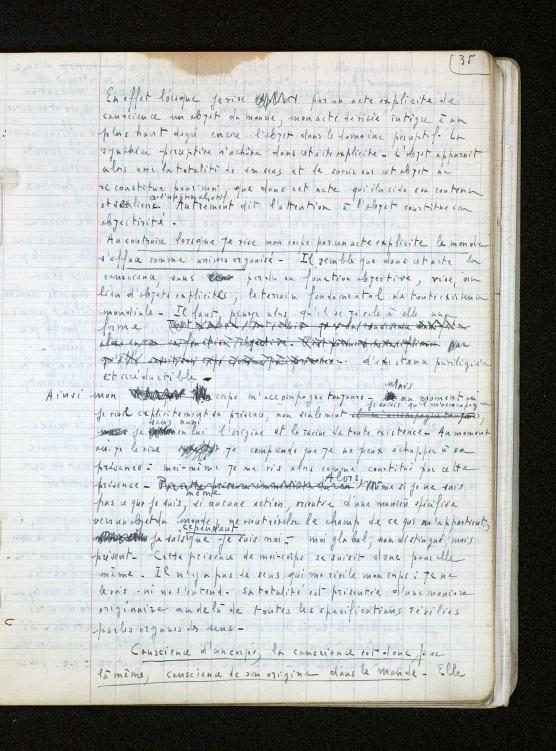 [0013]
En effet, lorsque je vise par un acte explicite de conscience un objet du monde, mon acte de
visée intègre à un plus haut degré encore l’objet dans le domaine perceptif. La synthèse
perceptive s’achève dans cet acte explicite. L’objet apparaît alors avec la totalité de son sens
et le savoir sur cet objet ne se constitue pour moi que dans cet acte qui élucide son contenu et
son lien à l’univers objectif. Autrement dit, l’attention à l’objet constitue son objectivité.
Au contraire, lorsque je vise mon corps par un acte explicite, le monde s’efface comme
univers organisé. Il semble que dans cet acte la conscience, sans perdre sa fonction objective,
vise, au lieu d’objets explicites, le terrain fondamental de toute existence mondaine. Il faut
penser alors qu’il se révèle à elle une forme d’existence privilégiée et irréductible.
[0013]
En effet, lorsque je vise par un acte explicite de conscience un objet du monde, mon acte de
visée intègre à un plus haut degré encore l’objet dans le domaine perceptif. La synthèse
perceptive s’achève dans cet acte explicite. L’objet apparaît alors avec la totalité de son sens
et le savoir sur cet objet ne se constitue pour moi que dans cet acte qui élucide son contenu et
son lien à l’univers objectif. Autrement dit, l’attention à l’objet constitue son objectivité.
Au contraire, lorsque je vise mon corps par un acte explicite, le monde s’efface comme
univers organisé. Il semble que dans cet acte la conscience, sans perdre sa fonction objective,
vise, au lieu d’objets explicites, le terrain fondamental de toute existence mondaine. Il faut
penser alors qu’il se révèle à elle une forme d’existence privilégiée et irréductible.
Ainsi mon corps m’accompagne toujours. Mais au moment où je vise explicitement sa présence, non seulement je saisis qu’il m’accompagne, mais je sens aussi en lui l’origine et la racine de toute existence. Au moment où je le vise, je comprends que je ne peux échapper à sa présence : moi-même je me vis alors comme constitué par cette présence. Alors, même si je ne sais pas ce que je suis, même si aucune action orientée d’une manière spécifiée vers un objet du monde ne vient révéler le champ de ce qui m’appartient, je sais cependant que je suis moi : moi global, non distingué, mais présent. Cette présence de moi-corps se saisit donc pour elle- même. Il n’y a pas de sens qui me révèle mon corps : je ne le vois ni ne l’entend. Sa totalité est présentée d’une manière originaire au-delà de toutes spécifications révélées par les organes des sens.
Conscience d’un corps, la conscience est donc, par là même, conscience de son origine
dans le monde. Elle
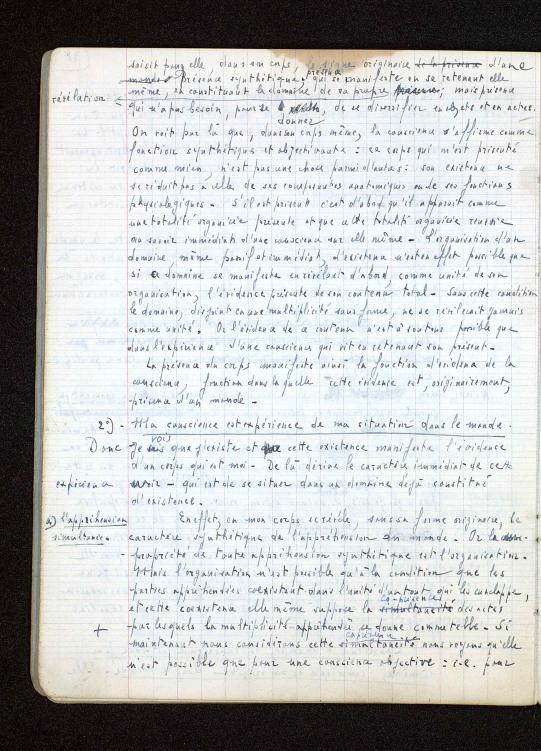 [0014]
saisit pour elle, dans son corps, le signe originaire d’une présence
synthétique, présence qui se manifeste en se retenant elle même, en constituant le domaine de
sa propre révélation ; mais présence qui n’a pas besoin, pour se donner, de se diversifier en
objets et en actes. On voit par là que, dans son corps même, la conscience s’affirme comme
fonction synthétique et objectivante : ce corps qui m’est présenté comme mien, n’est pas une
chose parmi d’autres : son existence ne se réduit pas à celles de ses composantes anatomiques
ou de ses fonctions physiologiques. S’il est présent, c’est d’abord qu’il apparaît comme une
totalité organisée présente et que cette totalité organisée renvoie au savoir immédiat d’une
conscience sur elle-même. L’organisation d’un domaine, même passif et immédiat,
d’existence n’est en effet possible que si ce domaine se manifeste en révélant d’abord, comme
unité de son organisation, l’évidence présente de son contenu total. Sans cette condition, le
domaine, disjoint en une multiplicité sans forme, ne se révèlerait jamais comme unité. Or
l’évidence de ce contenu n’est à son tour possible que dans l’expérience d’une conscience qui
vit en retenant son présent. La présence du corps manifeste ainsi la fonction d’évidence de la
conscience, fonction dans laquelle cette évidence est, originairement, présence d’un monde.
[0014]
saisit pour elle, dans son corps, le signe originaire d’une présence
synthétique, présence qui se manifeste en se retenant elle même, en constituant le domaine de
sa propre révélation ; mais présence qui n’a pas besoin, pour se donner, de se diversifier en
objets et en actes. On voit par là que, dans son corps même, la conscience s’affirme comme
fonction synthétique et objectivante : ce corps qui m’est présenté comme mien, n’est pas une
chose parmi d’autres : son existence ne se réduit pas à celles de ses composantes anatomiques
ou de ses fonctions physiologiques. S’il est présent, c’est d’abord qu’il apparaît comme une
totalité organisée présente et que cette totalité organisée renvoie au savoir immédiat d’une
conscience sur elle-même. L’organisation d’un domaine, même passif et immédiat,
d’existence n’est en effet possible que si ce domaine se manifeste en révélant d’abord, comme
unité de son organisation, l’évidence présente de son contenu total. Sans cette condition, le
domaine, disjoint en une multiplicité sans forme, ne se révèlerait jamais comme unité. Or
l’évidence de ce contenu n’est à son tour possible que dans l’expérience d’une conscience qui
vit en retenant son présent. La présence du corps manifeste ainsi la fonction d’évidence de la
conscience, fonction dans laquelle cette évidence est, originairement, présence d’un monde.
2°) Ma conscience est expérience de ma situation dans le monde.
Donc je vois que j’existe et que cette existence manifeste l’évidence d’un corps qui est moi. De là dérive le caractère immédiat de cette expérience, qui est de se situer dans un domaine déjà constitué d’existence.
a) L’appréhension simultanée.
En effet, en mon corps se révèle, sous sa forme originaire, le caractère synthétique de
l’appréhension du monde. Or la propriété de toute appréhension synthétique est l’organisation.
Mais l’organisation n’est possible qu’à la condition que les parties appréhendées coexistent
dans l’unité d’un tout qui les enveloppe, et cette coexistence elle-même suppose la simultanéité
co- présence des actes par lesquels la multiplicité appréhendée se donne comme telle. Si
maintenant nous considérons cette simultanéité coprésence nous voyons qu’elle n’est possible que pour
une conscience objective : i.e. pour
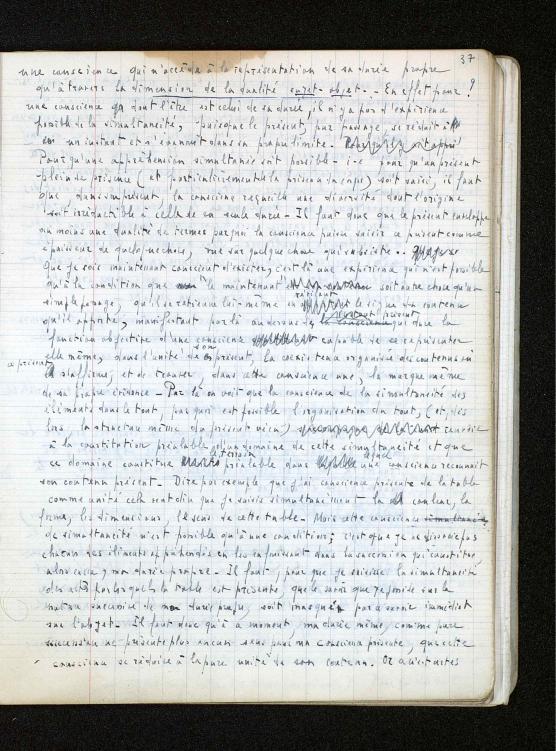 [0015]
une conscience qui n’accède à la représentation de
sa durée qu’à travers la dimension de la dualité
sujet - objet
.
En effet pour
[0015]
une conscience qui n’accède à la représentation de
sa durée qu’à travers la dimension de la dualité
sujet - objet
.
En effet pour 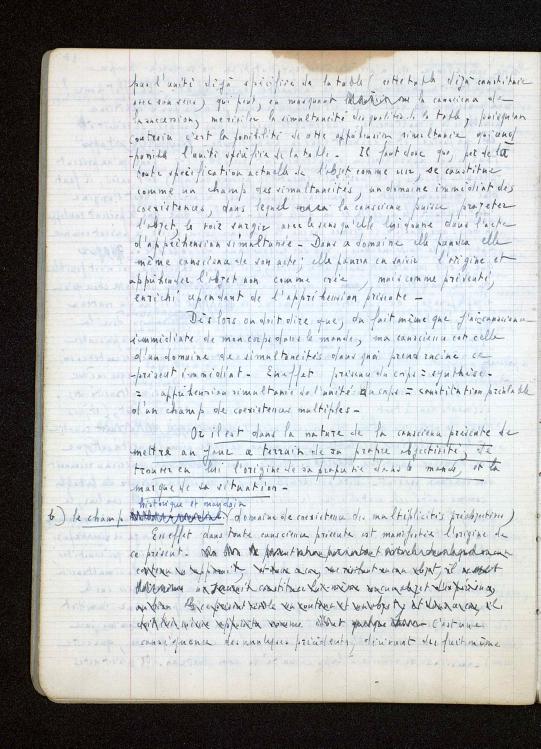 [0016]
pas l’unité déjà spécifiée de la table (cette table déjà constituée avec
son sens) qui peut, en masquant la conscience de la succession, me révéler la simultanéité des
qualités de la table, puisqu’au contraire c’est la possibilité de cette appréhension simultanée
qui rend possible l’unité spécifiée de la table. Il faut donc que, par delà toute spécification
actuelle de l’objet comme un, se constitue comme un champ des simultanéités, un domaine
immédiat des coexistences, dans lequel la conscience puisse projeter l’objet, le voir surgir
avec le sens qu’elle lui donne dans l’acte d’appréhension simultanée. Dans ce domaine elle
prendra elle-même conscience de son acte ; elle pourra en saisir l’origine et appréhender
l’objet non comme créé, mais comme présenté, enrichi cependant de l’appréhension présente.
[0016]
pas l’unité déjà spécifiée de la table (cette table déjà constituée avec
son sens) qui peut, en masquant la conscience de la succession, me révéler la simultanéité des
qualités de la table, puisqu’au contraire c’est la possibilité de cette appréhension simultanée
qui rend possible l’unité spécifiée de la table. Il faut donc que, par delà toute spécification
actuelle de l’objet comme un, se constitue comme un champ des simultanéités, un domaine
immédiat des coexistences, dans lequel la conscience puisse projeter l’objet, le voir surgir
avec le sens qu’elle lui donne dans l’acte d’appréhension simultanée. Dans ce domaine elle
prendra elle-même conscience de son acte ; elle pourra en saisir l’origine et appréhender
l’objet non comme créé, mais comme présenté, enrichi cependant de l’appréhension présente.
Dès lors on doit dire que, du fait même que j’aie conscience immédiate de mon corps dans le monde, ma conscience est celle d’un domaine de simultanéités dans quoi prend racine ce présent immédiat. En effet présence du corps = synthèse = appréhension simultanée de l’unité du corps = constitution préalable d’un champ de coexistences multiples.
Or il est dans la nature de la conscience présente de mettre au jour ce terrain de sa propre objectivité, de trouver en lui l’origine de sa propre vie dans le monde, et la marque de sa situation.
b) Le champ historique et mondain (domaine de coexistence des multiplicités pré-objectives)
En effet dans toute conscience présente est manifestée l’origine de ce présent. C’est une
conséquence des analyses précédentes, dérivant du fait même
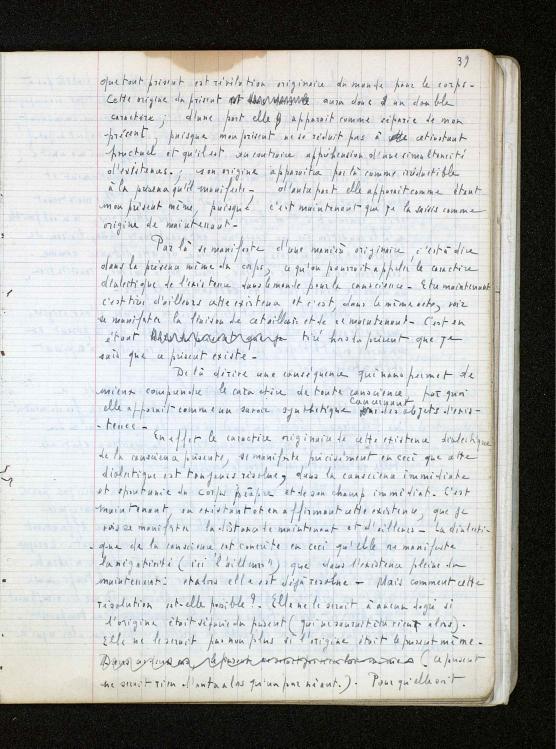 [0017]
que tout présent est
révélation originaire du monde pour le corps. Cette origine du présent aura donc un double
caractère ; d’une part elle apparaît comme séparée de mon présent, puisque mon présent ne se
réduit pas à cet instant ponctuel et qu’il est au contraire appréhension d’une simultanéité
d’existences ; son origine apparaîtra par là comme irréductible à la présence qu’il manifeste –
d’autre part elle apparaît comme étant mon présent même, puisque c’est maintenant que je la
saisis comme origine du maintenant.
[0017]
que tout présent est
révélation originaire du monde pour le corps. Cette origine du présent aura donc un double
caractère ; d’une part elle apparaît comme séparée de mon présent, puisque mon présent ne se
réduit pas à cet instant ponctuel et qu’il est au contraire appréhension d’une simultanéité
d’existences ; son origine apparaîtra par là comme irréductible à la présence qu’il manifeste –
d’autre part elle apparaît comme étant mon présent même, puisque c’est maintenant que je la
saisis comme origine du maintenant.
Par là se manifeste d’une manière originaire, c’est-à-dire dans la présence même du corps, ce qu’on pourrait appeler le caractère dialectique de l’existence dans le monde pour la conscience. Etre maintenant, c’est tirer d’ailleurs cette existence et c’est, dans le même acte, voir se manifester la liaison de cet ailleurs et de ce maintenant. C’est en étant tiré hors du présent que je sais que ce présent existe.
De là dérive une conséquence qui nous permet de mieux comprendre le caractère de toute conscience par quoi elle apparaît comme un savoir synthétique concernant des objets d’existence.
En effet, le caractère originaire de cette existence dialectique de la conscience présente, se
manifeste précisément en ceci que cette dialectique est toujours résolue, dans la conscience
immédiate et spontanée du corps propre et de son champ immédiat. C’est maintenant, en
existant et en affirmant cette existence, que je vois se manifester la distance de maintenant et
d’ailleurs. La dialectique de la conscience est concrète en ceci qu’elle ne manifeste la
négativité (ici "l’ailleurs") que dans l’existence pleine du maintenant : et alors elle est déjà
résolue. Mais comment cette résolution est possible ? Elle ne le serait à aucun degré si
l’origine était séparée du présent (qui ne saurait être rien alors). Elle ne le serait pas non plus
si l’origine était le présent même (ce présent ne serait rien d’autre alors qu’un pur néant). Pour
qu’elle soit
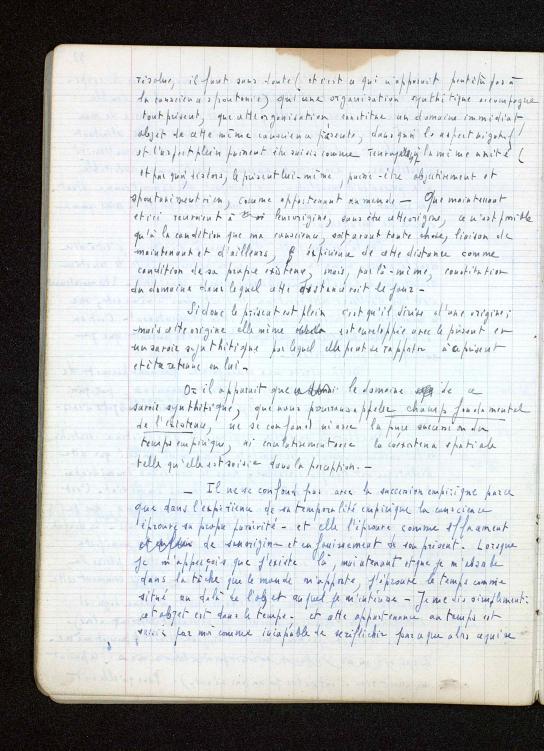 [0018]
résolue, il faut sans doute (et c’est ce qui n’apparaît peut être pas à la
conscience spontanée) qu’une organisation synthétique accompagne tout présent, que cette
organisation constitue un domaine immédiat, objet de cette même conscience présente, dans
quoi l’aspect négatif et l’aspect plein puissent être saisis comme renvoyant à la même unité (et
par quoi, dès lors, le présent lui-même, puisse-être objectivement et spontanément
[0018]
résolue, il faut sans doute (et c’est ce qui n’apparaît peut être pas à la
conscience spontanée) qu’une organisation synthétique accompagne tout présent, que cette
organisation constitue un domaine immédiat, objet de cette même conscience présente, dans
quoi l’aspect négatif et l’aspect plein puissent être saisis comme renvoyant à la même unité (et
par quoi, dès lors, le présent lui-même, puisse-être objectivement et spontanément
Si donc le présent est plein, c’est qu’il dérive d’une origine ; mais cette origine elle-même
est enveloppée avec le présent en un savoir synthétique par lequel elle peut se rapporter à ce
présent et être retenue en lui.
Or il apparaît que le domaine de ce savoir synthétique, que nous pourrons appeler champ fondamental de l’existence , ne se confond ni avec la pure succession du temps empirique, ni corrélativement avec la coexistence spatiale telle qu’elle est saisie dans la perception.
Il ne se confond pas avec la succession empirique parce que dans l’expérience
de sa temporalité empirique la conscience éprouve sa propre passivité, et elle
l’éprouve comme effacement de son origine et enfouissement de son présent.
Lorsque je m’aperçois que j’existe là, maintenant, et que je m’absorbe dans la tâche
que le monde m’apporte, j’éprouve le temps comme situé au-delà de l’objet auquel je
m’intéresse. Je me dis simplement : cet objet est dans le temps et cette
appartenance au temps est saisie par moi comme incapable de se réfléchir parce
que alors ce qui se
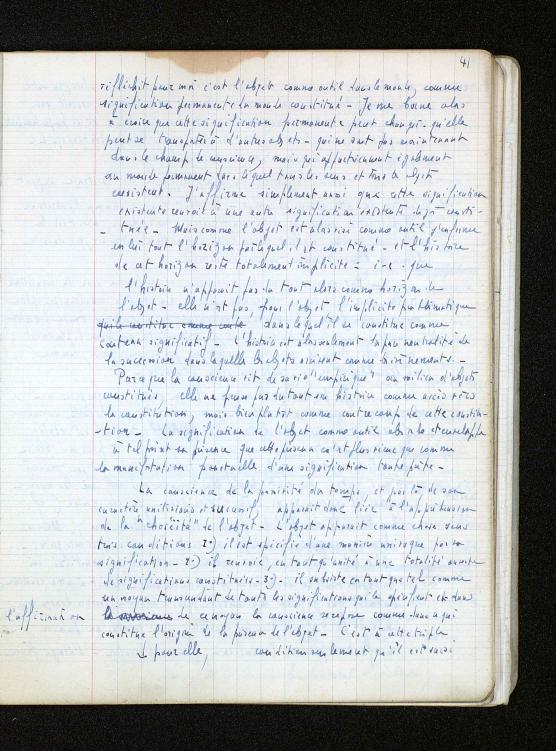 [0019]
réfléchit pour moi c’est l’objet comme outil dans le monde,
comme signification permanente du monde constitué. Je me borne alors à croire que
cette signification permanente peut changer, qu’elle peut se transporter à d’autres
objets qui ne sont pas maintenant dans le champ de conscience, mais qui
appartiennent également au monde permanent dans lequel tous les sens et tous les
objets coexistent. J’affirme simplement aussi que cette signification existante renvoie
à une autre signification existante déjà constituée. Mais comme l’objet est alors visé
comme outil, j’enferme en lui tout l’horizon par lequel il est constitué – et l’histoire de
cet horizon reste totalement implicite = i.e. que l’histoire n’apparaît pas du tout alors
comme horizon de l’objet – elle n’est pas, pour l’objet, l’implicite problématique dans
lequel il se constitue comme contenu significatif. L’histoire est alors seulement la pure
neutralité de la succession dans laquelle les objets arrivent comme des évènements.
Parce que la conscience vit de sa vie "empirique" au milieu d’objets constitués, elle
ne pense pas du tout son histoire comme accès vers la constitution, mais bien plutôt
comme contrecoup de cette constitution. La signification de l’objet comme outil
absorbe et enveloppe à tel point sa présence que cette présence n’est plus vécue
que comme la manifestation ponctuelle d’une signification toute prête.
[0019]
réfléchit pour moi c’est l’objet comme outil dans le monde,
comme signification permanente du monde constitué. Je me borne alors à croire que
cette signification permanente peut changer, qu’elle peut se transporter à d’autres
objets qui ne sont pas maintenant dans le champ de conscience, mais qui
appartiennent également au monde permanent dans lequel tous les sens et tous les
objets coexistent. J’affirme simplement aussi que cette signification existante renvoie
à une autre signification existante déjà constituée. Mais comme l’objet est alors visé
comme outil, j’enferme en lui tout l’horizon par lequel il est constitué – et l’histoire de
cet horizon reste totalement implicite = i.e. que l’histoire n’apparaît pas du tout alors
comme horizon de l’objet – elle n’est pas, pour l’objet, l’implicite problématique dans
lequel il se constitue comme contenu significatif. L’histoire est alors seulement la pure
neutralité de la succession dans laquelle les objets arrivent comme des évènements.
Parce que la conscience vit de sa vie "empirique" au milieu d’objets constitués, elle
ne pense pas du tout son histoire comme accès vers la constitution, mais bien plutôt
comme contrecoup de cette constitution. La signification de l’objet comme outil
absorbe et enveloppe à tel point sa présence que cette présence n’est plus vécue
que comme la manifestation ponctuelle d’une signification toute prête.
La conscience de la passivité du temps, et par là, de son caractère unilinéaire et successif,
apparaît donc liée à l’appréhension de la “ choséité ” de l’objet. L’objet apparaît comme chose
sous trois conditions 1°) il est spécifié d’une manière univoque par sa signification 2°) il
renvoie, en tant qu’unité, à une totalité ouverte de significations constituées 3°) il subsiste en
tant que tel comme un noyau transcendant de toutes les significations qui le spécifient, et dans
l’affirmation de ce noyau la conscience se repose comme dans ce qui constitue, pour elle,
l’origine de la présence de l’objet. C’est à cette triple condition seulement qu’il est saisi
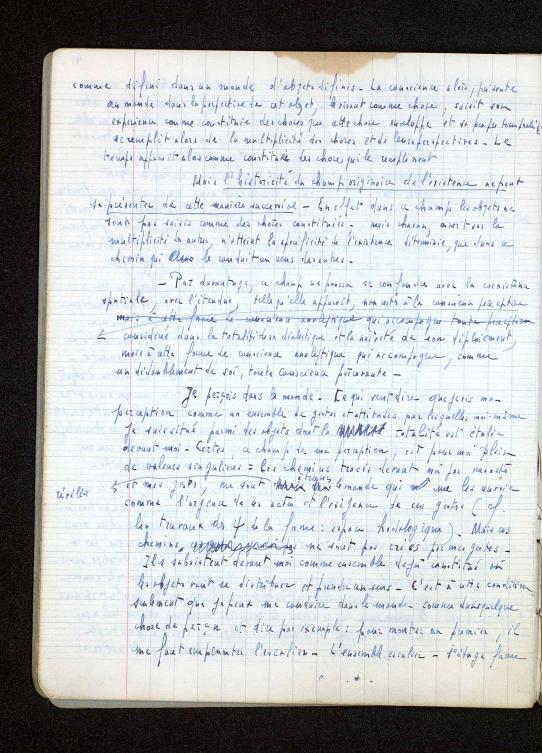 [0020]
comme défini dans un monde d’objets définis. La conscience alors, présente au monde dans la
perspective de cet objet, le visant comme chose, saisit son expérience comme constituée des
choses que cette chose enveloppe, et sa propre temporalité se remplit alors de la multiplicité
des choses et de leurs perspectives. Le temps apparaît alors comme constitué des choses qui le
remplissent.
[0020]
comme défini dans un monde d’objets définis. La conscience alors, présente au monde dans la
perspective de cet objet, le visant comme chose, saisit son expérience comme constituée des
choses que cette chose enveloppe, et sa propre temporalité se remplit alors de la multiplicité
des choses et de leurs perspectives. Le temps apparaît alors comme constitué des choses qui le
remplissent.
Mais l’historicité du champ originaire de l’existence ne peut se présenter de cette manière successive. En effet dans ce champ les objets ne sont pas saisis comme des choses constituées, mais chacun, ouvert sur la multiplicité des autres, n’atteint la spécificité de l’existence déterminée que dans ce chemin qui le conduit au sens des autres.
Pas davantage ce champ ne pourra se confondre avec la coexistence spatiale, avec l’étendue, telle qu’elle apparaît, non certes à la conscience perceptive considérée dans la totalité de sa dialectique et la naïveté de son déploiement, mais à cette forme de conscience analytique qui accompagne, comme un dédoublement de soi, toute conscience percevante.
Je perçois le monde. Ce qui veut dire que je vis ma perception comme un ensemble de
gestes et attitudes par lesquels moi-même je suis situé parmi des objets dont la totalité est
étalée devant moi. Certes, ce champ de ma perception, est pour moi plein de valeurs
singulières : les chemins tracés devant moi par mes actes et mes gestes, me sont révélés à
travers le monde qui me les renvoie comme l’urgence de ces actes et l’exigence de ces gestes
(cf. les travaux des psychologues de la forme : espace hodologique). Mais ces chemins ne sont
pas créés par mes gestes. Ils subsistent devant moi comme ensemble déjà constitué où les
objets vont se distribuer et prendre un sens. C’est à cette condition seulement que je peux me
conduire dans le monde comme dans quelque chose de perçu et dire par exemple : pour
monter au premier, il me faut emprunter l’escalier. L’ensemble escalier-1e étage forme
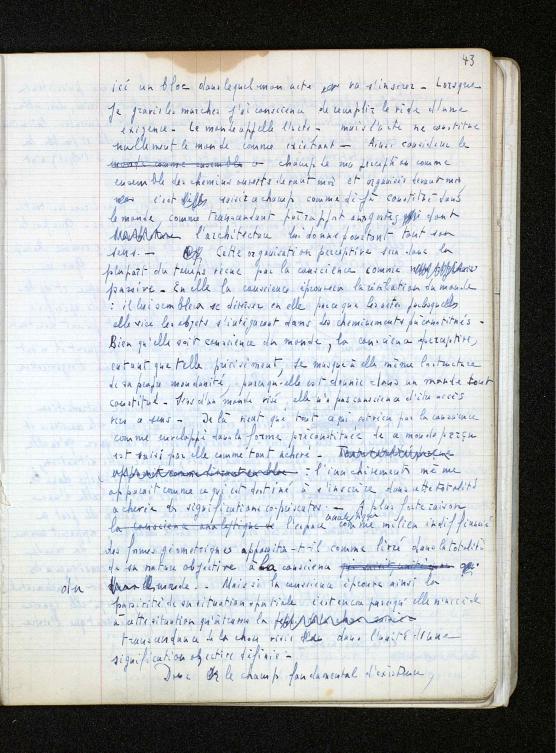 [0021]
ici un bloc dans lequel mon acte va s’insérer. Lorsque je gravis les marches, j’ai conscience de
remplir le vide d’une exigence. Le monde appelle l’acte – mais l’acte ne constitue nullement
le monde comme existant. Ainsi, considérer le champ de ma perception comme ensemble des
chemins ouverts devant moi et organisés devant moi, c’est saisir ce champ comme déjà
constitué dans le monde, comme transcendant par rapport aux gestes dont l’architecture lui
donne pourtant tout son sens. Cette organisation perceptive sera donc la plupart du temps
vécue par la conscience comme passive. En elle la conscience éprouvera la révélation du
monde : il lui semblera se déverser en elle parce que les actes par lesquels elle vise les objets
s’intègreront dans des cheminements pré-constitués. Bien qu’elle soit conscience du monde, la
conscience perceptive, en tant que telle précisément, se masque à elle-même la structure de sa
propre mondanéité, parce qu’elle est donnée dans un monde tout constitué. Sens d’un monde
visé, elle n’a pas conscience d’être accès vers ce sens. De là vient que tout ce qui est vécu par
la conscience comme enveloppé dans la forme pré-constituée de ce monde perçu est saisi par
elle comme tout achevé : l’inachèvement même apparaît comme ce qui est destiné à s’inscrire
dans cette totalité achevée des significations co-présentes. A plus forte raison l’espace
analytique comme milieu indifférencié des formes géométriques apparaîtra-t-il comme livré
dans la totalité de sa nature objective à la conscience du monde. Mais si la conscience éprouve
ainsi la passivité de sa situation spatiale, c’est encore parce qu’elle n’accède à cette situation
qu’à travers la transcendance de la chose visée dans l’unité d’une signification objective
définie.
[0021]
ici un bloc dans lequel mon acte va s’insérer. Lorsque je gravis les marches, j’ai conscience de
remplir le vide d’une exigence. Le monde appelle l’acte – mais l’acte ne constitue nullement
le monde comme existant. Ainsi, considérer le champ de ma perception comme ensemble des
chemins ouverts devant moi et organisés devant moi, c’est saisir ce champ comme déjà
constitué dans le monde, comme transcendant par rapport aux gestes dont l’architecture lui
donne pourtant tout son sens. Cette organisation perceptive sera donc la plupart du temps
vécue par la conscience comme passive. En elle la conscience éprouvera la révélation du
monde : il lui semblera se déverser en elle parce que les actes par lesquels elle vise les objets
s’intègreront dans des cheminements pré-constitués. Bien qu’elle soit conscience du monde, la
conscience perceptive, en tant que telle précisément, se masque à elle-même la structure de sa
propre mondanéité, parce qu’elle est donnée dans un monde tout constitué. Sens d’un monde
visé, elle n’a pas conscience d’être accès vers ce sens. De là vient que tout ce qui est vécu par
la conscience comme enveloppé dans la forme pré-constituée de ce monde perçu est saisi par
elle comme tout achevé : l’inachèvement même apparaît comme ce qui est destiné à s’inscrire
dans cette totalité achevée des significations co-présentes. A plus forte raison l’espace
analytique comme milieu indifférencié des formes géométriques apparaîtra-t-il comme livré
dans la totalité de sa nature objective à la conscience du monde. Mais si la conscience éprouve
ainsi la passivité de sa situation spatiale, c’est encore parce qu’elle n’accède à cette situation
qu’à travers la transcendance de la chose visée dans l’unité d’une signification objective
définie.
Donc le champ fondamental d’existence,
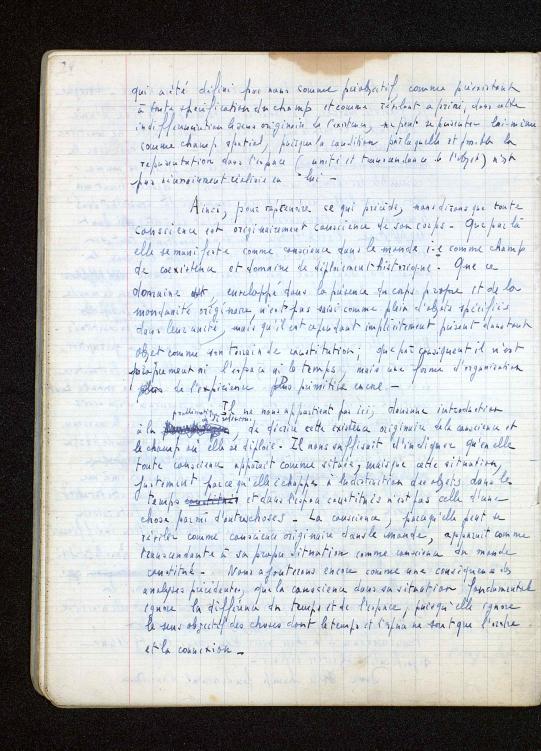 [0022]
qui a été défini par nous comme pré-objectif, comme pré-existant à toute spécification du champ et comme révélant a priori, dans
cette indifférenciation le sens originaire de l’existence, ne peut se présenter lui-même comme
champ spatial, puisque la condition par laquelle est possible la représentation dans l’espace
(unité et transcendance de l’objet) n’est pas nécessairement réalisée en lui.
[0022]
qui a été défini par nous comme pré-objectif, comme pré-existant à toute spécification du champ et comme révélant a priori, dans
cette indifférenciation le sens originaire de l’existence, ne peut se présenter lui-même comme
champ spatial, puisque la condition par laquelle est possible la représentation dans l’espace
(unité et transcendance de l’objet) n’est pas nécessairement réalisée en lui.
Ainsi, pour reprendre ce qui précède, nous dirons que toute conscience est originairement conscience de son corps. Que par là elle se manifeste comme conscience dans le monde, i.e. comme champ de coexistence et domaine de déploiement historique. Que ce domaine, enveloppé dans la présence du corps propre et de la mondanéité originaire, n’est pas saisi comme plein d’objets spécifiés dans leur unité, mais qu’il est cependant implicitement présent dans tout objet comme son terrain de constitution ; que par conséquent il n’est proprement ni l’espace ni le temps, mais une forme d’organisation de l’expérience plus primitive encore.
Il ne nous appartient pas ici, dans une introduction à la problématique de la réflexion, de décrire cette existence originaire de la conscience et le champ où elle se déploie. Il nous suffisait d’indiquer qu’en elle toute conscience apparaît comme située, mais que cette situation, justement parce qu’elle échappe à la distinction des objets dans le temps et dans l’espace constitués, n’est pas celle d’une chose parmi d’autres choses. La conscience, parce qu’elle peut se révéler comme conscience originaire dans le monde, apparaît comme transcendante à sa propre situation comme conscience du monde constitué. Nous ajouterons encore, comme une conséquence des analyses précédentes, que la conscience dans sa situation fondamentale ignore la différence du temps et de l’espace, puisqu’elle ignore le sens objectif des choses dont le temps et l’espace ne sont que l’ordre et la connexion.
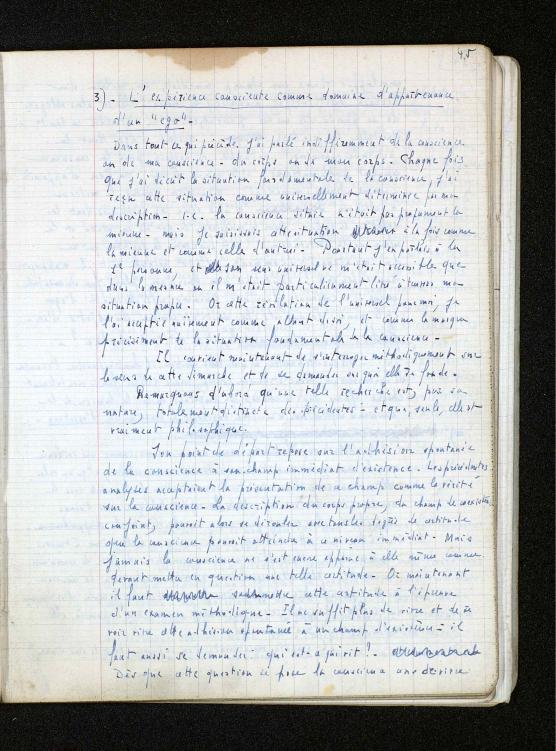 [0023]
3°) L’expérience consciente comme domaine d’appartenance de l’"ego".
[0023]
3°) L’expérience consciente comme domaine d’appartenance de l’"ego".
Dans tout ce qui précède j’ai parlé indifféremment de la conscience ou de ma conscience – du corps ou de mon corps. Chaque fois que j’ai décrit la situation fondamentale de la conscience, j’ai reçu cette situation comme universellement déterminée par ma description – i.e. la conscience située n’était pas proprement la mienne, mais je saisissais cette situation à la fois comme la mienne et comme celle d’autrui. Pourtant, j’en parlais à la première personne, et son sens universel ne m’était accessible que dans la mesure où il m’était particulièrement livré à travers ma situation propre. Or cette révélation de l’universel pour moi, je l’ai acceptée naïvement comme allant de soi, et comme la marque précisément de la situation fondamentale de la conscience.
Il convient maintenant de s’interroger méthodiquement sur le sens de cette démarche et de se demander sur quoi elle se fonde.
Remarquons d’abord qu’une telle recherche est, par sa nature, totalement distincte des précédentes et que, seule, elle est vraiment philosophique.
Son point de départ repose sur l’adhésion spontanée de la conscience à son champ
immédiat d’existence. Les précédentes analyses acceptaient la présentation de ce champ
comme la vérité sur la conscience. La description du corps propre, du champ de coexistence
conjoint, pouvait alors se dérouler avec tous les degrés de certitude que la conscience pouvait
atteindre à ce niveau immédiat. Mais jamais la conscience ne s’est encore apparue à elle
même comme devant mettre en question une telle certitude. Or maintenant il faut soumettre
cette certitude à l’épreuve d’un examen méthodique. Il ne suffit plus de vivre et de se voir
vivre cette adhésion spontanée à un champ d’existence : il faut aussi se demander : qui est-ce
qui vit ? Dès que cette question se pose la conscience cesse de vivre
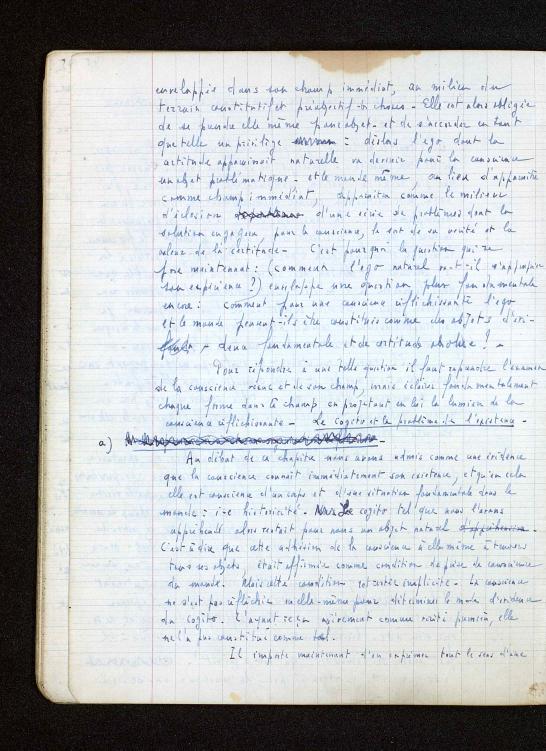 [0024]
enveloppée dans son champ immédiat, au milieu du terrain constitutif et pré-objectif des choses. Elle est alors
obligée de se prendre elle-même pour objet et de s’accorder en tant que telle un privilège : dès
lors l’ego dont la certitude apparaissait naturelle va devenir pour la conscience un objet
problématique, et le monde même, au lieu d’apparaître comme champ immédiat, apparaîtra
comme le milieu d’éclosion d’une série de problèmes dont la solution engagera, pour la
conscience, le sort de sa vérité et la valeur de la certitude. C’est pourquoi la question qui se
pose maintenant : (comment l’ego naturel va-t-il s’approprier son expérience ?) enveloppe une
question plus fondamentale encore : comment pour une conscience réfléchissante l’ego et le
monde peuvent-ils être constitués comme des objets d’évidence fondamentale et de certitude
absolue ?
[0024]
enveloppée dans son champ immédiat, au milieu du terrain constitutif et pré-objectif des choses. Elle est alors
obligée de se prendre elle-même pour objet et de s’accorder en tant que telle un privilège : dès
lors l’ego dont la certitude apparaissait naturelle va devenir pour la conscience un objet
problématique, et le monde même, au lieu d’apparaître comme champ immédiat, apparaîtra
comme le milieu d’éclosion d’une série de problèmes dont la solution engagera, pour la
conscience, le sort de sa vérité et la valeur de la certitude. C’est pourquoi la question qui se
pose maintenant : (comment l’ego naturel va-t-il s’approprier son expérience ?) enveloppe une
question plus fondamentale encore : comment pour une conscience réfléchissante l’ego et le
monde peuvent-ils être constitués comme des objets d’évidence fondamentale et de certitude
absolue ?
Pour répondre à une telle question il faut reprendre l’examen de la conscience vécue et de son champ, mais éclairer fondamentalement chaque forme dans le champ en projetant en lui la lumière de la conscience réfléchissante.
a) Le cogito et le problème de l’existence.
Au début de ce chapitre nous avons admis comme une évidence que la conscience connaît immédiatement son existence, et qu’en cela elle est conscience d’un corps et d’une situation fondamentale dans le monde : i.e. historicité. Mais le cogito tel que nous l’avons appréhendé alors restait pour nous un objet naturel. C’est-à-dire que cette adhésion de la conscience à elle- même à travers tous ses objets était affirmée comme condition de prise de conscience du monde. Mais cette condition est restée implicite. La conscience ne s’est pas réfléchie en elle- même pour déterminer le mode d’évidence du Cogito. L’ayant reçu naïvement comme vérité première, elle ne l’a pas constitué comme tel.
Il importe maintenant d’en exprimer tout le sens d’une
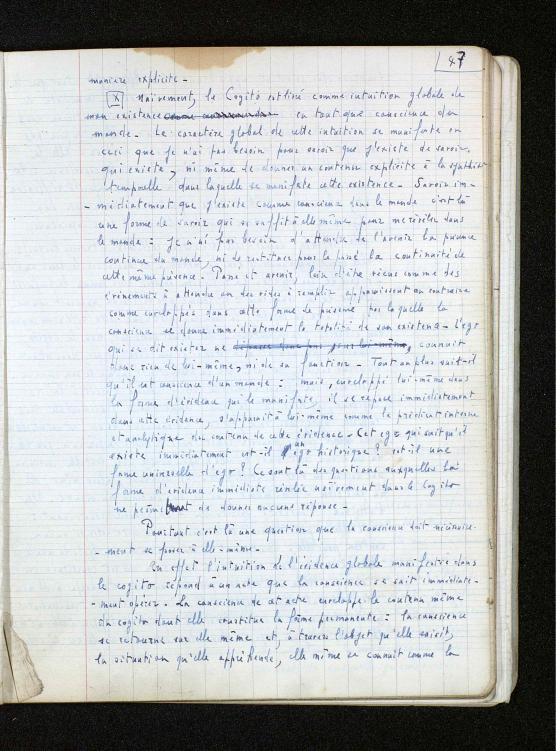 [0025]
manière explicite.
[0025]
manière explicite.
Naïvement, le Cogito est livré comme intuition globale de mon existence en tant que conscience du monde. Le caractère global de cette intuition se manifeste en ceci que je n’ai pas besoin pour savoir que j’existe de savoir qui existe, ni même de donner un contenu explicite à la synthèse temporelle dans laquelle se manifeste cette existence. Savoir immédiatement que j’existe comme conscience dans le monde, c’est là une forme de savoir qui se suffit à elle-même pour me révéler dans le monde : je n’ai pas besoin d’attendre de l’avenir la présence continue du monde, ni de restituer pour le passé la continuité de cette même présence. Passé et avenir, loin d’être vécus comme des évènements à attendre où des vides à remplir, apparaissent au contraire comme enveloppés dans cette forme de présence par laquelle la conscience se donne immédiatement la totalité de son existence – l’ego qui se dit exister ne connaît donc rien de lui-même, ni de sa fonction. Tout au plus sait-t-il qu’il est conscience d’un monde : mais, enveloppé lui-même dans la forme d’évidence qui le manifeste, il se repose immédiatement dans cette évidence, s’apparaît à lui-même comme le prédicat interne et analytique du contenu de cette évidence. Cet ego qui sait qu’il existe immédiatement est-il un ego historique ? Est-il une forme universelle d’ego ? Ce sont là des questions auxquelles la forme d’évidence immédiate révélée naïvement dans le Cogito ne permet de donner aucune réponse.
Pourtant c’est là une question que la conscience doit nécessairement se poser à elle-même.
En effet, l’intuition de l’évidence globale manifestée dans le Cogito répond à un acte que la
conscience se sait immédiatement opérer. La conscience de cet acte enveloppe le contenu
même du Cogito dont elle constitue la forme permanente : la conscience se retourne sur elle-
même et, à travers l’objet qu’elle saisit, la situation qu’elle appréhende, elle-même se connaît
comme la fonction qui saisit et appréhende. Or tant que le Cogito se manifeste naïvement
comme la
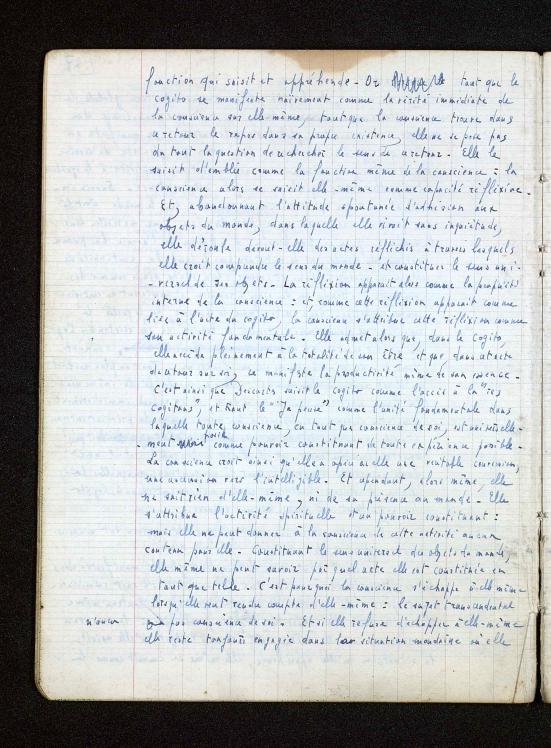 [0026]
vérité immédiate de la conscience sur elle-même, tant que la conscience
trouve dans ce retour le repos dans sa propre existence, elle ne se pose pas du tout la question
de rechercher le sens de ce retour. Elle le saisit d’emblée comme la fonction même de la
conscience : la conscience alors se saisit elle-même comme capacité réflexive. Et,
abandonnant l’attitude spontanée d’adhésion aux objets du monde dans laquelle elle vivait
sans inquiétude, elle déroule devant-elle des actes réfléchis à travers lesquels elle croit
comprendre le sens du monde, et constituer le sens universel de ses objets. La réflexion
apparaît alors comme la propriété interne de la conscience ; et, comme cette réflexion apparaît
comme liée à l’acte du Cogito, la conscience s’attribue cette réflexion comme son activité
fondamentale. Elle admet alors que, dans le Cogito, elle accède pleinement à la totalité de son
être et que, dans cet acte de retour sur soi, se manifeste la productivité même de son essence.
C’est ainsi que Descartes saisit le Cogito comme l’accès à la "res cogitans", et Kant le "je
pense" comme l’unité fondamentale dans laquelle toute conscience, en tant que conscience de
soi, est universellement posée comme pouvoir constituant de toute expérience possible. La
conscience croit ainsi qu’elle a opéré
[0026]
vérité immédiate de la conscience sur elle-même, tant que la conscience
trouve dans ce retour le repos dans sa propre existence, elle ne se pose pas du tout la question
de rechercher le sens de ce retour. Elle le saisit d’emblée comme la fonction même de la
conscience : la conscience alors se saisit elle-même comme capacité réflexive. Et,
abandonnant l’attitude spontanée d’adhésion aux objets du monde dans laquelle elle vivait
sans inquiétude, elle déroule devant-elle des actes réfléchis à travers lesquels elle croit
comprendre le sens du monde, et constituer le sens universel de ses objets. La réflexion
apparaît alors comme la propriété interne de la conscience ; et, comme cette réflexion apparaît
comme liée à l’acte du Cogito, la conscience s’attribue cette réflexion comme son activité
fondamentale. Elle admet alors que, dans le Cogito, elle accède pleinement à la totalité de son
être et que, dans cet acte de retour sur soi, se manifeste la productivité même de son essence.
C’est ainsi que Descartes saisit le Cogito comme l’accès à la "res cogitans", et Kant le "je
pense" comme l’unité fondamentale dans laquelle toute conscience, en tant que conscience de
soi, est universellement posée comme pouvoir constituant de toute expérience possible. La
conscience croit ainsi qu’elle a opéré 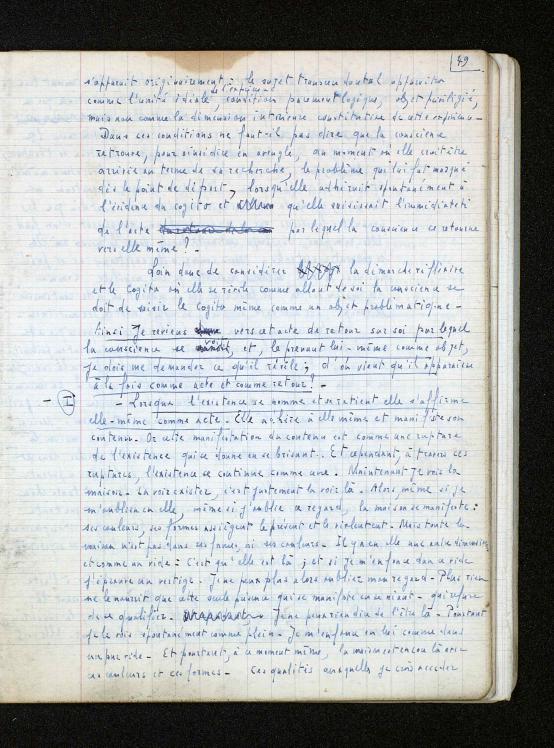 [0027]
s’apparaît originairement : le sujet transcendantal apparaîtra comme l’unité idéale de l’expérience,
condition purement logique, objet privilégié, mais non comme la dimension intérieure
constitutive de cette expérience. Dans ces conditions ne faut-il pas dire que la conscience
retrouve, pour ainsi dire en aveugle, au moment où elle croit être arrivée au terme de sa
recherche, le problème qui lui fut masqué dès le point de départ, lorsqu’elle adhérait
spontanément à l’évidence du Cogito et qu’elle saisissait l’immédiateté de l’acte par lequel la
conscience se retourne vers elle-même ?
[0027]
s’apparaît originairement : le sujet transcendantal apparaîtra comme l’unité idéale de l’expérience,
condition purement logique, objet privilégié, mais non comme la dimension intérieure
constitutive de cette expérience. Dans ces conditions ne faut-il pas dire que la conscience
retrouve, pour ainsi dire en aveugle, au moment où elle croit être arrivée au terme de sa
recherche, le problème qui lui fut masqué dès le point de départ, lorsqu’elle adhérait
spontanément à l’évidence du Cogito et qu’elle saisissait l’immédiateté de l’acte par lequel la
conscience se retourne vers elle-même ?
Loin donc de considérer la démarche réflexive et le Cogito où elle se révèle comme allant de soi, la conscience se doit de saisir le Cogito même comme un objet problématique. Ainsi je reviens vers cet acte de retour sur soi par lequel la conscience se voit, et, le prenant lui-même comme objet, je dois me demander ce qu’il révèle ; d’où vient qu’il apparaisse à la fois comme acte et comme retour ?
I) Lorsque l’existence se nomme et se retient elle s’affirme elle-même comme acte. Elle
adhère à elle-même et manifeste son contenu. Or cette manifestation du contenu est comme
une rupture de l’existence qui se donne en se brisant. Et cependant, à travers ces ruptures,
l’existence se continue comme une. Maintenant je vois la maison. La voir exister, c’est
justement la voir là. Alors, même si je m’oublie en elle, même si j’oublie ce regard, la maison
se manifeste : ses couleurs, ses formes assiègent le présent et le violentent. Mais toute la
maison n’est pas dans ses formes, ni ses couleurs. Il y a en elle une autre dimension et comme
un vide : c’est qu’elle est là ; et si je m’enfonce dans ce vide, j’éprouve un vertige. Je ne peux
plus alors oublier mon regard. Plus rien ne le nourrit que cette seule présence qui se manifeste
en se niant – qui refuse de se qualifier. Je ne peux rien dire de l’être-là. Pourtant je le vois
spontanément comme plein. Je m’enfonce en lui comme dans un pur vide. Et pourtant, à ce
moment même, la maison est encore là avec ces couleurs et ces formes. Ces qualités
auxquelles je crois accéder
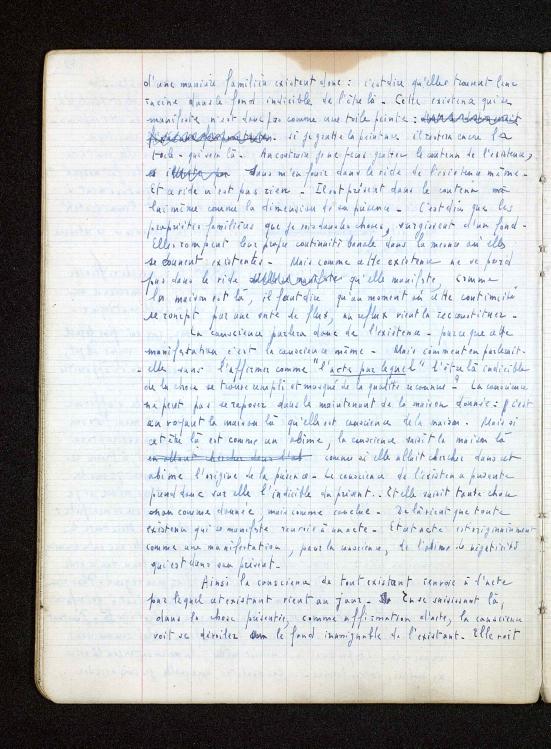 [0028]
d’une manière familière existent donc : c’est dire qu’elles
trouvent leur racine dans le fond indicible de l’être-là. Cette existence qui se manifeste n’est
donc pas comme une toile peinte : si je gratte la peinture, il restera encore la toile, qui sera là.
Au contraire je ne peux gratter le contenu de l’existence, sans m’enfouir dans le vide de
l’existence même. Et ce vide n’est pas rien. Il est présent dans le contenu lui-même comme la
dimension de sa présence. C’est dire que les propriétés familières que je vois dans les choses
surgissent d’un fond. Elles rompent leur propre continuité banale dans la mesure où elles se
donnent
[0028]
d’une manière familière existent donc : c’est dire qu’elles
trouvent leur racine dans le fond indicible de l’être-là. Cette existence qui se manifeste n’est
donc pas comme une toile peinte : si je gratte la peinture, il restera encore la toile, qui sera là.
Au contraire je ne peux gratter le contenu de l’existence, sans m’enfouir dans le vide de
l’existence même. Et ce vide n’est pas rien. Il est présent dans le contenu lui-même comme la
dimension de sa présence. C’est dire que les propriétés familières que je vois dans les choses
surgissent d’un fond. Elles rompent leur propre continuité banale dans la mesure où elles se
donnent
La conscience parlera donc de l’existence, parce que cette manifestation c’est la conscience même. Mais comment en parlerait-elle sans l’affirmer comme “ l’acte par lequel ” l’être-là indicible de la chose se trouve rempli et masqué de la qualité reconnue ? La conscience ne peut pas se reposer dans le maintenant de la maison donnée : c’est en voyant la maison là qu’elle est conscience de la maison. Mais si cet être-là est comme un abîme, la conscience saisit la maison là comme si elle allait chercher dans cet abîme l’origine de la présence. La conscience de l’existence présente prend donc sur elle l’indicible du présent. Et elle saisit tout chose non comme donnée, mais comme conclue. De là vient que toute existence qui se manifeste renvoie à un acte. Et cet acte est originairement comme une manifestation, pour la conscience, de l’abîme de négativité qui est dans son présent.
Ainsi la conscience de tout existant renvoie à l’acte par lequel cet existant vient au
jour. En se saisissant là, dans la chose présentée, comme affirmation d’acte, la conscience voit
se dévoiler le fond inassignable de l’existant. Elle voit
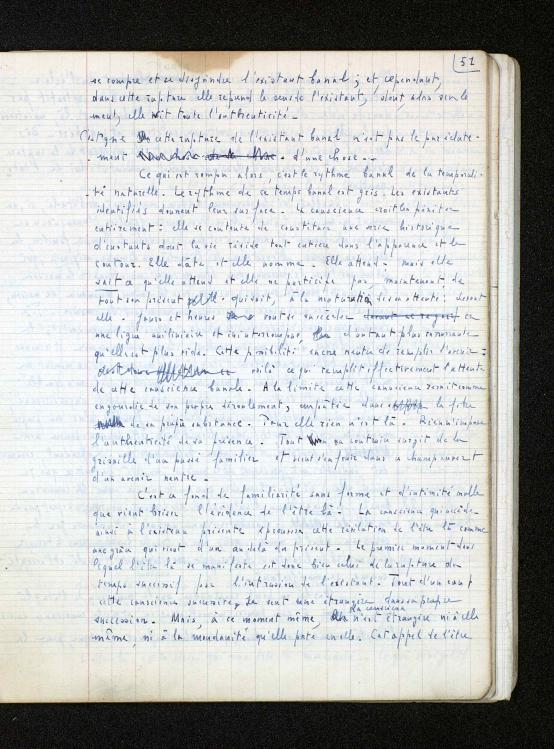 [0029]
se rompre et se disjoindre l’existant banal ; et, cependant, dans cette rupture elle reprend le sens de l’existant, dont, alors
seulement, elle voit toute l’authenticité.
[0029]
se rompre et se disjoindre l’existant banal ; et, cependant, dans cette rupture elle reprend le sens de l’existant, dont, alors
seulement, elle voit toute l’authenticité.
C’est que cette rupture de l’existant banal n’est pas le pur éclatement d’une chose.
Ce qui est rompu alors, c’est le rythme banal de la temporalité naturelle. Le rythme de ce temps banal est gris. Les existants identifiés donnent leur surface. La conscience croit les pénétrer entièrement : elle se contente de constituer une série historique d’instants dont la vie réside tout entière dans l’apparence et le contour. Elle date et elle nomme. Elle attend ; mais elle sait ce qu’elle attend et elle ne participe pas, maintenant, de tout son présent qui sait, à la maturation de son attente : devant elle jours et heures vont se succéder en une ligne unilinéaire et ininterrompue, d’autant plus rassurante qu’elle est plus vide. Cette possibilité encore neutre de remplir l’avenir, voilà ce qui remplit effectivement l’attente de cette conscience banale. A la limite, cette conscience serait comme engourdie de son propre déroulement, empâtée dans la fibre de sa propre substance. Pour elle rien n’est là. Rien n’impose l’authenticité de sa présence. Tout au contraire surgit de la grisaille d’un passé familier et vient s’enfouir dans ce champ ouvert d’un avenir neutre.
C’est ce fond de familiarité sans forme et d’intimité molle que vient briser l’évidence
de l’être-là. La conscience qui accède ainsi à l’existence présente éprouvera cette révélation de
l’être-là comme une grâce qui vient d’un au-delà du présent. Le premier moment dans lequel
l’être-là se manifeste est donc bien celui de la rupture du temps successif par l’intrusion de
l’existant. Tout d’un coup, cette conscience successive se sent une étrangère dans sa propre
succession. Mais, à ce moment même, la conscience n’est étrangère ni à elle même, ni à la
mondanéité qu’elle porte en elle. Cet appel de l’être-
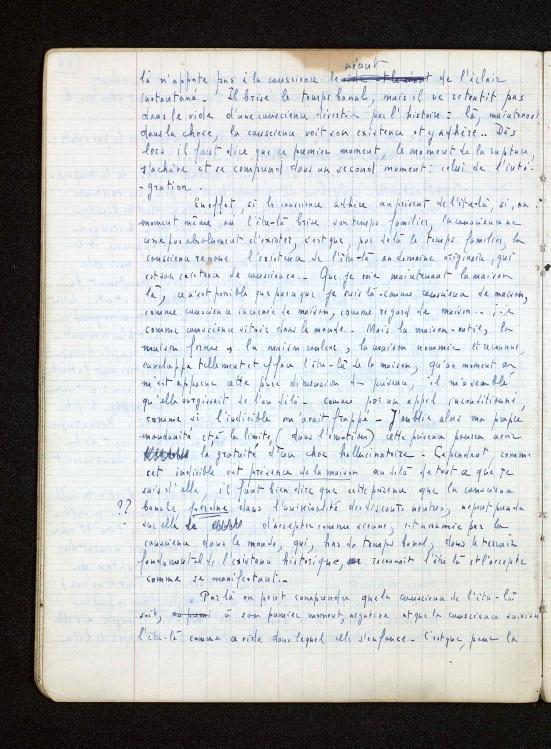 [0030]
là n’apporte pas à la conscience le
néant de l’éclair instantané. Il brise le temps banal, mais il ne retentit pas dans le vide d’une
conscience désertée par l’histoire : là, maintenant, dans la chose, la conscience voit son
existence et y adhère… Dès lors il faut dire que ce premier moment, le moment de la rupture,
s’achève et se comprend dans un second moment : celui de l’intégration
En effet, si la conscience adhère au présent de l’être là, si, au moment même où l’être
là brise son temps familier, la conscience ne cesse pas absolument d’exister, c’est que, par-
delà le temps familier, la conscience renoue l’existence de l’être-là au domaine originaire, qui
est son existence de conscience. Que je voie maintenant la maison là, ce n’est possible que
parce que je suis là, comme conscience de maison, comme conscience incarnée de maison,
comme regard de maison … i.e. comme conscience située de monde. Mais la maison-outil, la
maison forme, la maison couleur, la maison nommée et reconnue, enveloppe tellement et
efface l’être-là de la maison, qu’au moment où m’est apparue cette pure dimension de
présence, il m’a semblé qu’elle surgissait de l’au-delà comme par un appel inconditionné,
comme si l’indicible m’avait frappé. J’oublie alors ma propre mondanéité et à la limite (dans
l’émotion) cette présence pourra avoir la gratuité d’un choc hallucinatoire. Cependant, comme
cet indicible est présence de maison au-delà de tout ce que je sais d’elle, il faut bien dire que
cette présence que la conscience banale, perdue
[0030]
là n’apporte pas à la conscience le
néant de l’éclair instantané. Il brise le temps banal, mais il ne retentit pas dans le vide d’une
conscience désertée par l’histoire : là, maintenant, dans la chose, la conscience voit son
existence et y adhère… Dès lors il faut dire que ce premier moment, le moment de la rupture,
s’achève et se comprend dans un second moment : celui de l’intégration
En effet, si la conscience adhère au présent de l’être là, si, au moment même où l’être
là brise son temps familier, la conscience ne cesse pas absolument d’exister, c’est que, par-
delà le temps familier, la conscience renoue l’existence de l’être-là au domaine originaire, qui
est son existence de conscience. Que je voie maintenant la maison là, ce n’est possible que
parce que je suis là, comme conscience de maison, comme conscience incarnée de maison,
comme regard de maison … i.e. comme conscience située de monde. Mais la maison-outil, la
maison forme, la maison couleur, la maison nommée et reconnue, enveloppe tellement et
efface l’être-là de la maison, qu’au moment où m’est apparue cette pure dimension de
présence, il m’a semblé qu’elle surgissait de l’au-delà comme par un appel inconditionné,
comme si l’indicible m’avait frappé. J’oublie alors ma propre mondanéité et à la limite (dans
l’émotion) cette présence pourra avoir la gratuité d’un choc hallucinatoire. Cependant, comme
cet indicible est présence de maison au-delà de tout ce que je sais d’elle, il faut bien dire que
cette présence que la conscience banale, perdue
Par là on peut comprendre que la conscience de l’être-là soit, à son premier moment,
négative et que la conscience saisisse l’être-là comme ce vide dans lequel elle s’enferme.
C’est que, pour la
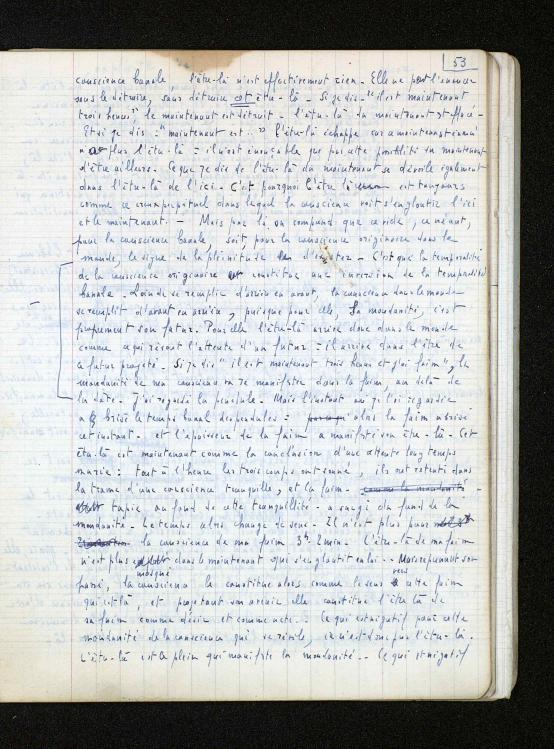 [0031]
conscience banale, l’être-là n’est effectivement rien. Elle ne peut
l’énoncer sans le détruire, sans détruire cet être-là. Si je dis : “ il est maintenant trois heures ”,
le maintenant est détruit, l’être-là du maintenant est effacé. Et si je dis : “ maintenant est… ”,
l’être-là échappe car ce maintenant énoncé n’est plus l’être-là : il n’est énonçable que par cette
possibilité du maintenant d’être ailleurs. Ce que je dis de l’être-là du maintenant se dévoile
également dans l’être-là de l’ici. C’est pourquoi l’être-là est toujours comme ce creux
perpétuel dans lequel la conscience voit s’engloutir l’ici et le maintenant. Mais par là on
comprend que ce vide, ce néant, pour la conscience banale, soit, pour la conscience originaire
dans le monde, le signe de la plénitude d’exister. C’est que la temporalité de la conscience
originaire constitue une inversion de la temporalité banale. Loin de se remplir d’arrière en
avant, la conscience dans le monde se remplit d’avant en arrière, puisque pour elle, la
mondanéité, c’est proprement son futur. Pour elle l’être-là arrive donc dans le monde comme
ce qui résout l’attente d’un futur : il arrive dans l’être de ce futur projeté. Si je dis : “ il est
maintenant trois heures et j’ai faim ”, la mondanéité de ma conscience va se manifester dans la
faim, au-delà de la date. J’ai regardé la pendule. Mais l’instant où je l’ai regardée a brisé le
temps banal des pendules : alors la faim a brisé cet instant, et l’épaisseur de la faim a
manifesté son être-là. Cet être-là est maintenant comme la conclusion d’une attente longtemps
mûrie : tout à l’heure les trois coups ont sonné, ils ont retenti dans la trame d’une conscience
tranquille, et la faim, tapie au fond de cette tranquillité, a surgi du fond de la mondanéité. Le
temps alors change de sens. Il n’est plus pour la conscience de ma faim trois heures et deux
minutes. L’être-là de ma faim n’est plus masqué dans le maintenant qui s’engloutit en lui.
Mais reprenant son passé, la conscience le constitue alors comme le sens vers cette faim qui
est là, et projetant son avenir elle constitue l’être-là de sa faim comme désir et comme acte. Ce
qui est négatif pour cette mondanéité de la conscience qui se révèle, ce n’est donc pas l’être-
là. L’être-là est le plein qui manifeste la mondanéité. Ce qui est négatif
[0031]
conscience banale, l’être-là n’est effectivement rien. Elle ne peut
l’énoncer sans le détruire, sans détruire cet être-là. Si je dis : “ il est maintenant trois heures ”,
le maintenant est détruit, l’être-là du maintenant est effacé. Et si je dis : “ maintenant est… ”,
l’être-là échappe car ce maintenant énoncé n’est plus l’être-là : il n’est énonçable que par cette
possibilité du maintenant d’être ailleurs. Ce que je dis de l’être-là du maintenant se dévoile
également dans l’être-là de l’ici. C’est pourquoi l’être-là est toujours comme ce creux
perpétuel dans lequel la conscience voit s’engloutir l’ici et le maintenant. Mais par là on
comprend que ce vide, ce néant, pour la conscience banale, soit, pour la conscience originaire
dans le monde, le signe de la plénitude d’exister. C’est que la temporalité de la conscience
originaire constitue une inversion de la temporalité banale. Loin de se remplir d’arrière en
avant, la conscience dans le monde se remplit d’avant en arrière, puisque pour elle, la
mondanéité, c’est proprement son futur. Pour elle l’être-là arrive donc dans le monde comme
ce qui résout l’attente d’un futur : il arrive dans l’être de ce futur projeté. Si je dis : “ il est
maintenant trois heures et j’ai faim ”, la mondanéité de ma conscience va se manifester dans la
faim, au-delà de la date. J’ai regardé la pendule. Mais l’instant où je l’ai regardée a brisé le
temps banal des pendules : alors la faim a brisé cet instant, et l’épaisseur de la faim a
manifesté son être-là. Cet être-là est maintenant comme la conclusion d’une attente longtemps
mûrie : tout à l’heure les trois coups ont sonné, ils ont retenti dans la trame d’une conscience
tranquille, et la faim, tapie au fond de cette tranquillité, a surgi du fond de la mondanéité. Le
temps alors change de sens. Il n’est plus pour la conscience de ma faim trois heures et deux
minutes. L’être-là de ma faim n’est plus masqué dans le maintenant qui s’engloutit en lui.
Mais reprenant son passé, la conscience le constitue alors comme le sens vers cette faim qui
est là, et projetant son avenir elle constitue l’être-là de sa faim comme désir et comme acte. Ce
qui est négatif pour cette mondanéité de la conscience qui se révèle, ce n’est donc pas l’être-
là. L’être-là est le plein qui manifeste la mondanéité. Ce qui est négatif
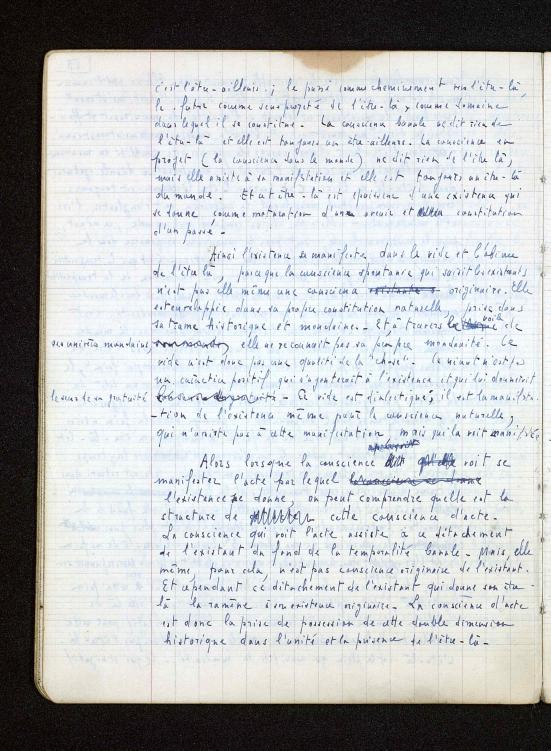 [0032]
c’est l’être-
ailleurs ; le passé comme cheminement vers l’être-là, le futur comme sens projeté de l’être-là,
comme domaine dans lequel il se constitue. La conscience banale ne dit rien de l’être-là et elle
est toujours un être-ailleurs. La conscience en projet (la conscience dans le monde) ne dit rien
de l’être-là, mais elle assiste à sa manifestation et elle est toujours un être-là du monde. Et cet
être-là est épaisseur d’une existence qui se donne comme maturation d’un avenir et
constitution d’un passé.
[0032]
c’est l’être-
ailleurs ; le passé comme cheminement vers l’être-là, le futur comme sens projeté de l’être-là,
comme domaine dans lequel il se constitue. La conscience banale ne dit rien de l’être-là et elle
est toujours un être-ailleurs. La conscience en projet (la conscience dans le monde) ne dit rien
de l’être-là, mais elle assiste à sa manifestation et elle est toujours un être-là du monde. Et cet
être-là est épaisseur d’une existence qui se donne comme maturation d’un avenir et
constitution d’un passé.
Ainsi l’existence se manifeste dans le vide et l’abîme de l’être-là, parce que la conscience spontanée qui saisit les existants n’est pas elle-même une conscience originaire. Elle est enveloppée dans sa propre constitution naturelle, prise dans sa trame historique et mondaine. Et, à travers le voile de ses univers mondains, elle ne reconnaît pas sa propre mondanéité. Ce vide n’est donc pas une qualité de la “ chose ”. Ce néant n’est pas un caractère positif qui s’ajouterait à l’existence et qui lui donnerait le sens de sa gratuité. Ce vide est dialectique ; il est la manifestation de l’existence même pour la conscience naturelle, qui n’assiste pas à cette manifestation, mais qui la voit manifestée.
Alors lorsque la conscience voit se manifester l’acte par lequel l’existence se donne, on
peut comprendre quelle est la structure de cette conscience d’acte. La conscience qui voit
l’acte assiste à ce détachement de l’existant du fond de la temporalité banale. Mais, elle-
même, pour cela, n’est pas conscience originaire de l’existant. Et cependant ce détachement
de l’existant qui donne son être-là la ramène à son existence originaire. La conscience d’acte
est donc la prise de possession de cette double dimension historique dans l’unité et la présence
de l’être-là
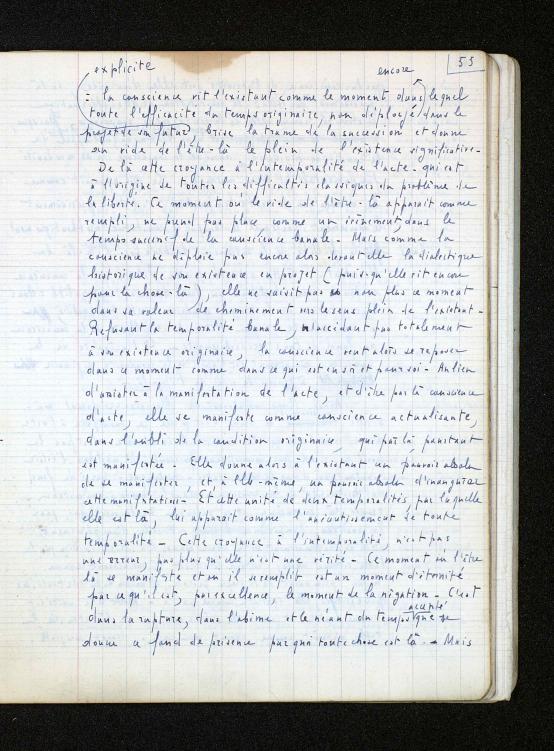 [0033]
: la conscience vit l’existant comme le moment dans lequel toute l’efficacité
du temps originaire, non déployé encore dans le projet de son futur explicite, brise la trame de
la succession et donne au vide de l’être-là le plein de l’existence significative. De là cette
croyance à l’intemporalité de l’acte qui est à l’origine de toutes les difficultés classiques du
problème de la liberté. Ce moment où le vide de l’être-là apparaît comme rempli ne prend pas
place, comme un événement, dans le temps successif de la conscience banale. Mais comme la
conscience ne déploie pas encore alors devant elle la dialectique historique de son existence
en projet (puisqu’elle vit encore pour la chose-là), elle ne saisit pas non plus ce moment dans
sa valeur de cheminement vers le sens plein de l’existant. Refusant la temporalité banale,
n’accédant pas totalement à son existence originaire, la conscience veut alors se reposer dans
ce moment comme dans ce qui est en soi et pour soi. Au lieu d’assister à la manifestation de
l’acte et d’être par là conscience d’acte, elle se manifeste comme conscience actualisante dans
l’oubli de la condition originaire qui par là pourtant est manifestée. Elle donne alors à
l’existant un pouvoir absolu de se manifester, et, à elle-même, un pouvoir absolu d’inaugurer
cette manifestation. Et cette unité de deux temporalités, par laquelle elle est là, lui apparaît
comme l’anéantissement de toute temporalité. Cette croyance à l’intemporalité n’est pas une
erreur, pas plus qu’elle n’est une vérité. Ce moment où l’être-là se manifeste et où il se remplit
est un moment d’éternité parce qu’il est, par excellence, le moment de la négation. C’est dans
la rupture, dans l’abîme et le néant du temps accepté que se donne ce fond de présence par
quoi toute chose est là. Mais
[0033]
: la conscience vit l’existant comme le moment dans lequel toute l’efficacité
du temps originaire, non déployé encore dans le projet de son futur explicite, brise la trame de
la succession et donne au vide de l’être-là le plein de l’existence significative. De là cette
croyance à l’intemporalité de l’acte qui est à l’origine de toutes les difficultés classiques du
problème de la liberté. Ce moment où le vide de l’être-là apparaît comme rempli ne prend pas
place, comme un événement, dans le temps successif de la conscience banale. Mais comme la
conscience ne déploie pas encore alors devant elle la dialectique historique de son existence
en projet (puisqu’elle vit encore pour la chose-là), elle ne saisit pas non plus ce moment dans
sa valeur de cheminement vers le sens plein de l’existant. Refusant la temporalité banale,
n’accédant pas totalement à son existence originaire, la conscience veut alors se reposer dans
ce moment comme dans ce qui est en soi et pour soi. Au lieu d’assister à la manifestation de
l’acte et d’être par là conscience d’acte, elle se manifeste comme conscience actualisante dans
l’oubli de la condition originaire qui par là pourtant est manifestée. Elle donne alors à
l’existant un pouvoir absolu de se manifester, et, à elle-même, un pouvoir absolu d’inaugurer
cette manifestation. Et cette unité de deux temporalités, par laquelle elle est là, lui apparaît
comme l’anéantissement de toute temporalité. Cette croyance à l’intemporalité n’est pas une
erreur, pas plus qu’elle n’est une vérité. Ce moment où l’être-là se manifeste et où il se remplit
est un moment d’éternité parce qu’il est, par excellence, le moment de la négation. C’est dans
la rupture, dans l’abîme et le néant du temps accepté que se donne ce fond de présence par
quoi toute chose est là. Mais
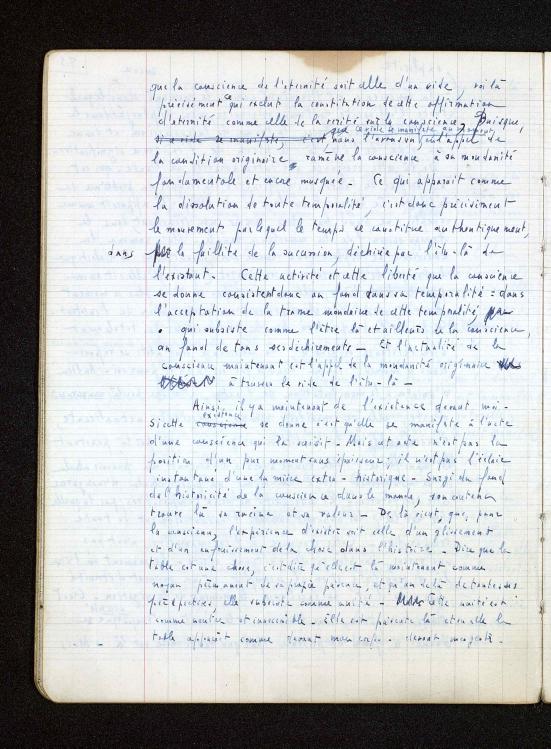 [0034]
que la conscience de l’éternité soit celle d’un vide, voilà
précisément ce qui exclut la constitution de cette affirmation d’éternité comme celle de la
vérité sur la conscience. Puisque nous l’avons vu, ce vide se manifeste au moment où l’appel
de la condition originaire ramène la conscience à sa mondanéité fondamentale encore
masquée. Ce qui apparaît comme la dissolution de toute temporalité, c’est donc précisément le
mouvement par lequel le temps se constitue authentiquement, dans la faillite de la succession,
déchiré par l’être-là de l’existant. Cette activité et cette liberté que la conscience se donne
consistent donc au fond dans sa temporalité : dans l’acceptation de la trame mondaine de cette
temporalité qui subsiste comme l’être-là et ailleurs de la conscience, au fond de tous ses
déchirements. Et l’actualité de la conscience maintenant est l’appel de la mondanéité
originaire à travers le vide de l’être-là.
[0034]
que la conscience de l’éternité soit celle d’un vide, voilà
précisément ce qui exclut la constitution de cette affirmation d’éternité comme celle de la
vérité sur la conscience. Puisque nous l’avons vu, ce vide se manifeste au moment où l’appel
de la condition originaire ramène la conscience à sa mondanéité fondamentale encore
masquée. Ce qui apparaît comme la dissolution de toute temporalité, c’est donc précisément le
mouvement par lequel le temps se constitue authentiquement, dans la faillite de la succession,
déchiré par l’être-là de l’existant. Cette activité et cette liberté que la conscience se donne
consistent donc au fond dans sa temporalité : dans l’acceptation de la trame mondaine de cette
temporalité qui subsiste comme l’être-là et ailleurs de la conscience, au fond de tous ses
déchirements. Et l’actualité de la conscience maintenant est l’appel de la mondanéité
originaire à travers le vide de l’être-là.
Ainsi il y a maintenant de l’existence devant moi. Si cette existence se donne, c’est
qu’elle se manifeste à l’acte d’une conscience qui la saisit. Mais cet acte n’est pas la position
d’un pur moment sans épaisseur ; il n’est pas l’éclair instantané d’une lumière extra-
historique. Surgi du fond de l’historicité de la conscience dans le monde, son contenu trouve
là sa racine et sa valeur. De là vient que, pour la conscience, l’expérience d’exister soit celle
d’un glissement et d’un enfouissement de la chose dans l’histoire. Dire que la table est une
chose, c’est dire qu’elle est là maintenant comme noyau permanent de sa propre présence, et
qu’au-delà de toutes ses perspectives, elle subsiste comme unité. Cette unité est comme neutre
et inaccessible. Elle est présente là et en elle la table apparaît comme devant mon corps,
devant mes gestes,
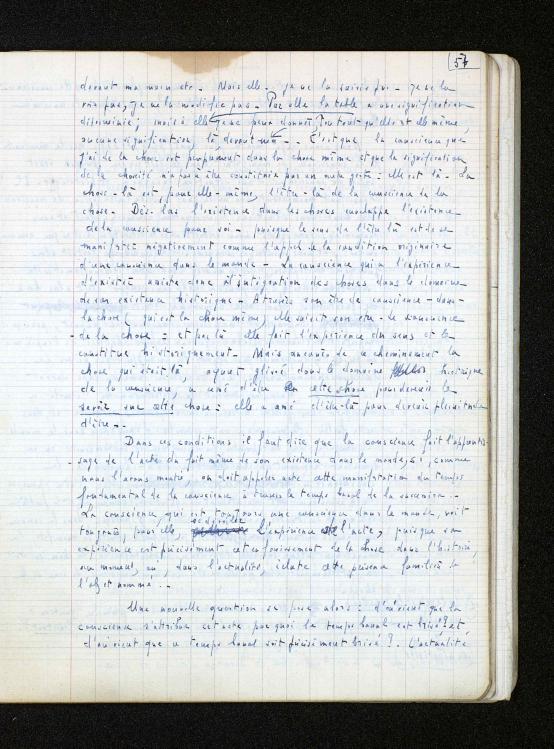 [0035]
devant ma main etc… Mais elle, je ne la saisis pas, je ne la vois pas,
je ne la modifie pas. Par elle la table a une signification déterminée ; mais à elle en tant qu’elle
est elle-même, là devant moi, je ne peux donner aucune signification. C’est que la conscience
que j’ai de la chose est proprement dans la chose même et que la signification de la choséité
n’a pas à être constituée par un autre geste : elle est là. La chose-là est, pour elle-même, l’être-
là de la conscience de la chose. Dès lors l’existence dans les choses enveloppe l’existence de
la conscience pour soi, puisque le sens de l’être-là est de se manifester négativement comme
l’appel de la condition originaire d’une conscience dans le monde. La conscience qui a
l’expérience d’exister assiste donc à l’intégration des choses dans le domaine de son existence
historique. A travers son être de conscience dans la chose (qui est la chose même) elle saisit
son être de conscience de la chose : et par là elle fait l’expérience du sens et le constitue
historiquement. Mais au cours de ce cheminement la chose qui était là, ayant glissé dans le
domaine historique de la conscience, a cessé d’être cette chose pour devenir le savoir sur cette
chose : elle a cessé d’être-là pour devenir plénitude d’être.
[0035]
devant ma main etc… Mais elle, je ne la saisis pas, je ne la vois pas,
je ne la modifie pas. Par elle la table a une signification déterminée ; mais à elle en tant qu’elle
est elle-même, là devant moi, je ne peux donner aucune signification. C’est que la conscience
que j’ai de la chose est proprement dans la chose même et que la signification de la choséité
n’a pas à être constituée par un autre geste : elle est là. La chose-là est, pour elle-même, l’être-
là de la conscience de la chose. Dès lors l’existence dans les choses enveloppe l’existence de
la conscience pour soi, puisque le sens de l’être-là est de se manifester négativement comme
l’appel de la condition originaire d’une conscience dans le monde. La conscience qui a
l’expérience d’exister assiste donc à l’intégration des choses dans le domaine de son existence
historique. A travers son être de conscience dans la chose (qui est la chose même) elle saisit
son être de conscience de la chose : et par là elle fait l’expérience du sens et le constitue
historiquement. Mais au cours de ce cheminement la chose qui était là, ayant glissé dans le
domaine historique de la conscience, a cessé d’être cette chose pour devenir le savoir sur cette
chose : elle a cessé d’être-là pour devenir plénitude d’être.
Dans ces conditions il faut dire que la conscience fait l’apprentissage de l’acte, du fait même de son existence dans le monde, si, comme nous l’avons montré, on doit appeler acte cette manifestation du temps fondamental de la conscience à travers le temps banal de la succession. La conscience, qui est toujours une conscience dans le monde, voit toujours, pour elle, se dévoiler l’expérience de l’acte, puisque son expérience est précisément cet enfouissement de la chose dans l’histoire, au moment où, dans l’actualité, éclate cette présence familière de l’objet nommé.
Une nouvelle question se pose alors : d’où vient que la conscience s’attribue cet acte
par quoi le temps banal est brisé ? Et d’où vient que ce temps banal soit précisément brisé ?
L’actualité
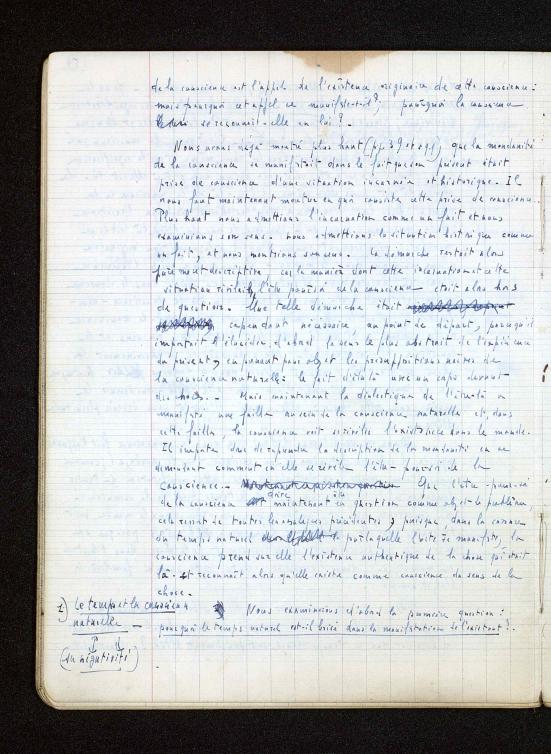 [0036]
de la conscience est l’appel de l’existence originaire de cette conscience :
mais pourquoi cet appel se manifeste-t-il ? Pourquoi la conscience se reconnaît-elle en lui ?
Nous avons déjà montré plus haut (p.39 et sqq) que la mondanéité de la conscience se
manifestait dans le fait que son présent était prise de conscience d’une situation incarnée et
historique. Il nous faut maintenant montrer en quoi consiste cette prise de conscience. Plus
haut nous admettions l’incarnation comme un fait et nous examinions son sens, nous
admettions la situation historique comme un fait, et nous montrions son sens. La démarche
restait alors purement descriptive, car la manière dont cette incarnation et cette situation
historique révélaient l’être pour soi de la conscience était alors hors de question. Une telle
démarche était cependant nécessaire, au point de départ, parce qu’il importait d’élucider
d’abord le sens le plus abstrait de l’expérience du présent, en prenant pour objet les
présuppositions naïves de la conscience naturelle : le fait d’être-là avec un corps devant les
choses. Mais maintenant, la dialectique de l’être-là a manifesté une faille, la conscience voit se
révéler l’existence dans le monde. Il importe donc de reprendre la description de la
mondanéité en se demandant comment en elle se révèle l’être pour soi de la conscience. Que
l’être pour soi de la conscience doive maintenant être en question comme objet et problème,
cela ressort de toutes les analyses précédentes, puisque, dans la cassure du temps naturel par
laquelle l’acte se manifeste, la conscience prend sur elle l’existence authentique de la chose
qui était là et reconnaît alors qu’elle existe comme conscience du sens de la chose.
[0036]
de la conscience est l’appel de l’existence originaire de cette conscience :
mais pourquoi cet appel se manifeste-t-il ? Pourquoi la conscience se reconnaît-elle en lui ?
Nous avons déjà montré plus haut (p.39 et sqq) que la mondanéité de la conscience se
manifestait dans le fait que son présent était prise de conscience d’une situation incarnée et
historique. Il nous faut maintenant montrer en quoi consiste cette prise de conscience. Plus
haut nous admettions l’incarnation comme un fait et nous examinions son sens, nous
admettions la situation historique comme un fait, et nous montrions son sens. La démarche
restait alors purement descriptive, car la manière dont cette incarnation et cette situation
historique révélaient l’être pour soi de la conscience était alors hors de question. Une telle
démarche était cependant nécessaire, au point de départ, parce qu’il importait d’élucider
d’abord le sens le plus abstrait de l’expérience du présent, en prenant pour objet les
présuppositions naïves de la conscience naturelle : le fait d’être-là avec un corps devant les
choses. Mais maintenant, la dialectique de l’être-là a manifesté une faille, la conscience voit se
révéler l’existence dans le monde. Il importe donc de reprendre la description de la
mondanéité en se demandant comment en elle se révèle l’être pour soi de la conscience. Que
l’être pour soi de la conscience doive maintenant être en question comme objet et problème,
cela ressort de toutes les analyses précédentes, puisque, dans la cassure du temps naturel par
laquelle l’acte se manifeste, la conscience prend sur elle l’existence authentique de la chose
qui était là et reconnaît alors qu’elle existe comme conscience du sens de la chose.
1) Le temps et la conscience naturelle (sa négativité).
Nous examinerons d’abord la première question : pourquoi le temps naturel est-il brisé
dans la manifestation de l’existant ?
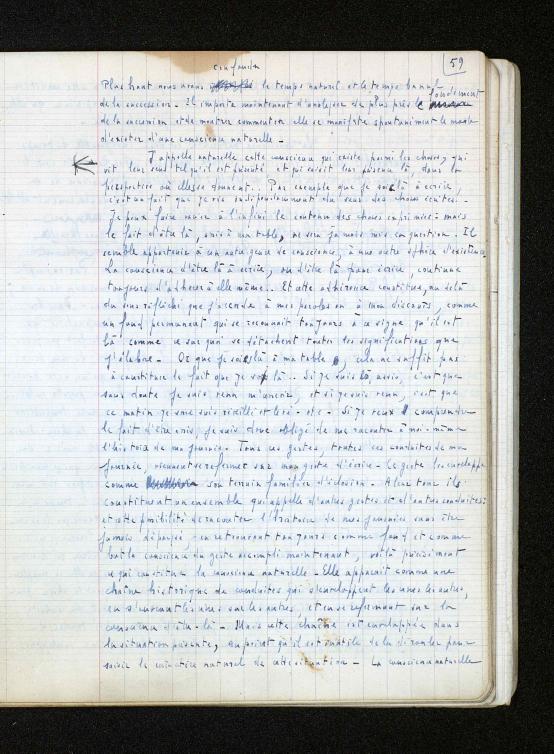 [0037]
Plus haut nous avons confondu le temps naturel et
le temps banal de la succession. Il importe maintenant d’analyser de plus près le fondement de
la succession et de montrer comment en elle se manifeste spontanément le mode d’exister
d’une conscience naturelle.
[0037]
Plus haut nous avons confondu le temps naturel et
le temps banal de la succession. Il importe maintenant d’analyser de plus près le fondement de
la succession et de montrer comment en elle se manifeste spontanément le mode d’exister
d’une conscience naturelle.
J’appelle naturelle cette conscience qui existe parmi les choses, qui vit leur sens tel qu’il
est présenté, et qui saisit leur présence là, dans la perspective où elles se donnent. Par exemple
que je sois là à écrire c’est un fait que je vis indépendamment du sens des choses écrites. Je
peux faire varier à l’infini le contenu des choses exprimées : mais le fait d’être là, assis à ma
table, ne sera jamais mis en question. Il semble appartenir à un autre genre de conscience, à
une autre sphère d’existence. La conscience d’être là à écrire, ou d’être là pour écrire,
continue toujours d’adhérer à elle même. Et cette adhérence constitue, au-delà du sens réfléchi
que j’accorde à mes paroles ou à mon discours, comme un fond permanent qui se reconnaît
toujours à ce signe qui est là comme ce sur quoi se détachent toutes les significations que
j’élabore. Or que je sois là à ma table, cela ne suffit pas à constituer le fait que je sois là. Si je
suis là, assis, c’est que sans doute je suis venu m’asseoir, et si je suis venu, c’est que ce matin
je me suis réveillé et levé etc… Si je veux comprendre le fait d’être assis, je suis donc obligé
de me raconter à moi-même l’histoire de ma journée. Tous ces gestes, toutes ces conduites de
ma journée, viennent se refermer sur mon geste d’écrire. Ce geste les enveloppe comme son
terrain familier d’éclosion. A leur tour, ils constituent un ensemble qui appelle d’autres gestes
et d’autres conduites : et cette possibilité de raconter l’histoire de mes journées sans être
jamais dépaysé, en retrouvant toujours comme fond et comme but la conscience du geste
accompli maintenant, voilà précisément ce qui constitue la conscience naturelle. Elle apparaît
comme une chaîne historique de conduites qui s’enveloppent les unes les autres, en s’ouvrant
les unes sur les autres, et en se refermant sur la conscience d’être-là. Mais cette chaîne est
enveloppée dans la situation présente, au point qu’il est inutile de la dérouler pour saisir le
caractère naturel de cette situation. La conscience naturelle
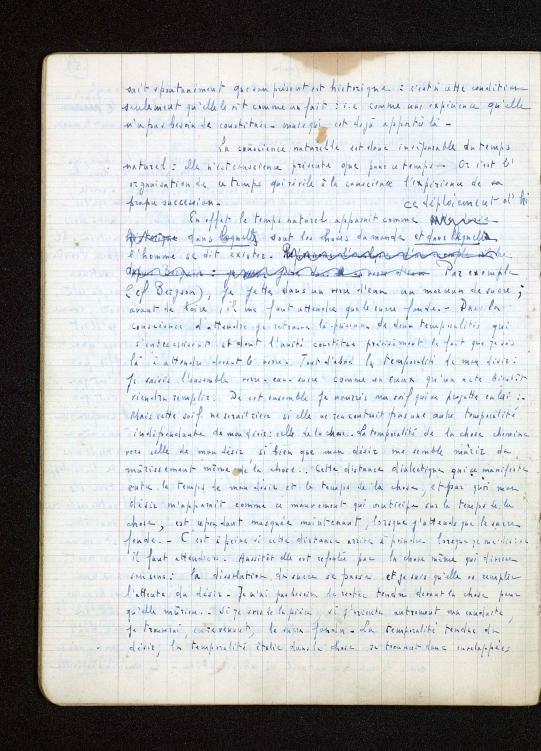 [0038]
sait spontanément que son
présent est historique : c’est à cette condition seulement qu’elle le vit comme un fait : i.e.
comme une expérience qu’elle n’a pas besoin de constituer, mais qui est déjà apportée là.
La conscience naturelle est donc inséparable du temps naturel : elle n’est conscience
présente que pour ce temps. Or c’est l’organisation de ce temps qui révèle à la conscience
l’expérience de sa propre succession.
[0038]
sait spontanément que son
présent est historique : c’est à cette condition seulement qu’elle le vit comme un fait : i.e.
comme une expérience qu’elle n’a pas besoin de constituer, mais qui est déjà apportée là.
La conscience naturelle est donc inséparable du temps naturel : elle n’est conscience
présente que pour ce temps. Or c’est l’organisation de ce temps qui révèle à la conscience
l’expérience de sa propre succession.
En effet, le temps naturel apparaît comme ce déploiement d’histoire dans lequel sont les
choses du monde et dans lequel l’homme se dit exister. Par exemple (cf. Bergson), je jette
dans un verre d’eau un morceau de sucre ; avant de boire, il me faut attendre que le sucre
fonde. Dans la conscience d’attendre je retrouve la présence de deux temporalités qui
s’entrecroisent et dont l’unité constitue précisément le fait que je sois là à attendre devant le
verre. Tout d’abord la temporalité de mon désir : je saisis l’ensemble verre-eau-sucre comme
un creux qu’un acte bientôt viendra remplir. De cet ensemble, je nourris ma soif qui se
projette en lui. Mais cette soif ne serait rien si elle ne rencontrait pas une autre temporalité
indépendante de mon désir : celle de la chose. La temporalité de la chose chemine vers celle
de mon désir, si bien que mon désir me semble mûrir du mûrissement même de la chose. Cette
distance dialectique qui se manifeste entre le temps de mon désir et le temps de la chose, et
par quoi mon désir m’apparaît comme ce mouvement qui anticipe sur le temps de la chose, est
cependant masquée maintenant, lorsque j’attends que le sucre fonde. C’est à peine si cette
distance arrive à poindre lorsque je me dis : “ il faut attendre ”. Aussitôt elle est refoulée par la
chose même qui déverse son sens : la dissolution du sucre se passe et je sais qu’elle va remplir
l’attente du désir. Je n’ai pas besoin de rester tendu devant la chose pour qu’elle mûrisse. Si je
sors de la pièce, si j’oriente autrement ma conduite, je trouverai, en revenant, le sucre fondu.
La temporalité tendue du désir, la temporalité étalée dans la chose se trouvent donc
enveloppées
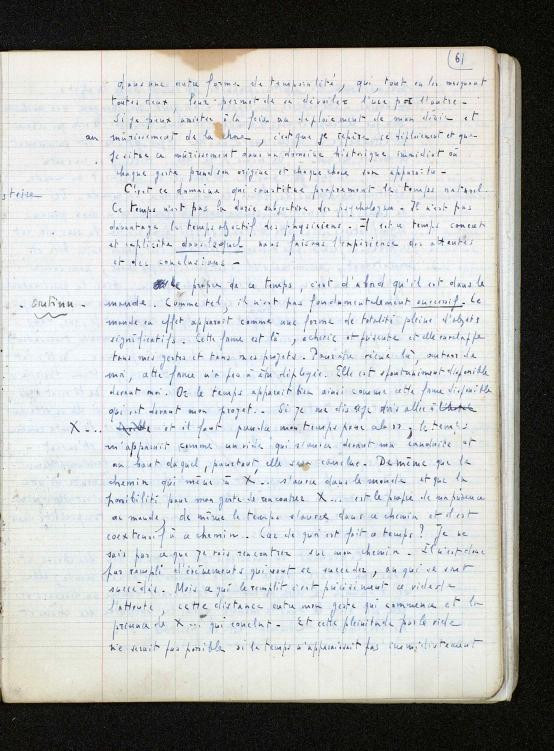 [0039]
dans une autre forme de temporalité, qui, tout en les masquant toutes deux,
leur permet de se dévoiler l’une par l’autre. Si je peux assister à la fois au déploiement de mon
désir et au mûrissement de la chose, c’est que je repère ce déploiement et que je situe ce
mûrissement dans un domaine historique immédiat où chaque geste prend son origine et
chaque chose son apparaître. C’est ce domaine qui constitue proprement le temps naturel. Ce
temps n’est pas la durée subjective des psychologues. Il n’est pas davantage le temps objectif
des physiciens. Il est ce temps concret et implicite dans lequel nous faisons l’expérience des
attentes et des conclusions.
[0039]
dans une autre forme de temporalité, qui, tout en les masquant toutes deux,
leur permet de se dévoiler l’une par l’autre. Si je peux assister à la fois au déploiement de mon
désir et au mûrissement de la chose, c’est que je repère ce déploiement et que je situe ce
mûrissement dans un domaine historique immédiat où chaque geste prend son origine et
chaque chose son apparaître. C’est ce domaine qui constitue proprement le temps naturel. Ce
temps n’est pas la durée subjective des psychologues. Il n’est pas davantage le temps objectif
des physiciens. Il est ce temps concret et implicite dans lequel nous faisons l’expérience des
attentes et des conclusions.
Le propre de ce temps, c’est d’abord qu’il est dans le monde. Comme tel, il n’est pas
fondamentalement successif. Le monde en effet apparaît comme une forme de totalité pleine
d’objets significatifs. Cette forme est là, achevée et présente et elle enveloppe tous mes gestes
et tous mes projets. Pour être vécue là, autour de moi, cette forme n’a pas à être déployée. Elle
est spontanément disponible devant moi. Or le temps apparaît bien ainsi comme cette forme
disponible qui est devant mon projet. Si je me dis “ je dois aller à X et il faut prendre mon
temps pour cela ”, le temps m’apparaît comme un vide qui s’ouvre devant ma conduite et au
bout duquel, pourtant, elle sera conclue. De même que le chemin qui mène à X s’ouvre dans le
monde et que la possibilité pour mon geste de rencontrer X est le propre de ma présence au
monde, de même le temps s’ouvre dans ce chemin et il est coextensif à ce chemin. Car de quoi
est fait ce temps ? Je ne sais pas ce que je vais rencontrer sur mon chemin. Il n’est donc pas
rempli d’évènements qui vont se succéder, ou qui se sont succédés. Mais ce qui le remplit
c’est précisément ce vide de l’attente, cette distance entre mon geste qui commence et la
présence de X qui conclut. Et cette plénitude par le vide ne serait pas possible si le temps
n’apparaissait pas immédiatement
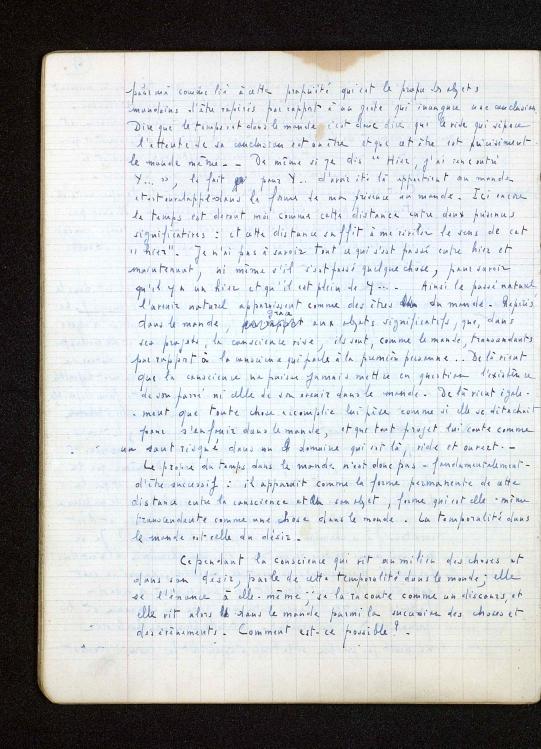 [0040]
pour moi comme lié à cette propriété qui est le propre
des objets mondains d’être repérés par rapport à un geste qui inaugure une conclusion. Dire
que le temps est dans le monde, c’est donc dire que le vide qui sépare l’attente de sa
conclusion est un être et que cet être est précisément le monde même. De même si je dis
“ Hier, j’ai rencontré Y ”, le fait pour Y d’avoir été là appartient au monde et est enveloppé
dans la forme de ma présence au monde. Ici encore le temps est devant moi comme cette
distance entre deux présences significatives, et cette distance suffit à me révéler le sens de cet
“ hier ”. Je n’ai pas à savoir tout ce qui s’est passé entre hier et maintenant, ni même s’il s’est
passé quelque chose, pour savoir qu’il y a un hier et qu’il est plein de Y. Ainsi le passé
naturel, l’avenir naturel apparaissent comme des êtres du monde. Repérés dans le monde grâce
aux objets significatifs que, dans ses projets, la conscience vise, ils sont, comme le monde,
transcendants par rapport à la conscience qui parle à la première personne. De là vient que la
conscience ne puisse jamais mettre en question l’existence de son passé ni celle de son avenir
dans le monde. De là vient également que toute chose accomplie lui pèse comme si elle se
détachait pour s’enfouir dans le monde, et que tout projet lui coûte comme un saut risqué dans
un domaine qui est là, vide et ouvert. Le propre du temps dans le monde n’est donc pas –
fondamentalement – d’être successif : il apparaît comme la forme permanente de cette
distance entre la conscience et son objet, forme qui est elle-même transcendante comme une
chose dans le monde. La temporalité dans le monde est celle du désir.
[0040]
pour moi comme lié à cette propriété qui est le propre
des objets mondains d’être repérés par rapport à un geste qui inaugure une conclusion. Dire
que le temps est dans le monde, c’est donc dire que le vide qui sépare l’attente de sa
conclusion est un être et que cet être est précisément le monde même. De même si je dis
“ Hier, j’ai rencontré Y ”, le fait pour Y d’avoir été là appartient au monde et est enveloppé
dans la forme de ma présence au monde. Ici encore le temps est devant moi comme cette
distance entre deux présences significatives, et cette distance suffit à me révéler le sens de cet
“ hier ”. Je n’ai pas à savoir tout ce qui s’est passé entre hier et maintenant, ni même s’il s’est
passé quelque chose, pour savoir qu’il y a un hier et qu’il est plein de Y. Ainsi le passé
naturel, l’avenir naturel apparaissent comme des êtres du monde. Repérés dans le monde grâce
aux objets significatifs que, dans ses projets, la conscience vise, ils sont, comme le monde,
transcendants par rapport à la conscience qui parle à la première personne. De là vient que la
conscience ne puisse jamais mettre en question l’existence de son passé ni celle de son avenir
dans le monde. De là vient également que toute chose accomplie lui pèse comme si elle se
détachait pour s’enfouir dans le monde, et que tout projet lui coûte comme un saut risqué dans
un domaine qui est là, vide et ouvert. Le propre du temps dans le monde n’est donc pas –
fondamentalement – d’être successif : il apparaît comme la forme permanente de cette
distance entre la conscience et son objet, forme qui est elle-même transcendante comme une
chose dans le monde. La temporalité dans le monde est celle du désir.
Cependant la conscience qui vit au milieu des choses et dans son désir parle de cette
temporalité dans le monde ; elle se l’énonce à elle-même ; se la raconte comme un discours, et
elle vit alors dans le monde parmi la succession des choses et des évènements. Comment est-
ce possible ?
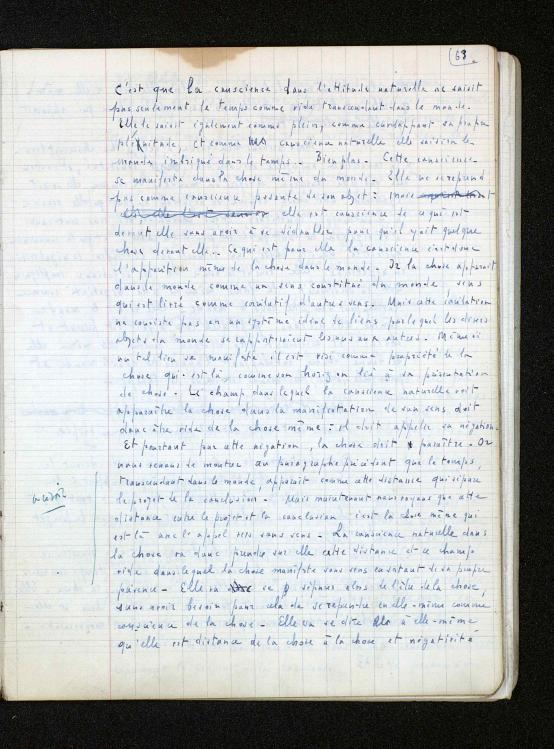 [0041]
C’est que la conscience dans l’attitude naturelle ne saisit pas seulement le temps comme
vide transcendant dans le monde. Elle le saisit également comme plein, comme enveloppant sa
propre plénitude, et comme conscience naturelle elle saisira le monde imbriqué dans le temps.
Bien plus. Cette conscience se manifeste dans la chose même du monde. Elle ne se reprend
pas comme conscience posante de son objet : mais elle est conscience de ce qui est devant elle
sans avoir à se dédoubler pour qu’il y ait quelque chose devant elle. Ce qui est pour elle la
conscience, c’est donc l’apparition même de la chose dans le monde. Or la chose apparaît dans
le monde comme un sens constitué du monde, sens qui est livré comme corrélatif d’autres
sens. Mais cette corrélation ne consiste pas en un système idéal de liens par lequel les divers
objets du monde se rapporteraient les uns aux autres. Même si un tel lien se manifeste, il est
visé comme propriété de la chose qui est là, comme son horizon lié à sa présentation de chose.
Le champ dans lequel la conscience naturelle voit apparaître la chose dans la manifestation de
son sens doit donc être vide de la chose même : il doit appeler sa négation. Et pourtant par
cette négation, la chose doit paraître. Or nous venons de montrer au paragraphe précédent que
le temps, transcendant dans le monde, apparaît comme cette distance qui sépare le projet de la
conclusion. Mais maintenant nous voyons que cette distance entre le projet et la conclusion
c’est la chose même qui est là avec l’appel vers son sens. La conscience naturelle dans la
chose va donc prendre sur elle cette distance et ce champ vide dans lequel la chose manifeste
son sens en sortant de sa propre présence.
[0041]
C’est que la conscience dans l’attitude naturelle ne saisit pas seulement le temps comme
vide transcendant dans le monde. Elle le saisit également comme plein, comme enveloppant sa
propre plénitude, et comme conscience naturelle elle saisira le monde imbriqué dans le temps.
Bien plus. Cette conscience se manifeste dans la chose même du monde. Elle ne se reprend
pas comme conscience posante de son objet : mais elle est conscience de ce qui est devant elle
sans avoir à se dédoubler pour qu’il y ait quelque chose devant elle. Ce qui est pour elle la
conscience, c’est donc l’apparition même de la chose dans le monde. Or la chose apparaît dans
le monde comme un sens constitué du monde, sens qui est livré comme corrélatif d’autres
sens. Mais cette corrélation ne consiste pas en un système idéal de liens par lequel les divers
objets du monde se rapporteraient les uns aux autres. Même si un tel lien se manifeste, il est
visé comme propriété de la chose qui est là, comme son horizon lié à sa présentation de chose.
Le champ dans lequel la conscience naturelle voit apparaître la chose dans la manifestation de
son sens doit donc être vide de la chose même : il doit appeler sa négation. Et pourtant par
cette négation, la chose doit paraître. Or nous venons de montrer au paragraphe précédent que
le temps, transcendant dans le monde, apparaît comme cette distance qui sépare le projet de la
conclusion. Mais maintenant nous voyons que cette distance entre le projet et la conclusion
c’est la chose même qui est là avec l’appel vers son sens. La conscience naturelle dans la
chose va donc prendre sur elle cette distance et ce champ vide dans lequel la chose manifeste
son sens en sortant de sa propre présence.
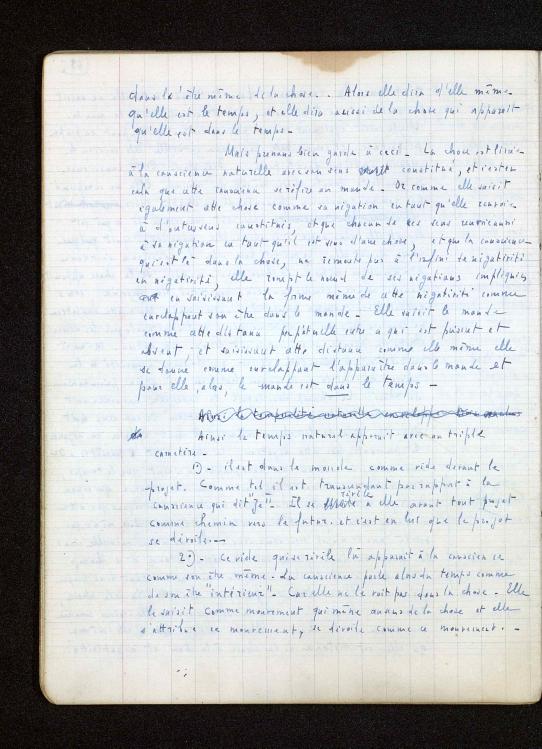 [0042]
dans l’être
même de la chose. Alors elle dira d’elle même qu’elle est le temps, et elle dira aussi de la
chose qui apparaît qu’elle est le temps.
[0042]
dans l’être
même de la chose. Alors elle dira d’elle même qu’elle est le temps, et elle dira aussi de la
chose qui apparaît qu’elle est le temps.
Mais prenons bien garde à ceci. La chose est livrée à la conscience naturelle avec son sens constitué, et c’est en cela que cette conscience se réfère au monde. Or comme elle saisit également cette chose comme sa négation en tant qu’elle renvoie à d’autres sens constitués, et que chacun de ces sens renvoie aussi à sa négation en tant qu’il est sens d’une chose, et que la conscience qui est là dans la chose ne remonte pas à l’infini de négativité en négativité, elle rompt le nœud de ses négations impliquées en saisissant la forme même de cette négation comme enveloppant son être dans le monde. Elle saisit le monde comme cette distance perpétuelle entre ce qui est présente et absent, et saisissant cette distance comme elle-même, elle se donne comme enveloppant l’apparaître dans le monde et pour elle, alors, le monde est dans le temps.
Ainsi le temps naturel apparaît avec un triple caractère.
1°) Il est dans le monde comme vide devant le projet. Comme tel il est transcendant par rapport à la conscience qui dit “ je ”. Il se révèle à elle avant tout projet comme chemin vers le futur et c’est en lui que le projet se dévoile.
2°) Ce vide qui se révèle là apparaît à la conscience comme son être même. La conscience parle alors du temps comme de son être “ intérieur ”. Car elle ne le voit pas dans la chose. Elle le saisit comme mouvement qui mène au sens de la chose et elle s’attribue ce mouvement, se dévoile comme ce mouvement.
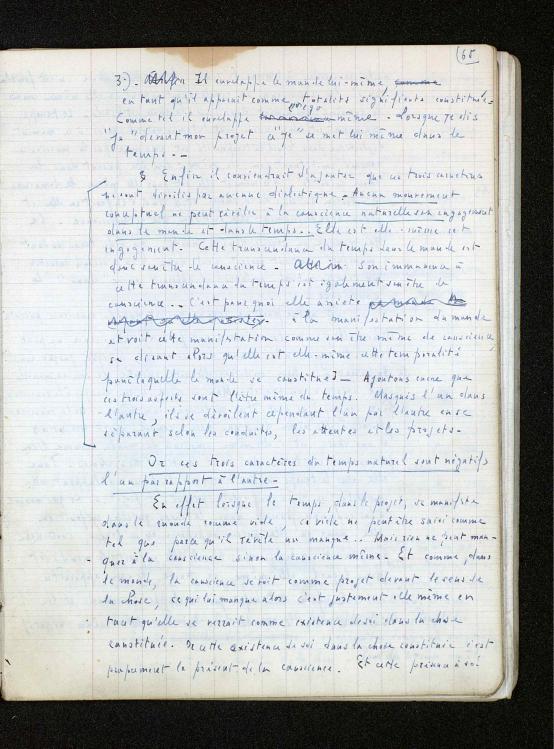 [0043]
3°) Il enveloppe le monde lui-même, en tant qu’il apparaît comme totalité signifiante
constituée. Comme tel il enveloppe l’ego même. Lorsque je dis “ je ” devant mon projet ce
“ je ” se met lui-même dans le temps.
[0043]
3°) Il enveloppe le monde lui-même, en tant qu’il apparaît comme totalité signifiante
constituée. Comme tel il enveloppe l’ego même. Lorsque je dis “ je ” devant mon projet ce
“ je ” se met lui-même dans le temps.
Enfin il conviendrait d’ajouter que ces trois caractères ne sont dévoilés par aucune dialectique. Aucun mouvement conceptuel ne peut révéler à la conscience naturelle son engagement dans le monde et dans le temps. Elle est elle-même cet engagement. Cette transcendance du temps dans le monde est donc son être de conscience. Son immanence à cette transcendance du temps est également son être de conscience. C’est pourquoi elle assiste à la manifestation du monde et voit cette manifestation comme son être même de conscience, se disant alors qu’elle est elle-même cette temporalité pour laquelle le monde se constitue. Ajoutons encore que ces trois aspects sont l’être même du temps. Masqués l’un dans l’autre, ils se dévoilent cependant l’un par l’autre en se séparant selon les conduites, les attentes et les projets.
Or ces trois caractères du temps naturel sont négatifs l’un par rapport à l’autre.
En effet lorsque le temps, dans le projet, se manifeste dans le monde comme vide, ce vide
ne peut être saisi comme tel que parce qu’il révèle un manque. Mais rien ne peut manquer à la
conscience sinon la conscience même. Et comme, dans le monde, la conscience se voit comme
projet devant le sens de la chose, ce qui lui manque alors c’est justement elle-même en tant
qu’elle se verrait comme existence de soi dans la chose constituée. Or cette existence de soi
dans la chose constituée c’est proprement le présent de la conscience. Et cette présence à soi
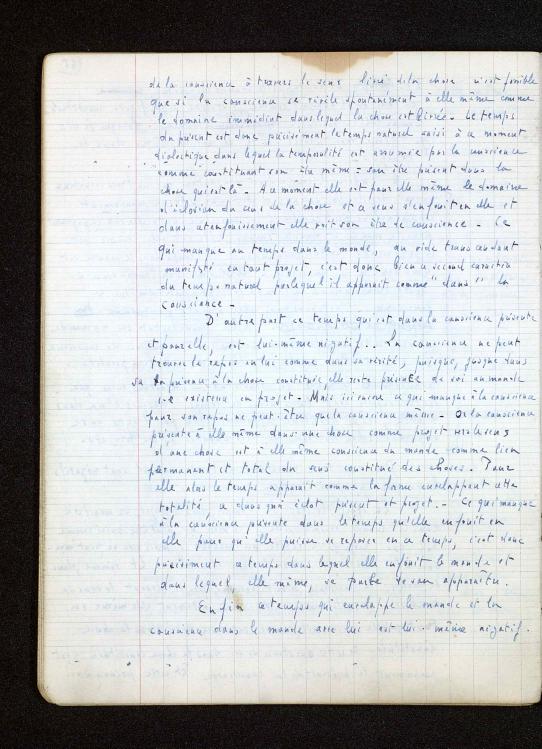 [0044]
de la conscience à travers le sens livré de la chose n’est possible que si la conscience se
révèle spontanément à elle-même comme le domaine immédiat dans lequel la chose est livrée.
Le temps du présent est donc précisément le temps naturel saisi à ce moment dialectique dans
lequel la temporalité est assumée par la conscience comme constituant son être même : son
être présent dans la chose qui est là. A ce moment elle est pour elle-même le domaine
d’éclosion du sens de la chose et ce sens s’enfouit en elle et dans cet enfouissement elle voit
son être de conscience. Ce qui manque au temps dans le monde, au vide transcendant
manifesté en tout projet, c’est donc bien ce second caractère du temps naturel par lequel il
apparaît comme “ dans ” la conscience.
[0044]
de la conscience à travers le sens livré de la chose n’est possible que si la conscience se
révèle spontanément à elle-même comme le domaine immédiat dans lequel la chose est livrée.
Le temps du présent est donc précisément le temps naturel saisi à ce moment dialectique dans
lequel la temporalité est assumée par la conscience comme constituant son être même : son
être présent dans la chose qui est là. A ce moment elle est pour elle-même le domaine
d’éclosion du sens de la chose et ce sens s’enfouit en elle et dans cet enfouissement elle voit
son être de conscience. Ce qui manque au temps dans le monde, au vide transcendant
manifesté en tout projet, c’est donc bien ce second caractère du temps naturel par lequel il
apparaît comme “ dans ” la conscience.
D’autre part ce temps qui est dans la conscience présente et pour elle est lui-même négatif. La conscience ne peut trouver le repos en lui comme dans sa vérité, puisque, jusque dans sa présence à la chose constituée, elle reste présence de soi au monde i.e. existence en projet. Mais ici encore ce qui manque à la conscience pour son repos ne peut être que la conscience même. Or la conscience présente à elle-même dans une chose comme projet vers le sens d’une chose est à elle-même conscience du monde, comme lien permanent et total du sens constitué des choses. Pour elle alors le temps apparaît comme la forme enveloppant cette totalité, ce dans quoi éclosent présent et projet. Ce qui manque à la conscience présente dans le temps qu’elle enfouit en elle pour qu’elle puisse se reposer en ce temps, c’est donc précisément ce temps dans lequel elle enfouit le monde et dans lequel, elle-même, se parle de son apparaître. Enfin ce temps qui enveloppe le monde et la conscience dans le monde avec lui est lui- même négatif.
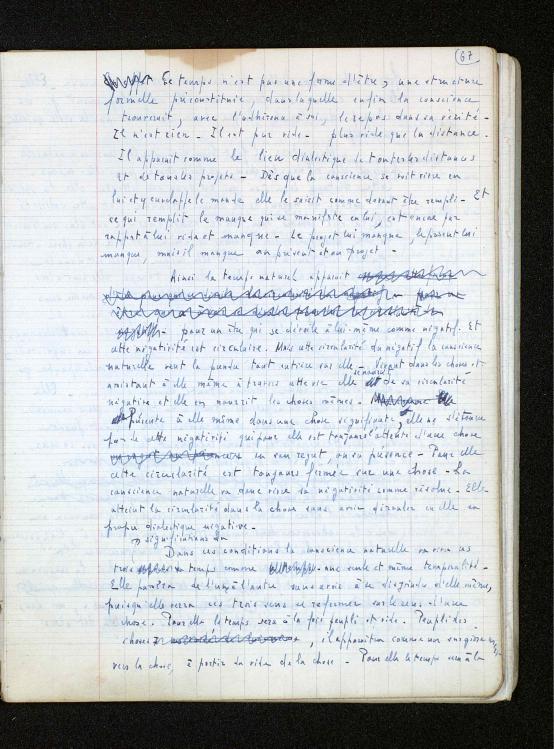 [0045]
Ce temps n’est pas une forme d’être, une structure formelle pré-constituée, dans laquelle enfin la conscience trouverait, avec l’adhérence à soi, le repos dans
sa vérité. Il n’est rien. Il est pur vide, plus vide que la distance. Il apparaît comme le lien
dialectique de toutes les distances et de tous les projets. Dès que la conscience se voit vivre en
lui et y enveloppe le monde, elle le saisit comme devant être rempli. Et ce qui remplit le
manque qui se manifeste en lui, est encore par rapport à lui vide et manque. Le projet lui
manque, le présent lui manque, mais il manque au présent et au projet.
[0045]
Ce temps n’est pas une forme d’être, une structure formelle pré-constituée, dans laquelle enfin la conscience trouverait, avec l’adhérence à soi, le repos dans
sa vérité. Il n’est rien. Il est pur vide, plus vide que la distance. Il apparaît comme le lien
dialectique de toutes les distances et de tous les projets. Dès que la conscience se voit vivre en
lui et y enveloppe le monde, elle le saisit comme devant être rempli. Et ce qui remplit le
manque qui se manifeste en lui, est encore par rapport à lui vide et manque. Le projet lui
manque, le présent lui manque, mais il manque au présent et au projet.
Ainsi le temps naturel apparaît pour un être qui se dévoile à lui-même comme négatif. Et cette négativité est circulaire. Mais cette circularité du négatif la conscience naturelle veut la prendre tout entière sur elle. Vivant dans les choses et assistant à elle-même à travers cette vie elle se nourrit de sa circularité négative et elle en nourrit les choses mêmes. Présente à elle- même dans une chose signifiante, elle ne s’étonne pas de cette négativité qui pour elle est toujours l’attente d’une chose, ou son regret, ou sa présence. Pour elle cette circularité est toujours fermée sur une chose. La conscience naturelle va donc vivre sa négativité comme résolue. Elle atteint la circularité dans la chose sans avoir déroulé en elle sa propre dialectique négative.
Dans ces conditions la conscience naturelle va vivre ces trois significations du temps
comme une seule et même temporalité. Elle passera de l’une à l’autre sans avoir à se
disjoindre d’elle-même, puisqu’elle verra ces trois sens se refermer sur le sens d’une chose.
Pour elle le temps sera à la fois peuplé et vide. Peuplé des choses, il apparaîtra comme un
surgissement vers la chose, à partir du vide de la chose. Pour elle le temps sera à la
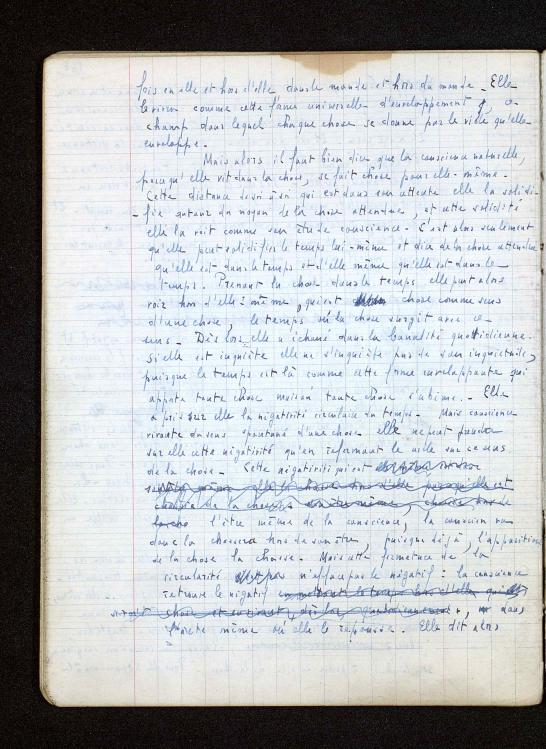 [0046]
fois en elle et hors d’elle, dans le monde et hors du monde. Elle le vivra comme cette forme
universelle d’enveloppement, ce champ dans lequel chaque chose se donne par le vide qu’elle
enveloppe.
[0046]
fois en elle et hors d’elle, dans le monde et hors du monde. Elle le vivra comme cette forme
universelle d’enveloppement, ce champ dans lequel chaque chose se donne par le vide qu’elle
enveloppe.
Mais alors il faut bien dire que la conscience naturelle, parce qu’elle vit dans la chose, se
fait chose pour elle-même. Cette distance de soi à soi qui est dans son attente, elle la solidifie
autour du noyau de la chose attendue, et cette solidité, elle la voit comme son être de
conscience. C’est alors seulement qu’elle peut solidifier le temps lui-même et dire de la chose
attendue qu’elle est dans le temps et d’elle-même qu’elle est dans le temps. [Prenant la chose
dans le temps, qui est chose comme sens d’une chose, elle peut alors voir hors d’elle-même le
temps où la chose surgit avec ce sens]. Dès lors elle a échoué dans la banalité quotidienne. Si
elle est inquiète, elle ne s’inquiète pas de son inquiétude, puisque le temps est là comme cette
forme enveloppante qui apporte toute chose mais où toute chose s’abîme. Elle a pris sur elle la
négativité circulaire du temps. Mais conscience vivante du sens spontané d’une chose, elle ne
peut prendre sur elle cette négativité qu’en refermant le cercle sur ce sens de la chose. Cette
négativité qui est l’être même de la conscience, la conscience va donc la chasser hors de son
être, puisque déjà, l’apparition de la chose la chasse. Mais cette fermeture de la circularité
n’efface pas le négatif : la conscience retrouve le négatif dans l’acte même où elle le repousse.
Elle dit alors
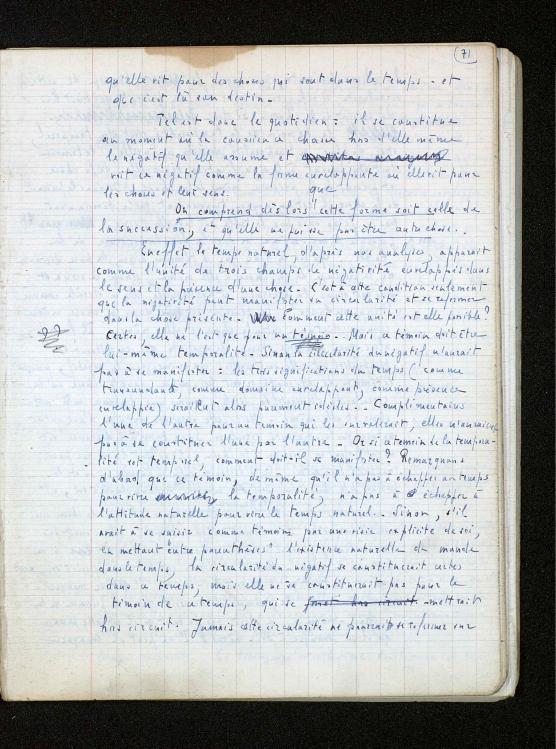 [0047]
2
qu’elle vit pour des choses qui sont dans le temps et que c’est là son destin.
[0047]
2
qu’elle vit pour des choses qui sont dans le temps et que c’est là son destin.
Tel est donc le quotidien : il se constitue au moment où la conscience chasse hors d’elle- même le négatif qu’elle assume et voit ce négatif comme la forme enveloppante où elle vit pour les choses et leurs sens.
On comprend dès lors que cette forme soit celle de la succession, et qu’elle ne puisse pas être autre chose.
En effet, le temps naturel, d’après nos analyses, apparaît comme l’unité de trois champs de
négativités enveloppés dans le sens et la présence d’une chose. C’est à cette condition
seulement que la négativité peut manifester sa circularité et se refermer dans la chose présente.
Comment cette unité est-elle possible ? Certes, elle ne l’est que pour un témoin. Mais ce
témoin doit être lui-même temporalité. Sinon la circularité du négatif n’aurait pas à se
manifester : les trois significations du temps (comme transcendant, comme domaine
enveloppant, comme présence enveloppée) seraient alors purement idéales. Complémentaires
l’une de l’autre pour un témoin qui les survolerait, elles n’auraient pas à se constituer l’une par
l’autre. Or si ce témoin de la temporalité est temporel, comment doit-il se manifester ?
Remarquons d’abord que ce témoin, de même qu’il n’a pas à échapper au temps pour vivre la
temporalité, n’a pas à échapper à l’attitude naturelle pour vivre le temps naturel. Sinon, s’il
avait à se saisir comme témoin par une visée explicite de soi, en mettant “ entre parenthèses ”
l’existence naturelle du monde dans le temps, la circularité du négatif se constituerait certes
dans ce temps, mais elle ne se constituerait pas pour le témoin de ce temps, qui se mettrait
hors circuit. Jamais cette circularité ne pourrait se refermer sur
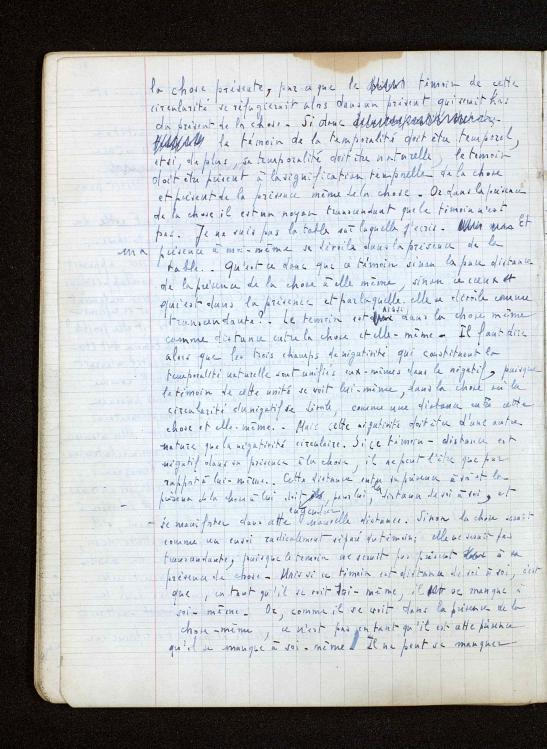 [0048]
la chose présente, parce
que le témoin de cette circularité se réfugierait alors dans un présent qui serait hors du présent
de la chose. Si donc le témoin de la temporalité doit être temporel et si, de plus, sa temporalité
doit être naturelle, le témoin doit être présent à la signification temporelle de la chose et
présent de la présence même de la chose. Or dans la présence de la chose, il est un noyau
transcendant que le témoin n’est pas. Je ne suis pas la table sur laquelle j’écris. Et ma présence
à moi-même se dévoile dans la présence de la table. Qu’est-ce donc que ce témoin sinon la
pure distance de la présence de la chose à elle-même, sinon ce creux qui est dans la présence
et par laquelle elle se dévoile comme transcendante ? Le témoin est ainsi dans la chose même
comme distance entre la chose et elle-même. Il faut dire alors que les trois champs de
négativité qui constituent la temporalité naturelle sont unifiés eux-mêmes dans le négatif,
puisque le témoin de cette unité se voit lui-même, dans la chose où la circularité du négatif se
dévoile, comme une distance entre cette chose et elle-même. Mais cette négativité doit être
d’une autre nature que la négativité circulaire. Si ce témoin-distance est négatif dans sa
présence à la chose, il ne peut l’être que par rapport à lui-même. Cette distance entre sa
présence à soi et la présence de la chose à lui doit engendrer, pour lui, la distance de soi à soi,
et se manifester dans cette nouvelle distance. Sinon la chose serait comme un en soi
radicalement séparé du témoin : elle ne serait pas transcendante, puisque le témoin ne serait
pas présent à sa présence de chose. Mais si ce témoin est distance de soi à soi, c’est que, en
tant qu’il se voit soi-même, il se manque à soi-même. Or, comme il se croit dans la présence
de la chose même, ce n’est pas en tant qu’il est cette présence qu’il se manque à soi. Il ne peut
se manquer
[0048]
la chose présente, parce
que le témoin de cette circularité se réfugierait alors dans un présent qui serait hors du présent
de la chose. Si donc le témoin de la temporalité doit être temporel et si, de plus, sa temporalité
doit être naturelle, le témoin doit être présent à la signification temporelle de la chose et
présent de la présence même de la chose. Or dans la présence de la chose, il est un noyau
transcendant que le témoin n’est pas. Je ne suis pas la table sur laquelle j’écris. Et ma présence
à moi-même se dévoile dans la présence de la table. Qu’est-ce donc que ce témoin sinon la
pure distance de la présence de la chose à elle-même, sinon ce creux qui est dans la présence
et par laquelle elle se dévoile comme transcendante ? Le témoin est ainsi dans la chose même
comme distance entre la chose et elle-même. Il faut dire alors que les trois champs de
négativité qui constituent la temporalité naturelle sont unifiés eux-mêmes dans le négatif,
puisque le témoin de cette unité se voit lui-même, dans la chose où la circularité du négatif se
dévoile, comme une distance entre cette chose et elle-même. Mais cette négativité doit être
d’une autre nature que la négativité circulaire. Si ce témoin-distance est négatif dans sa
présence à la chose, il ne peut l’être que par rapport à lui-même. Cette distance entre sa
présence à soi et la présence de la chose à lui doit engendrer, pour lui, la distance de soi à soi,
et se manifester dans cette nouvelle distance. Sinon la chose serait comme un en soi
radicalement séparé du témoin : elle ne serait pas transcendante, puisque le témoin ne serait
pas présent à sa présence de chose. Mais si ce témoin est distance de soi à soi, c’est que, en
tant qu’il se voit soi-même, il se manque à soi-même. Or, comme il se croit dans la présence
de la chose même, ce n’est pas en tant qu’il est cette présence qu’il se manque à soi. Il ne peut
se manquer
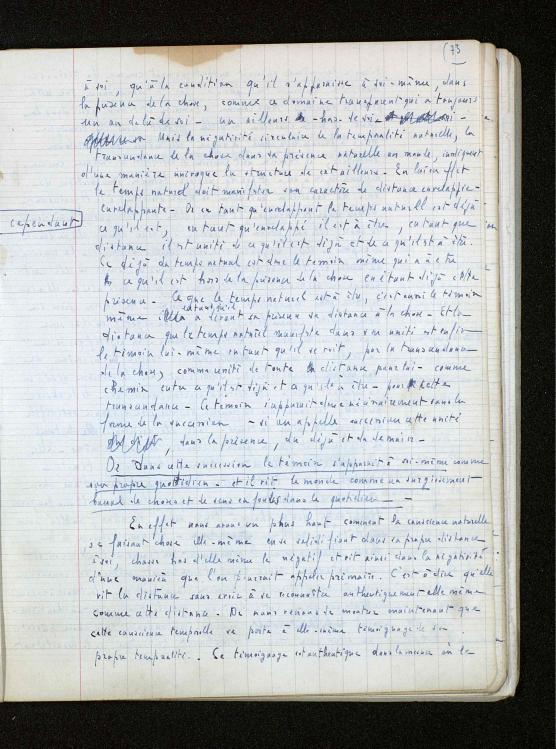 [0049]
à soi, qu’à la condition qu’il s’apparaisse à soi-même, dans la présence de la
chose, comme ce domaine transparent qui a toujours un au-delà de soi, un ailleurs, hors de soi.
Mais la négativité circulaire de la temporalité naturelle, la transcendance de la chose dans sa
présence naturelle au monde, indiquent d’une manière univoque la structure de cet ailleurs. En
lui en effet le temps naturel doit manifester son caractère de distance enveloppée-
enveloppante. Or en tant qu’enveloppant le temps naturel est déjà ce qu’il est, en tant
qu’enveloppé il est à être, en tant que distance il est unité de ce qu’il est déjà et de ce qu’il est
à être. Ce déjà du temps naturel est donc le témoin même qui a à être ce qu’il est hors de la
présence de la chose en étant déjà cette présence. Ce que le temps naturel est à être, c’est aussi
le témoin même en tant qu’il a devant sa présence sa distance à la chose. Et la distance que le
temps naturel manifeste dans son unité est enfin le témoin lui-même en tant qu’il se voit, par
la transcendance de la chose, comme unité de toute distance pour lui, comme chemin entre ce
qu’il est déjà et ce qu’il a à être, pour cette transcendance. Ce témoin s’apparaît donc
nécessairement sous la forme de la succession, si on appelle succession cette unité, dans la
présence, du déjà et du demain.
[0049]
à soi, qu’à la condition qu’il s’apparaisse à soi-même, dans la présence de la
chose, comme ce domaine transparent qui a toujours un au-delà de soi, un ailleurs, hors de soi.
Mais la négativité circulaire de la temporalité naturelle, la transcendance de la chose dans sa
présence naturelle au monde, indiquent d’une manière univoque la structure de cet ailleurs. En
lui en effet le temps naturel doit manifester son caractère de distance enveloppée-
enveloppante. Or en tant qu’enveloppant le temps naturel est déjà ce qu’il est, en tant
qu’enveloppé il est à être, en tant que distance il est unité de ce qu’il est déjà et de ce qu’il est
à être. Ce déjà du temps naturel est donc le témoin même qui a à être ce qu’il est hors de la
présence de la chose en étant déjà cette présence. Ce que le temps naturel est à être, c’est aussi
le témoin même en tant qu’il a devant sa présence sa distance à la chose. Et la distance que le
temps naturel manifeste dans son unité est enfin le témoin lui-même en tant qu’il se voit, par
la transcendance de la chose, comme unité de toute distance pour lui, comme chemin entre ce
qu’il est déjà et ce qu’il a à être, pour cette transcendance. Ce témoin s’apparaît donc
nécessairement sous la forme de la succession, si on appelle succession cette unité, dans la
présence, du déjà et du demain.
Or dans cette succession le témoin s’apparaît à soi-même comme son propre quotidien et
il vit le monde comme un surgissement banal de choses et de sens en foules dans le quotidien.
En effet nous avons vu plus haut comment la conscience naturelle, se faisant chose elle-
même en se solidifiant dans sa propre distance à soi, chasse hors d’elle-même le négatif et vit
ainsi dans la négativité d’une manière que l’on pourrait appeler primaire. C'est-à-dire qu’elle
vit la distance sans avoir à se reconnaître authentiquement elle-même comme cette distance.
Or nous venons de montrer maintenant que cette conscience temporelle se porte à elle-même
témoignage de sa propre temporalité. Ce témoignage est authentique dans la mesure où le
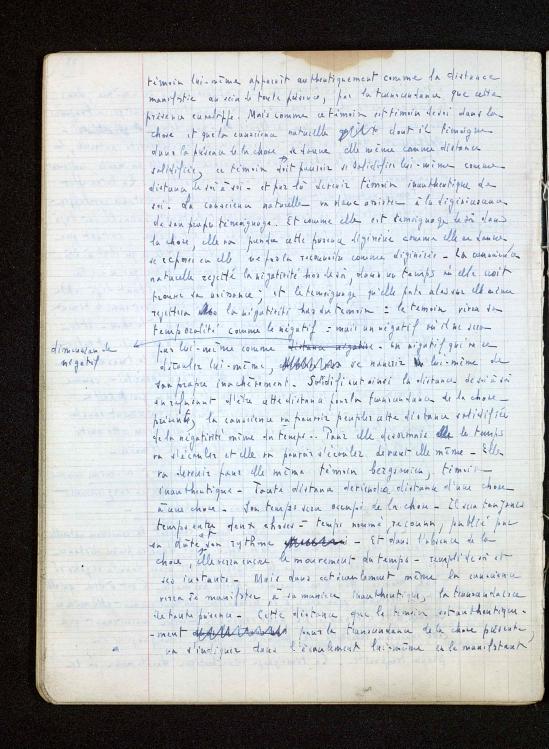 [0050]
témoin lui-même apparaît authentiquement comme la distance manifeste au sein de
toute présence, par la transcendance que cette présence enveloppe. Mais comme ce témoin est
témoin de soi dans la chose et que la conscience naturelle dont il témoigne dans la présence de
la chose se donne elle-même comme distance solidifiée, ce témoin doit pouvoir se solidifier
lui-même comme distance de soi à soi – et par là devenir témoin inauthentique de soi. La
conscience naturelle va donc assister à la dégénérescence de son propre témoignage. Et
comme elle est témoignage de soi dans la chose, elle va prendre cette présence dégénérée
comme elle se donne, se reposer en elle, ne pas la reconnaître comme dégénérée. La
conscience naturelle rejette la négativité hors de soi, dans un temps où elle croit trouver sa
naissance ; et le témoignage qu’elle porte alors sur elle-même rejettera la négativité hors du
témoin : le témoin vivra sa temporalité comme le négatif : mais un négatif où il ne sera pas
lui-même comme dimension du négatif, un négatif qui va se dérouler lui-même, se nourrir lui-
même de son propre inachèvement. Solidifiant ainsi la distance de soi à soi en refusant d’être
cette distance pour la transcendance de la chose présente, la conscience va pouvoir peupler
cette distance solidifiée de la négativité même du temps. Pour elle désormais le temps va
s’écouler et elle va pouvoir s’écouler devant elle-même. Elle va devenir pour elle-même
témoin bergsonien, témoin inauthentique. Tout distance deviendra distance d’une chose à une
chose. Son temps sera occupé de la chose. Il sera toujours temps entre deux choses : temps
nommé, reconnu, publié par sa date et son rythme. Et dans l’absence de la chose, elle verra
encore le mouvement du temps rempli de soi et ses instants. Mais dans cet écoulement même
la conscience verra se manifester, à sa manière inauthentique, la transcendance de toute
présence. Cette distance que le témoin est authentiquement pour la transcendance de la chose
présente, va s’indiquer dans l’écoulement lui-même en le manifestant
[0050]
témoin lui-même apparaît authentiquement comme la distance manifeste au sein de
toute présence, par la transcendance que cette présence enveloppe. Mais comme ce témoin est
témoin de soi dans la chose et que la conscience naturelle dont il témoigne dans la présence de
la chose se donne elle-même comme distance solidifiée, ce témoin doit pouvoir se solidifier
lui-même comme distance de soi à soi – et par là devenir témoin inauthentique de soi. La
conscience naturelle va donc assister à la dégénérescence de son propre témoignage. Et
comme elle est témoignage de soi dans la chose, elle va prendre cette présence dégénérée
comme elle se donne, se reposer en elle, ne pas la reconnaître comme dégénérée. La
conscience naturelle rejette la négativité hors de soi, dans un temps où elle croit trouver sa
naissance ; et le témoignage qu’elle porte alors sur elle-même rejettera la négativité hors du
témoin : le témoin vivra sa temporalité comme le négatif : mais un négatif où il ne sera pas
lui-même comme dimension du négatif, un négatif qui va se dérouler lui-même, se nourrir lui-
même de son propre inachèvement. Solidifiant ainsi la distance de soi à soi en refusant d’être
cette distance pour la transcendance de la chose présente, la conscience va pouvoir peupler
cette distance solidifiée de la négativité même du temps. Pour elle désormais le temps va
s’écouler et elle va pouvoir s’écouler devant elle-même. Elle va devenir pour elle-même
témoin bergsonien, témoin inauthentique. Tout distance deviendra distance d’une chose à une
chose. Son temps sera occupé de la chose. Il sera toujours temps entre deux choses : temps
nommé, reconnu, publié par sa date et son rythme. Et dans l’absence de la chose, elle verra
encore le mouvement du temps rempli de soi et ses instants. Mais dans cet écoulement même
la conscience verra se manifester, à sa manière inauthentique, la transcendance de toute
présence. Cette distance que le témoin est authentiquement pour la transcendance de la chose
présente, va s’indiquer dans l’écoulement lui-même en le manifestant
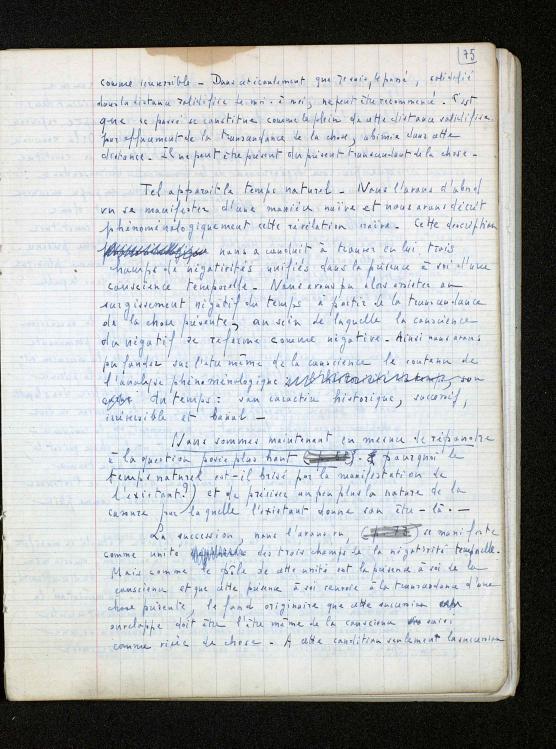 [0051]
comme irréversible. Dans cet écoulement que je suis, le passé, solidifié dans la distance solidifiée de
moi à moi, ne peut être recommencé. C’est que ce passé se constitue comme le plein de cette
distance solidifiée par effacement de la transcendance de la chose, abîmée dans cette distance.
Il ne peut être présent du présent transcendant de la chose.
[0051]
comme irréversible. Dans cet écoulement que je suis, le passé, solidifié dans la distance solidifiée de
moi à moi, ne peut être recommencé. C’est que ce passé se constitue comme le plein de cette
distance solidifiée par effacement de la transcendance de la chose, abîmée dans cette distance.
Il ne peut être présent du présent transcendant de la chose.
Tel apparaît le temps naturel. Nous l’avons d’abord vu se manifester d’une manière naïve et nous avons décrit phénoménologiquement cette révélation naïve. Cette description nous a conduit à trouver en lui trois champs de négativités unifiés dans la présence à soi d’une conscience temporelle. Nous avons pu alors assister au surgissement négatif du temps à partir de la transcendance de la chose présente, au sein de laquelle la conscience du négatif se referme comme négative. Ainsi nous avons pu fonder sur l’être même de la conscience le contenu de l’analyse phénoménologique du temps : son caractère historique, successif, irréversible et banal.
Nous sommes maintenant en mesure de répondre à la question posée plus haut (pourquoi le temps naturel est-il brisé par la manifestation de l’existant ?) et de préciser un peu plus la nature de la cassure par laquelle l’existant donne son être-là.
La succession, nous l’avons vu, se manifeste comme unité des trois champs de la
négativité temporelle. Mais comme le pôle de cette unité est la présence à soi de la conscience
et que cette présence à soi renvoie à la transcendance d’une chose présente, le fond originaire
que cette succession enveloppe doit être l’être même de la conscience saisi comme visée de
chose. A cette condition seulement la succession
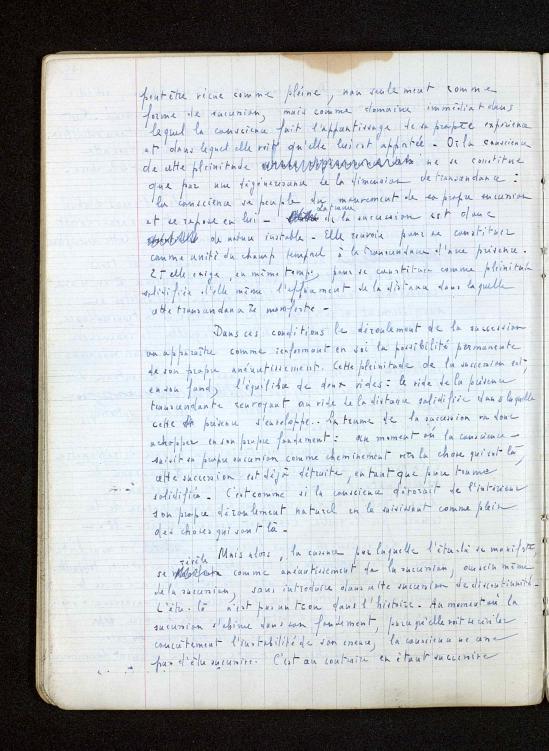 [0052]
peut être vécue comme pleine, non
seulement comme forme de succession, mais comme domaine immédiat dans lequel la
conscience fait l’apprentissage de sa propre expérience et dans lequel elle voit qu’elle lui est
apportée. Or la conscience de cette plénitude ne se constitue que par une dégénérescence de la
dimension de transcendance : la conscience se peuple du mouvement de sa propre succession
et se repose en lui. La trame de la succession est donc de nature instable. Elle renvoie pour se
constituer comme unité du champ temporel à la transcendance d’une présence. Et elle exige,
en même temps, pour se constituer comme plénitude solidifiée d’elle-même l’effacement de la
distance dans laquelle cette transcendance se manifeste.
[0052]
peut être vécue comme pleine, non
seulement comme forme de succession, mais comme domaine immédiat dans lequel la
conscience fait l’apprentissage de sa propre expérience et dans lequel elle voit qu’elle lui est
apportée. Or la conscience de cette plénitude ne se constitue que par une dégénérescence de la
dimension de transcendance : la conscience se peuple du mouvement de sa propre succession
et se repose en lui. La trame de la succession est donc de nature instable. Elle renvoie pour se
constituer comme unité du champ temporel à la transcendance d’une présence. Et elle exige,
en même temps, pour se constituer comme plénitude solidifiée d’elle-même l’effacement de la
distance dans laquelle cette transcendance se manifeste.
Dans ces conditions le déroulement de la succession va apparaître comme renfermant en soi la possibilité permanente de son propre anéantissement. Cette plénitude de la succession est, en son fond, l’équilibre de deux vides : le vide de la présence transcendante renvoyant au vide de la distance solidifiée dans laquelle cette présence s’enveloppe. La trame de la succession va donc achopper en son propre fondement : au moment où la conscience saisit sa propre succession comme cheminement vers la chose qui est là, cette succession est déjà détruite, en tant que pure trame solidifiée. C’est comme si la conscience dévorait de l’intérieur son propre déroulement naturel en le saisissant comme plein des choses qui sont là.
Mais alors, la cassure par laquelle l’être-là se manifeste se révèle comme anéantissement
de la succession, au sein même de la succession, sans introduire dans cette succession de
discontinuité. L’être-là n’est pas un trou dans l’histoire. Au moment où la succession s’abîme
dans son fondement, parce qu’elle voit se révéler concrètement l’instabilité de son essence, la
conscience ne cesse pas d’être successive. C’est au contraire en étant successive
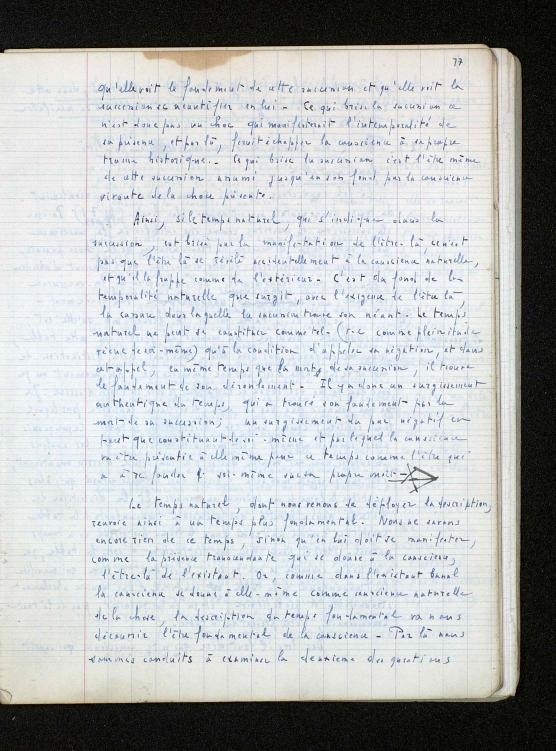 [0053]
qu’elle
voit le fondement de cette succession et qu’elle voit la succession se néantifier en lui. Ce qui
brise la succession ce n’est donc pas un choc qui manifesterait l’intemporalité de sa présence,
et par là, ferait échapper la conscience à sa propre trame historique. Ce qui brise la succession
c’est l’être même de cette succession assumé jusqu’en son fond par la conscience vivante de la
chose présente.
[0053]
qu’elle
voit le fondement de cette succession et qu’elle voit la succession se néantifier en lui. Ce qui
brise la succession ce n’est donc pas un choc qui manifesterait l’intemporalité de sa présence,
et par là, ferait échapper la conscience à sa propre trame historique. Ce qui brise la succession
c’est l’être même de cette succession assumé jusqu’en son fond par la conscience vivante de la
chose présente.
Ainsi, si le temps naturel, qui s’indique dans la succession, est brisé par la manifestation de l’être-là, ce n’est pas que l’être-là se révèle accidentellement à la conscience naturelle, et qu’il la frappe comme de l’extérieur. C’est du fond de la temporalité naturelle que surgit, avec l’exigence de l’être-là, la cassure dans laquelle la succession trouve son néant. Le temps naturel ne peut se constituer comme tel (i.e. comme plénitude vécue de soi-même) qu’à la condition d’appeler sa négation, et dans cet appel, en même temps que la mort de sa succession, il trouve le fondement de son déroulement. Il y a donc un surgissement authentique du temps, qui a trouvé son fondement par la mort de sa succession ; un surgissement du pur négatif en tant que constituant de soi-même et par lequel la conscience va être présentée à elle-même pour ce temps comme l’être qui a à se fonder soi-même sur sa propre mort.
Le temps naturel, dont nous venons de déployer la description, renvoie ainsi à un temps
plus fondamental. Nous ne savons encore rien de ce temps, sinon qu’en lui doit se manifester,
comme la présence transcendante qui se donne à la conscience, l’être-là de l’existant. Or
comme dans l’existant banal la conscience se donne à elle-même comme conscience naturelle
de la chose, la description du temps fondamental va nous découvrir l’être fondamental de la
conscience. Par là nous sommes conduits à examiner la deuxième des questions
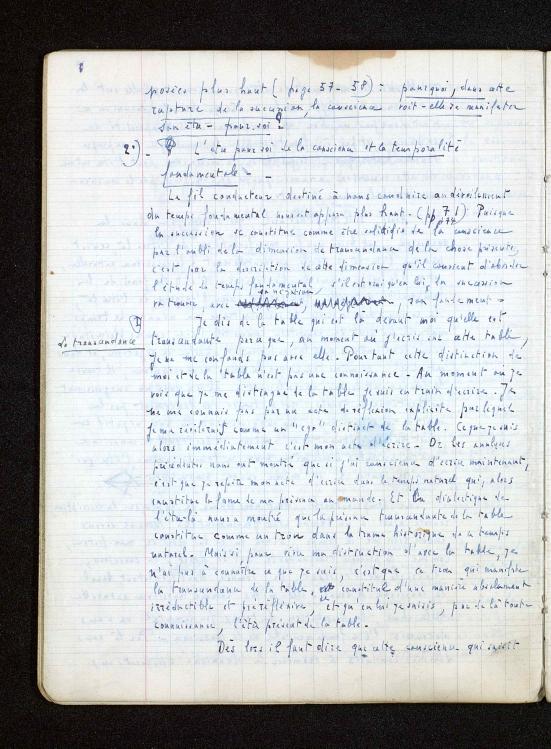 [0054]
posées
plus haut (pages 57-58) : pourquoi, dans cette rupture de la succession, la conscience voit-elle
se manifester son être pour soi ?
2°) L’être pour soi de la conscience et la temporalité fondamentale.
[0054]
posées
plus haut (pages 57-58) : pourquoi, dans cette rupture de la succession, la conscience voit-elle
se manifester son être pour soi ?
2°) L’être pour soi de la conscience et la temporalité fondamentale.
Le fil conducteur destiné à nous conduire au dévoilement du temps fondamental nous est apparu plus haut (p.71). Puisque la succession se constitue comme être solidifié de la conscience par l’oubli de la dimension de transcendance de la chose présente, c’est par la description de cette dimension qu’il convient d’aborder l’étude du temps fondamental, s’il est vrai qu’en lui la succession va trouver, avec sa négation, son fondement.
I) La transcendance
Je dis de la table qui est là devant moi qu’elle est transcendante parce que, au moment où j’écris sur cette table, je ne me confonds pas avec elle. Pourtant cette distinction de moi et de la table n’est pas une connaissance. Au moment où je vois que je me distingue de la table, je suis en train d’écrire. Je ne me connais pas par un acte de réflexion explicite par lequel je me révèlerait comme un “ ego ” distinct de la table. Ce que je suis alors immédiatement c’est mon acte d’écrire. Or les analyses précédentes nous ont montré que si j’ai conscience d’écrire maintenant, c’est que je repère mon acte d’écrire dans le temps naturel qui, alors, constitue la forme de ma présence au monde. Et la dialectique de l’être-là nous a montré que la présence transcendante de la table constitue comme un trou dans la trame historique de ce temps naturel. Mais si pour vivre ma distinction d’avec la table, je n’ai pas à connaître ce que je suis, c’est que ce trou qui manifeste la transcendance de la table se constitue d’une manière absolument irréductible et pré-réflexive, et qu’en lui je saisis, par-delà toute connaissance, l’être présent de la table.
Dès lors il faut dire que cette conscience qui saisit
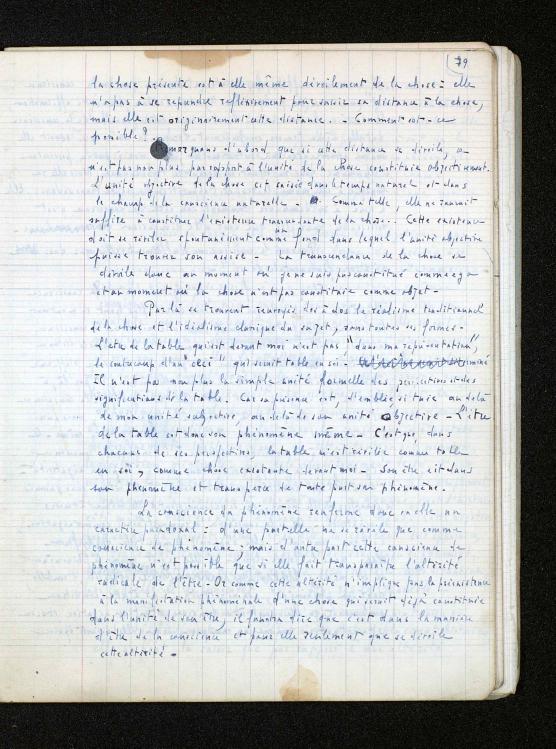 [0055]
la chose présente est à elle-même dévoilement de la chose : elle n’a pas à se reprendre réflexivement pour saisir sa
distance à la chose, mais elle est originairement cette distance. Comment est-ce possible ?
Remarquons d’abord que si cette distance se dévoile, ce n’est pas non plus par rapport
à l’unité de la chose constituée objectivement. L’unité objective de la chose est saisie dans le
temps naturel et dans le champ de la conscience naturelle. Comme telle, elle ne saurait suffire
à constituer l’existence transcendante de la chose. Cette existence doit se révéler
spontanément comme un fond dans lequel l’unité objective puisse trouver son assise. La
transcendance de la chose se dévoile donc au moment où je ne suis pas constitué comme ego
et au moment où la chose n’est pas constituée comme objet.
[0055]
la chose présente est à elle-même dévoilement de la chose : elle n’a pas à se reprendre réflexivement pour saisir sa
distance à la chose, mais elle est originairement cette distance. Comment est-ce possible ?
Remarquons d’abord que si cette distance se dévoile, ce n’est pas non plus par rapport
à l’unité de la chose constituée objectivement. L’unité objective de la chose est saisie dans le
temps naturel et dans le champ de la conscience naturelle. Comme telle, elle ne saurait suffire
à constituer l’existence transcendante de la chose. Cette existence doit se révéler
spontanément comme un fond dans lequel l’unité objective puisse trouver son assise. La
transcendance de la chose se dévoile donc au moment où je ne suis pas constitué comme ego
et au moment où la chose n’est pas constituée comme objet.
Par là se trouvent renvoyés dos-à-dos le réalisme traditionnel de la chose et l’idéalisme classique du sujet, sous toutes ses formes. L’être de la table qui est devant moi n’est pas “ dans ma représentation ” le contrecoup d’un “ ceci ” qui serait table en soi. Il n’est pas non plus la simple unité formelle des perspectives et des significations de la table. Car sa présence est, d’emblée, située au-delà de mon unité subjective, au-delà de son unité objective. L’être de la table est donc son phénomène même. C’est que, dans chacune de ses perspectives, la table m’est révélée comme table en soi, comme chose existante devant moi. Son être est dans son phénomène et transperce de toute part son phénomène.
La conscience du phénomène renferme donc en elle un caractère paradoxal : d’une part elle ne se révèle que comme conscience de phénomène ; mais d’autre part cette conscience de phénomène n’est possible que si elle fait transparaître l’altérité radicale de l’être. Or comme cette altérité n’implique pas la préexistence à la manifestation phénoménale d’une chose qui serait déjà constituée dans l’unité de son être, il faudra dire que c’est dans la manière d’être de la conscience et pour elle seulement que se dévoile cette altérité.
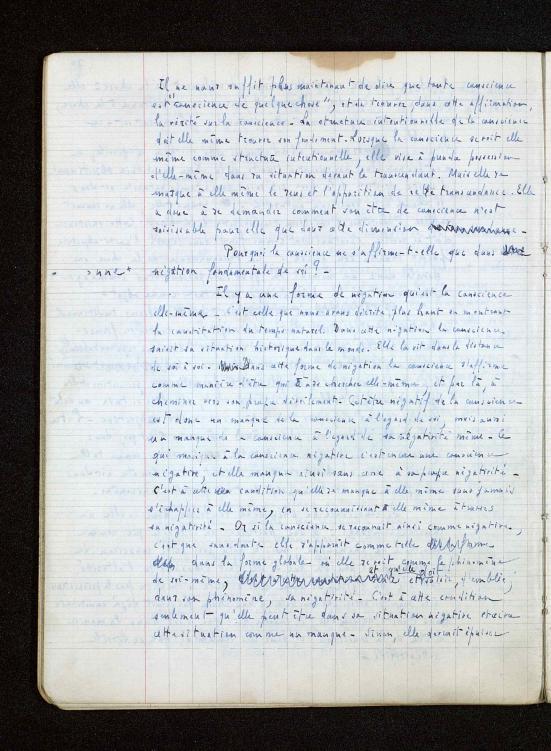 [0056]
Il ne nous suffit plus maintenant de dire que toute conscience est “ conscience de
quelque chose ”, et de trouver, dans cette affirmation, la vérité sur la conscience. La structure
intentionnelle de la conscience doit elle-même trouver son fondement. Lorsque la conscience
se voit elle-même comme structure intentionnelle, elle vise à prendre possession d’elle-même
dans sa situation devant le transcendant. Mais elle se masque à elle-même le sens et
l’apparition de cette transcendance. Elle a donc à se demander comment son être de
conscience n’est saisissable pour elle que dans cette dimension.
[0056]
Il ne nous suffit plus maintenant de dire que toute conscience est “ conscience de
quelque chose ”, et de trouver, dans cette affirmation, la vérité sur la conscience. La structure
intentionnelle de la conscience doit elle-même trouver son fondement. Lorsque la conscience
se voit elle-même comme structure intentionnelle, elle vise à prendre possession d’elle-même
dans sa situation devant le transcendant. Mais elle se masque à elle-même le sens et
l’apparition de cette transcendance. Elle a donc à se demander comment son être de
conscience n’est saisissable pour elle que dans cette dimension.
Pourquoi la conscience ne s’affirme-t-elle que dans une négation fondamentale de soi ?
Il y a une forme de négation qui est la conscience elle-même. C’est celle que nous
avons décrite plus haut en montrant la constitution du temps naturel. Dans cette négation, la
conscience saisit sa situation historique dans le monde. Elle la voit dans la distance de soi à
soi. Dans cette forme de négation, la conscience s’affirme comme manière d’être qui a à se
chercher elle-même, et par là, à cheminer vers son propre dévoilement. Cet être négatif de la
conscience est donc un manque de la conscience à l’égard de soi, mais aussi un manque de la
conscience à l’égard de sa négativité même. Ce qui manque à la conscience négative c’est
encore une conscience négative, et elle manque ainsi sans cesse à sa propre négativité. C’est à
cette condition qu’elle se manque à elle-même sans jamais s’échapper à elle-même, en se
reconnaissant elle-même à travers sa négativité. Or si la conscience se reconnaît ainsi comme
négation c’est que sans doute elle s’apparaît comme telle dans la forme globale où elle se voit
comme le phénomène de soi-même, et qu’elle doit [voir], d’emblée, dans son phénomène, sa
négativité. C’est à cette condition seulement qu’elle peut-être dans sa situation négative et
vivre cette situation comme un manque. Sinon, elle devrait épuiser
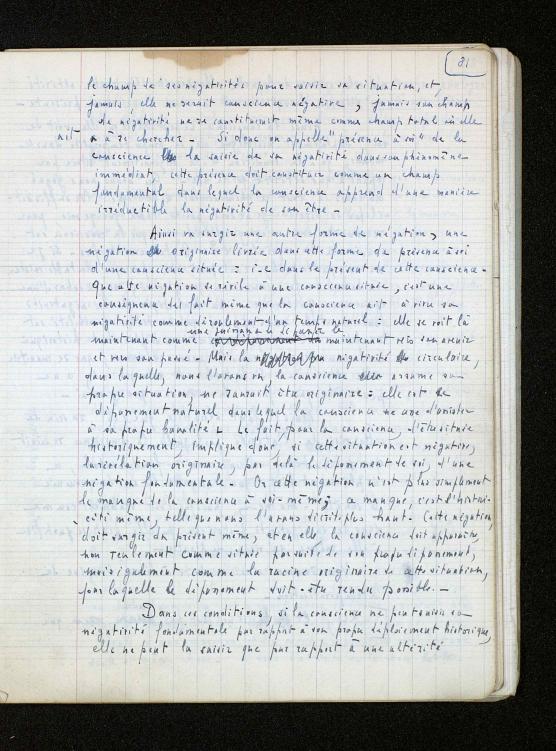 [0057]
le champ de ses négativités pour saisir sa situation, et, jamais elle ne serait conscience négative, jamais son
champ de négativité ne se constituerait même comme champ total où elle ait à se chercher. Si
donc on appelle “ présence à soi ” de la conscience la saisie de sa négativité dans son
phénomène immédiat, cette présence doit constituer comme un champ fondamental dans
lequel la conscience apprend d’une manière irréductible la négativité de son être.
Ainsi va surgir une autre forme de négation, une négation originaire livrée dans cette
forme de présence à soi d’une conscience située : i.e. dans le présent de cette conscience. Que
cette négation se révèle à une conscience située, c’est une conséquence du fait même que la
conscience ait à vivre sa négativité comme déroulement d’un temps naturel : elle se voit là
maintenant comme une puissance de dépasser le maintenant vers son avenir et vers son passé.
Mais la négativité circulaire, dans laquelle, nous l’avons vu, la conscience assume sa propre
situation, ne saurait être originaire : elle est ce dépassement naturel dans lequel la conscience
ne cesse d’assister à sa propre banalité. Le fait, pour la conscience, d’être située
historiquement, implique donc, si cette situation est négative, la révélation originaire, par-delà
le dépassement de soi, d’une négation fondamentale. Or cette négation n’est plus simplement
le manque de la conscience à soi-même ; ce manque, c’est l’historicité même, telle que nous
l’avons décrite plus haut. Cette négation doit surgir du présent même, et en elle, la conscience
doit apparaître, non seulement comme située par suite de son propre dépassement, mais
également comme la racine originaire de cette situation pour laquelle le dépassement doit être
rendu possible.
[0057]
le champ de ses négativités pour saisir sa situation, et, jamais elle ne serait conscience négative, jamais son
champ de négativité ne se constituerait même comme champ total où elle ait à se chercher. Si
donc on appelle “ présence à soi ” de la conscience la saisie de sa négativité dans son
phénomène immédiat, cette présence doit constituer comme un champ fondamental dans
lequel la conscience apprend d’une manière irréductible la négativité de son être.
Ainsi va surgir une autre forme de négation, une négation originaire livrée dans cette
forme de présence à soi d’une conscience située : i.e. dans le présent de cette conscience. Que
cette négation se révèle à une conscience située, c’est une conséquence du fait même que la
conscience ait à vivre sa négativité comme déroulement d’un temps naturel : elle se voit là
maintenant comme une puissance de dépasser le maintenant vers son avenir et vers son passé.
Mais la négativité circulaire, dans laquelle, nous l’avons vu, la conscience assume sa propre
situation, ne saurait être originaire : elle est ce dépassement naturel dans lequel la conscience
ne cesse d’assister à sa propre banalité. Le fait, pour la conscience, d’être située
historiquement, implique donc, si cette situation est négative, la révélation originaire, par-delà
le dépassement de soi, d’une négation fondamentale. Or cette négation n’est plus simplement
le manque de la conscience à soi-même ; ce manque, c’est l’historicité même, telle que nous
l’avons décrite plus haut. Cette négation doit surgir du présent même, et en elle, la conscience
doit apparaître, non seulement comme située par suite de son propre dépassement, mais
également comme la racine originaire de cette situation pour laquelle le dépassement doit être
rendu possible.
Dans ces conditions, si la conscience ne peut saisir sa négativité fondamentale par
rapport à son propre déploiement historique, elle ne peut la saisir que par rapport à une altérité
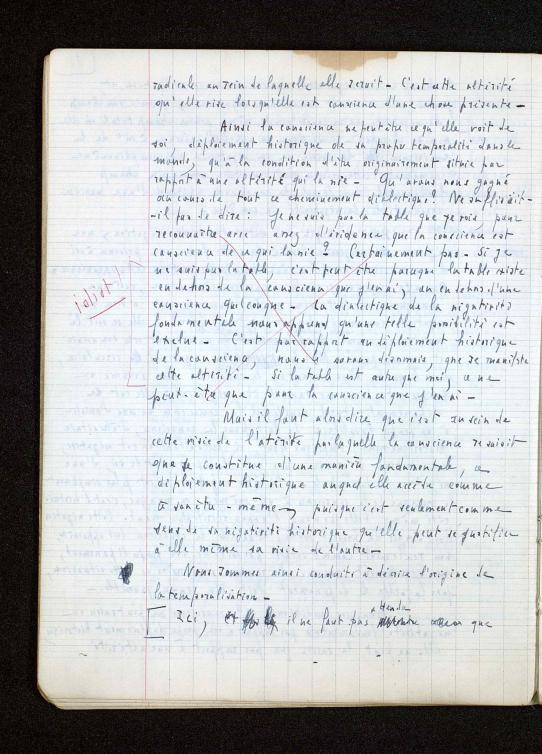 [0058]
radicale au sein de laquelle elle serait. C’est cette altérité qu’elle vise lorsqu’elle est
conscience d’une chose présente.
[0058]
radicale au sein de laquelle elle serait. C’est cette altérité qu’elle vise lorsqu’elle est
conscience d’une chose présente.
Ainsi la conscience ne peut être ce qu’elle voit de soi, déploiement de sa propre
temporalité dans le monde, qu’à la condition d’être originairement située par rapport à une
altérité qui la nie.
Mais il faut alors dire que c’est au sein de cette visée de l’altérité par laquelle la
conscience se saisit que se constitue d’une manière fondamentale ce déploiement historique
auquel elle accède comme à son être même, puisque c’est seulement comme sens de sa
négativité historique qu’elle peut se justifier à elle-même sa visée de l’autre.
Nous sommes ainsi conduits à décrire l’origine de la temporalisation. Ici, il ne faut pas
attendre que
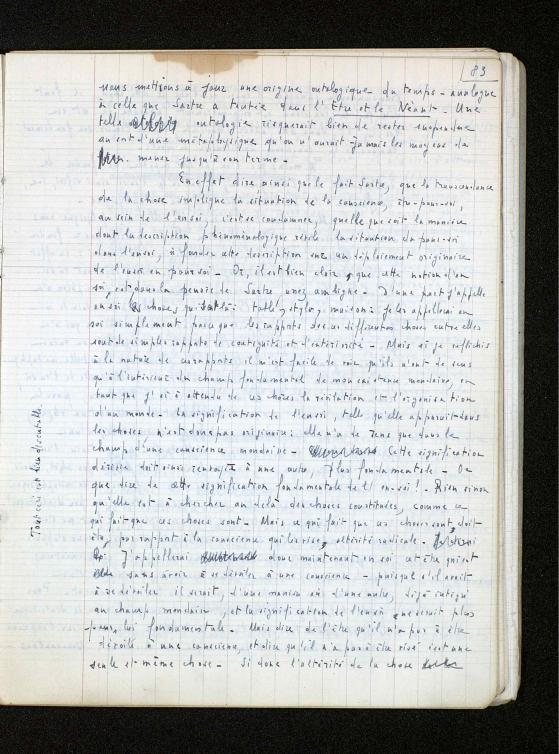 [0059]
nous mettions à jour une origine ontologique du temps, analogue à celle
que Sartre a tentée dans l’Etre et le Néant. Une telle ontologie risquerait bien de rester
suspendue au sort d’une métaphysique qu’on n’aurait jamais les moyens de mener jusqu’à son
terme.
[0059]
nous mettions à jour une origine ontologique du temps, analogue à celle
que Sartre a tentée dans l’Etre et le Néant. Une telle ontologie risquerait bien de rester
suspendue au sort d’une métaphysique qu’on n’aurait jamais les moyens de mener jusqu’à son
terme.
En effet dire ainsi que le fait Sartre, que la transcendance de la chose implique la
situation de la conscience, être pour soi, au sein de l’en soi, c’est se condamner, quelle que
soit la manière dont la description phénoménologique révèle la situation du pour soi dans l’en
soi, à fonder cette description sur un déploiement originaire de l’en soi pour soi. Or, il est bien
clair que cette notion d’en soi, est, dans la pensée de Sartre, assez ambiguë. D’une part
j’appelle en soi les choses qui sont là : table, stylo, maison : je les appellerai en soi
simplement parce que les rapports de ces différentes choses entre elles sont de simples
rapports de contiguïté et d’extériorité. Mais si je réfléchis à la nature de ces rapports il m’est
facile de voir qu’ils n’ont de sens qu’à l’intérieur du champ fondamental de mon existence
mondaine, en tant que j’ai à attendre de ces choses la révélation et l’organisation d’un monde.
La signification de l’en soi, telle qu’elle apparaît dans les choses, n’est donc pas originaire :
elle n’a de sens que dans le champ d’une conscience mondaine. Cette signification dérivée
doit ainsi renvoyer à une autre, plus fondamentale. Or que dire de cette signification
fondamentale de l’en soi ? Rien sinon qu’elle est à chercher au-delà des choses constituées,
comme ce qui fait que ces choses sont. Mais ce qui fait que ces choses sont, doit être, par
rapport à la conscience qui les vise, altérité radicale. J’appellerai donc maintenant en soi cet
être qui est sans avoir à se dévoiler à une conscience, puisque s’il avait à se dévoiler il serait,
d’une manière où d’une autre, déjà intégré au champ mondain, et la signification de l’en soi ne
serait plus pour lui fondamentale. Mais dire de l’être qu’il n’a pas à être dévoilé à une
conscience, et dire qu’il n’a pas à être visé c’est une seule et même chose. Si donc l’altérité de
la chose
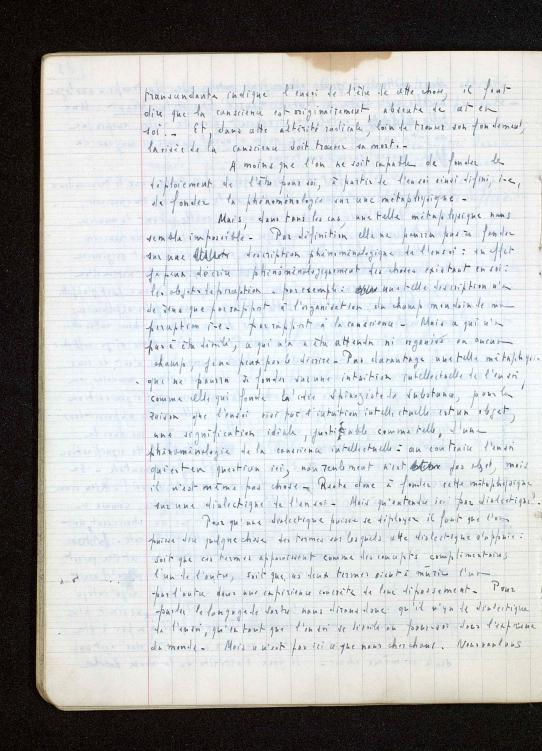 [0060]
transcendante indique l’en soi de l’être de cette chose, il faut dire que la
conscience est originairement absente de cet en soi. Et, dans cette altérité radicale, loin de
trouver son fondement, la visée de la conscience doit trouver sa mort.
[0060]
transcendante indique l’en soi de l’être de cette chose, il faut dire que la
conscience est originairement absente de cet en soi. Et, dans cette altérité radicale, loin de
trouver son fondement, la visée de la conscience doit trouver sa mort.
A moins que l’on ne soit capable de fonder le déploiement de l’être pour soi, à partir de
l’en soi ainsi défini, i.e. de fonder la phénoménologie sur une métaphysique.
Mais, dans tous les cas, une telle métaphysique nous semble impossible. Par définition
elle ne pourra pas se fonder sur une description phénoménologique de l’en soi : en effet je
peux décrire phénoménologiquement des choses existant en soi : les objets de perception par
exemple ; une telle description n’a de sens que par rapport à l’organisation du champ mondain
de ma perception, i.e. par rapport à la conscience. Mais ce qui n’a pas à être dévoilé, ce qui
n’a à être attendu ni organisé en aucun champ, je ne peux pas le décrire. Pas davantage une
telle métaphysique ne pourra se fonder sur une intuition intellectuelle de l’en soi, comme celle
qui fonde l’idée spinoziste de substance, pour la raison que l’en soi visé par l’intuition
intellectuelle est un objet, une signification idéale, justifiable comme telle d’une
phénoménologie de la conscience intellectuelle : au contraire l’en soi qui est en question ici,
non seulement n’est pas objet, mais il n’est même pas chose. Reste donc à fonder cette
métaphysique sur une dialectique de l’en soi. Mais qu’entendre ici par dialectique ?
Pour qu’une dialectique puisse se déployer il faut que l’on puisse dire quelque chose
des termes sur lesquels cette dialectique s’appuie : soit que ces termes apparaissent comme
des concepts complémentaires l’un de l’autre, soit que ces deux termes aient à mûrir l’un par
l’autre dans une expérience concrète de leur dépassement. Pour parler le langage de Sartre
nous dirons donc qu’il n’y a de dialectique de l’en soi qu’en tant que l’en soi se dévoile au
pour soi dans l’expérience du monde. Mais ce n’est pas ici ce que nous cherchons. Nous
voulons
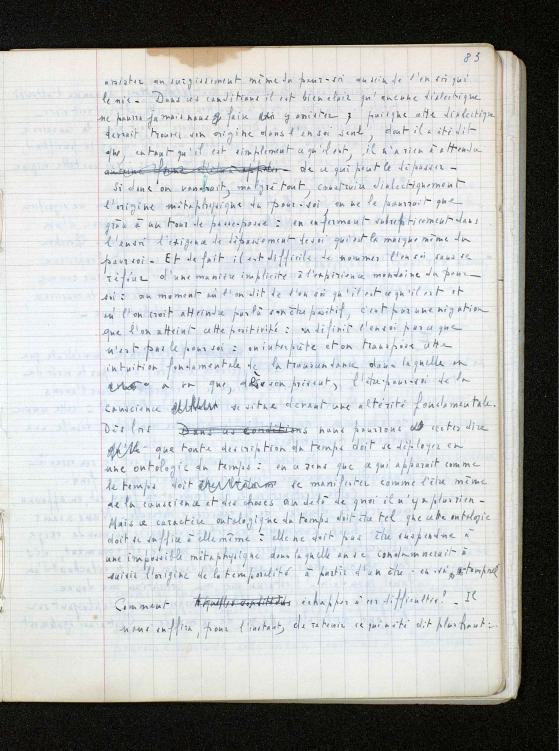 [0061]
assister au surgissement même du pour soi au sein de l’en soi qui le nie. Dans
ces conditions, il est bien clair qu’aucune dialectique ne pourra jamais nous faire y assister,
puisque cette dialectique devrait trouver son origine dans l’en soi seul, dont il a été dit que, en
tant qu’il est simplement ce qu’il est, il n’a rien à attendre de ce qui peut le dépasser. Si donc
on voulait, malgré tout, construire dialectiquement l’origine métaphysique du pour soi, on ne
le pourrait que grâce à un tour de passe-passe : en enfermant subrepticement dans l’en soi
l’exigence de dépassement de soi qui est la marque même du pour soi. Et de fait il est difficile
de nommer l’en soi sans se référer d’une manière implicite à l’expérience mondaine du pour
soi : au moment où l’on dit de l’en soi qu’il est ce qu’il est et où l’on croit atteindre par là son
être positif, c’est par une négation que l’on atteint cette positivité : on définit l’en soi par ce
que n’est pas le pour soi : on interprète et on transpose cette intuition fondamentale de la
transcendance dans laquelle on a vu que, dès son présent, l’être pour soi de la conscience se
situe devant une altérité fondamentale. Dès lors nous pourrons certes dire que toute
description du temps doit se déployer en une ontologie du temps : en ce sens que ce qui
apparaît comme le temps doit se manifester comme l’être même de la conscience et des choses
au-delà de quoi il n’y a plus rien. Mais ce caractère ontologique du temps doit être tel que
cette ontologie doit se suffire à elle-même : elle ne doit pas être suspendue à une impossible
métaphysique dans laquelle on se condamnerait à saisir l’origine de la temporalité à partir
d’un être en soi a-temporel. Comment échapper à ces difficultés ? Il nous suffira, pour
l’instant, de retenir ce qui a été dit plus haut
[0061]
assister au surgissement même du pour soi au sein de l’en soi qui le nie. Dans
ces conditions, il est bien clair qu’aucune dialectique ne pourra jamais nous faire y assister,
puisque cette dialectique devrait trouver son origine dans l’en soi seul, dont il a été dit que, en
tant qu’il est simplement ce qu’il est, il n’a rien à attendre de ce qui peut le dépasser. Si donc
on voulait, malgré tout, construire dialectiquement l’origine métaphysique du pour soi, on ne
le pourrait que grâce à un tour de passe-passe : en enfermant subrepticement dans l’en soi
l’exigence de dépassement de soi qui est la marque même du pour soi. Et de fait il est difficile
de nommer l’en soi sans se référer d’une manière implicite à l’expérience mondaine du pour
soi : au moment où l’on dit de l’en soi qu’il est ce qu’il est et où l’on croit atteindre par là son
être positif, c’est par une négation que l’on atteint cette positivité : on définit l’en soi par ce
que n’est pas le pour soi : on interprète et on transpose cette intuition fondamentale de la
transcendance dans laquelle on a vu que, dès son présent, l’être pour soi de la conscience se
situe devant une altérité fondamentale. Dès lors nous pourrons certes dire que toute
description du temps doit se déployer en une ontologie du temps : en ce sens que ce qui
apparaît comme le temps doit se manifester comme l’être même de la conscience et des choses
au-delà de quoi il n’y a plus rien. Mais ce caractère ontologique du temps doit être tel que
cette ontologie doit se suffire à elle-même : elle ne doit pas être suspendue à une impossible
métaphysique dans laquelle on se condamnerait à saisir l’origine de la temporalité à partir
d’un être en soi a-temporel. Comment échapper à ces difficultés ? Il nous suffira, pour
l’instant, de retenir ce qui a été dit plus haut
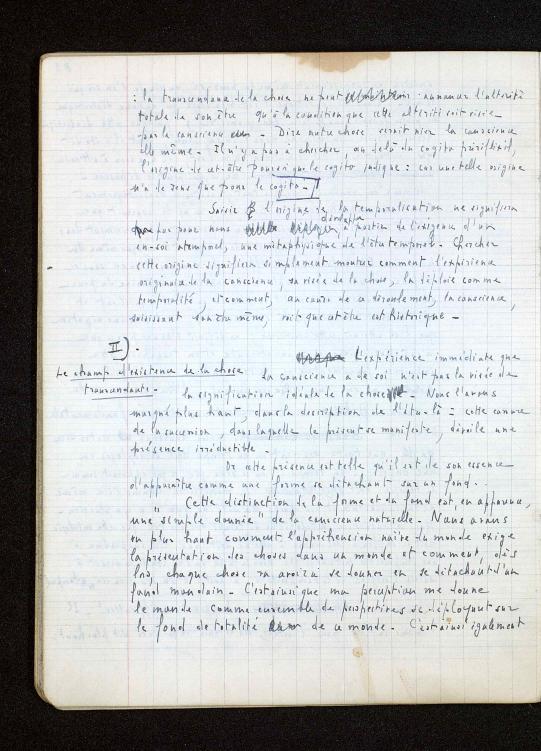 [0062]
: la transcendance de la chose ne peut
annoncer l’altérité totale de son être qu’à la condition que cette altérité soit visée par la
conscience. Dire autre chose serait nier la conscience elle-même. Il n’y a pas à chercher au-
delà du cogito pré-réflexif l’origine de cet être pour soi que le cogito indique : car une telle
origine n’a de sens que pour le cogito.
[0062]
: la transcendance de la chose ne peut
annoncer l’altérité totale de son être qu’à la condition que cette altérité soit visée par la
conscience. Dire autre chose serait nier la conscience elle-même. Il n’y a pas à chercher au-
delà du cogito pré-réflexif l’origine de cet être pour soi que le cogito indique : car une telle
origine n’a de sens que pour le cogito.
II) Le champ d’existence de la chose transcendante.
L’expérience immédiate que la conscience a de soi n’est pas la visée de la signification idéale de la chose. Nous l’avons marqué plus haut, dans la description de l’être-là : cette cassure de la succession, dans laquelle le présent se manifeste, dévoile une présence irréductible.
Or cette présence est telle qu’il est de son essence d’apparaître comme une forme se détachant sur un fond.
Cette distinction de la forme et du fond est, en apparence, une “ simple donnée ” de la
conscience naturelle. Nous avons vu plus haut comment l’appréhension naïve du monde exige
la présentation des choses dans un monde et comment, dès lors, chaque chose va avoir à se
donner en se détachant d’un fond mondain. C’est ainsi que ma perception me donne le monde
comme ensemble de perspectives se déployant sur le fond de totalité de ce monde. C’est ainsi
également
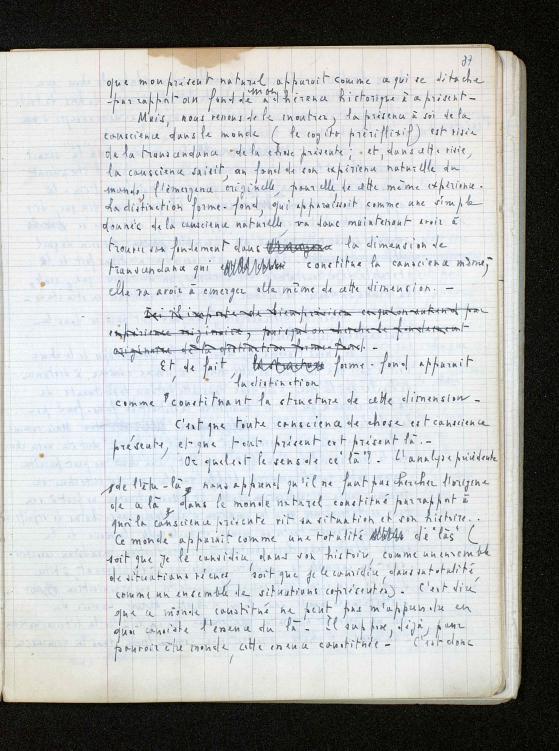 [0063]
que mon présent naturel apparaît comme ce qui se détache par rapport au
fond de mon adhérence historique à ce présent.
[0063]
que mon présent naturel apparaît comme ce qui se détache par rapport au
fond de mon adhérence historique à ce présent.
Mais, nous venons de le montrer, la présence à soi de la conscience dans le monde (le cogito pré-réflexif) est visée de la transcendance de la chose présente ; et, dans cette visée, la conscience saisit, au fond de son expérience naturelle du monde, l’émergence originelle, pour elle de cette même expérience. La distinction forme-fond, qui apparaissait comme une simple donnée de la conscience naturelle, va donc maintenant avoir à trouver son fondement dans la dimension de transcendance qui constitue la conscience même ; elle va avoir à émerger elle- même de cette dimension.
Et, de fait, la distinction forme-fond apparaît comme constituant la structure de cette dimension.
C’est que toute conscience de chose est conscience présente, et que tout présent est présent là.
Or quel est le sens de ce là ? L’analyse précédente de l’être-là nous apprend qu’il ne
faut pas chercher l’origine de ce là dans le monde naturel constitué par rapport à quoi la
conscience présente vit sa situation et son histoire. Ce monde apparaît comme une totalité de
"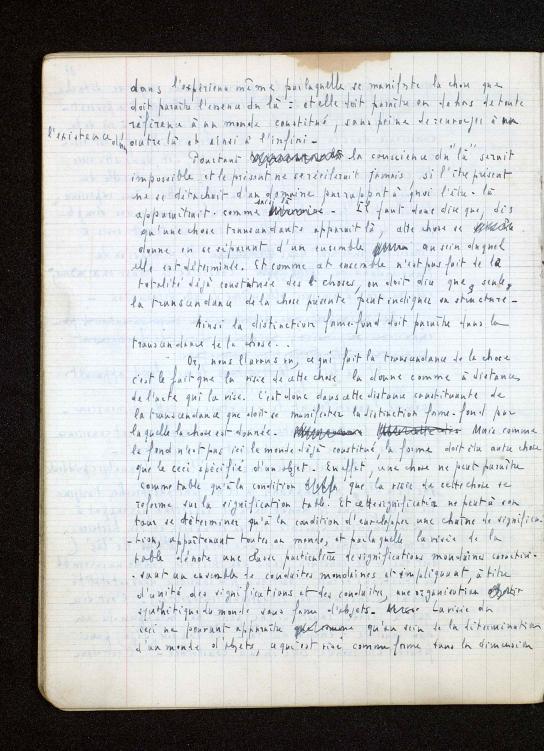 [0064]
dans l’expérience même par laquelle se manifeste la chose que doit paraître l’essence du là : et elle
doit paraître en dehors de toute référence à un monde constitué, sous peine de renvoyer à
l’existence d’un autre là et ainsi à l’infini.
[0064]
dans l’expérience même par laquelle se manifeste la chose que doit paraître l’essence du là : et elle
doit paraître en dehors de toute référence à un monde constitué, sous peine de renvoyer à
l’existence d’un autre là et ainsi à l’infini.
Pourtant la conscience du “ là ” serait impossible et le présent ne se révèlerait jamais, si l’être présent ne se détachait d’un domaine par rapport à quoi l’être-là apparaîtrait comme saisi là. Il faut donc dire que, dès qu’une chose transcendante apparaît là, cette chose se donne en se séparant d’un ensemble au sein duquel elle est déterminée. Et comme cet ensemble n’est pas fait de la totalité déjà constituée des choses, on doit dire que seule la transcendance de la chose présente peut indiquer sa structure.
Ainsi la distinction forme-fond doit paraître dans la transcendance de la chose.
Or, nous l’avons vu, ce qui fait la transcendance de la chose c’est le fait que la visée de
cette chose la donne comme à distance de l’acte qui la vise. C’est donc dans cette distance
constituante de la transcendance que doit se manifester la distinction forme-fond par laquelle
la chose est donnée. Mais comme le fond n’est pas ici le monde déjà constitué, la forme doit
être autre chose que le ceci spécifié d’un objet. En effet, une chose ne peut paraître comme
table qu’à la condition que la visée de cette chose se referme sur la signification table. Et cette
signification ne peut à son tour se déterminer qu’à la condition d’envelopper une chaîne de
significations, appartenant toutes au monde, et par laquelle la visée de la table dénote une
classe particulière de significations mondaines caractérisant un ensemble de conduites
mondaines et impliquant, à titre d’unité des significations et des conduites, une organisation
synthétique du monde sous forme d’objets. La visée du ceci ne pouvait apparaître qu’au sein
de la détermination d’un monde d’objets, ce qui est visé comme forme dans la dimension
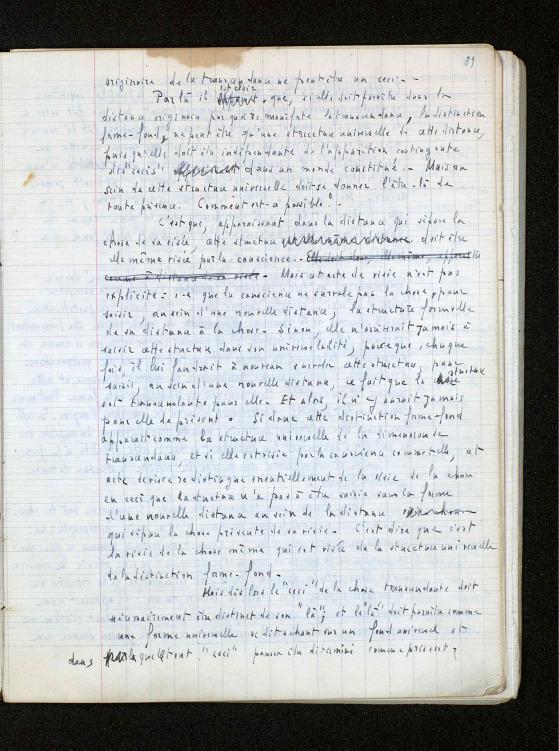 [0065]
originaire de la transcendance ne peut être un ceci.
[0065]
originaire de la transcendance ne peut être un ceci.
Par là il est clair que, si elle doit paraître dans la distance originaire par quoi se manifeste la transcendance, la distinction forme-fond, ne peut être qu’une structure universelle de cette distance, puisqu’elle doit être indépendante de l’apparition contingente des “ cecis ”9 dans un monde constitué. Mais au sein de cette structure universelle doit se donner l’être-là de toute présence. Comment est-ce possible ? C’est que, apparaissant dans la distance qui sépare la chose de la visée, cette structure doit être elle-même visée par la conscience. Mais cet acte de visée n’est pas explicite : i.e. que la conscience ne survole pas la chose, pour saisir, au sein d’une nouvelle distance, la structure formelle de sa distance à la chose. Sinon, elle n’arriverait jamais à saisir cette structure dans son universalité, parce que, chaque fois, il lui faudrait à nouveau survoler cette structure, pour saisir, au sein d’une nouvelle distance, ce fait que la structure est transcendante pour elle. Et alors, il n’y aurait jamais pour elle de présent. Si donc cette distinction forme-fond apparaît comme la structure universelle de la dimension de transcendance, et si elle est visée par la conscience comme telle, cet acte de visée se distingue essentiellement de la visée de la chose en ceci que la structure n’a pas à être saisie sous la forme d’une nouvelle distance au sein de la distance qui sépare la chose présente de sa visée. C’est dire que c’est la visée de la chose même qui est visée de la structure universelle de la distinction forme-fond.
Mais dès lors le “ ceci ” de la chose transcendante doit nécessairement être distinct de son “ là ” ; et le “ là ” doit paraître comme une forme universelle se détachant sur un fond universel et dans lequel tout “ ceci ” pourra être déterminé comme présent.
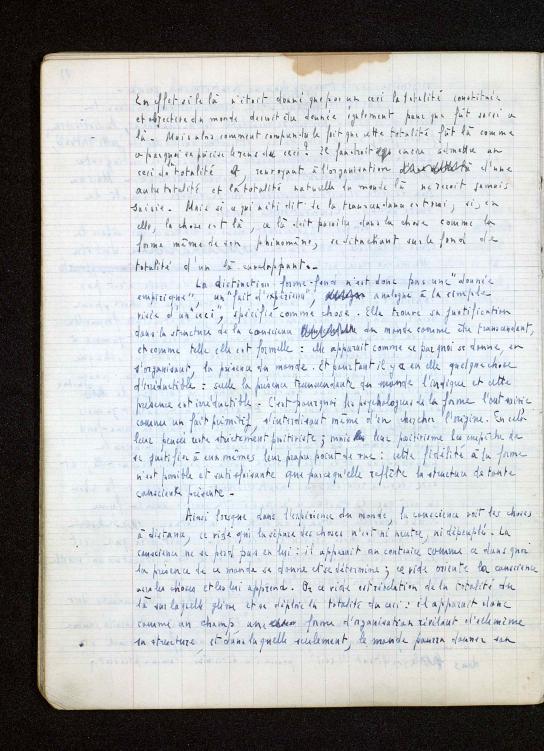 [0066]
En effet si le là n’était donné que par un ceci, la totalité constituée et objective du monde devrait être
donnée également pour que fût saisi ce là. Mais alors comment comprendre le fait que cette
totalité fût là comme ce par quoi se précise le sens du ceci ? Il faudrait encore admettre un ceci
de la totalité, renvoyant à l’organisation d’une autre totalité, et la totalité naturelle du monde là
ne serait jamais saisie. Mais si ce qui a été dit de la transcendance est vrai, si, en elle, la chose
est là, ce là doit paraître dans la chose comme la forme même de son phénomène, se détachant
sur le fond de totalité d’un là enveloppant.
[0066]
En effet si le là n’était donné que par un ceci, la totalité constituée et objective du monde devrait être
donnée également pour que fût saisi ce là. Mais alors comment comprendre le fait que cette
totalité fût là comme ce par quoi se précise le sens du ceci ? Il faudrait encore admettre un ceci
de la totalité, renvoyant à l’organisation d’une autre totalité, et la totalité naturelle du monde là
ne serait jamais saisie. Mais si ce qui a été dit de la transcendance est vrai, si, en elle, la chose
est là, ce là doit paraître dans la chose comme la forme même de son phénomène, se détachant
sur le fond de totalité d’un là enveloppant.
La distinction forme-fond n’est donc pas une “ donnée empirique ”, un “ fait
d’expérience ”, analogue à la simple visée d’un “ ceci ”, spécifié comme chose. Elle trouve sa
justification dans la structure de la conscience du monde comme être transcendant et comme
telle elle est formelle : elle apparaît comme ce par quoi se donne, en s’organisant, la présence
du monde. Et pourtant il y a en elle quelque chose d’irréductible : seule la présence
transcendante du monde l’indique, et cette présence est irréductible. C’est pourquoi les
psychologues de la forme l’ont saisie comme un fait primitif, s’interdisant même d’en
chercher l’origine. En cela leur pensée reste strictement positiviste ; mais leur positivisme les
empêche de se justifier à eux-mêmes leur propre point de vue : cette fidélité à la forme n’est
possible et satisfaisante que parce qu’elle reflète la structure de toute conscience présente.
Ainsi lorsque dans l’expérience du monde, la conscience voit les choses à distance, ce
vide qui la sépare des choses n’est ni neutre, ni dépeuplé. La conscience ne se perd pas en lui :
il apparaît au contraire comme ce dans quoi la présence de ce monde se donne et se
détermine ; ce vide oriente la conscience vers les choses et les lui apprend. Or ce vide est
révélation de la totalité du là sur laquelle glisse et se déploie la totalité du ceci : il apparaît
donc comme un champ, une forme d’organisation révélant d’elle-même sa structure, et dans
laquelle seulement, le monde pourra donner son
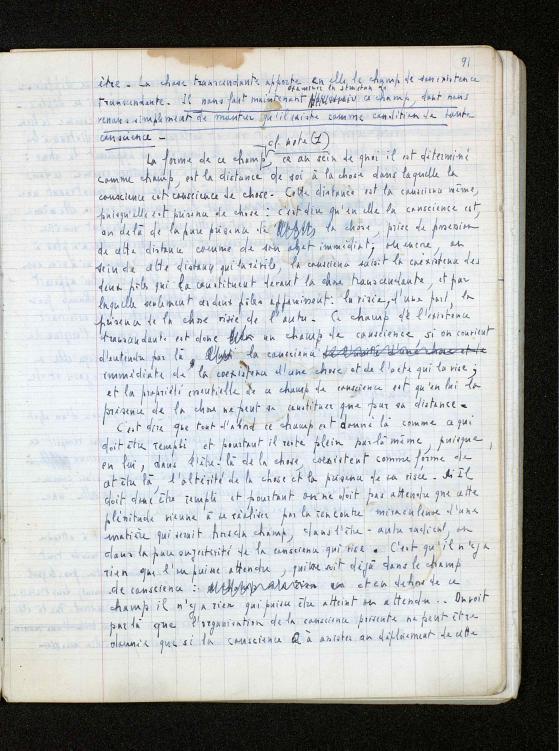 [0067]
être. La chose transcendante apporte en
elle le champ de son existence transcendante. Il nous faut maintenant examiner la structure de
ce champ, dont nous venons simplement de montrer qu’il existe comme condition de toute
conscience.
[0067]
être. La chose transcendante apporte en
elle le champ de son existence transcendante. Il nous faut maintenant examiner la structure de
ce champ, dont nous venons simplement de montrer qu’il existe comme condition de toute
conscience.
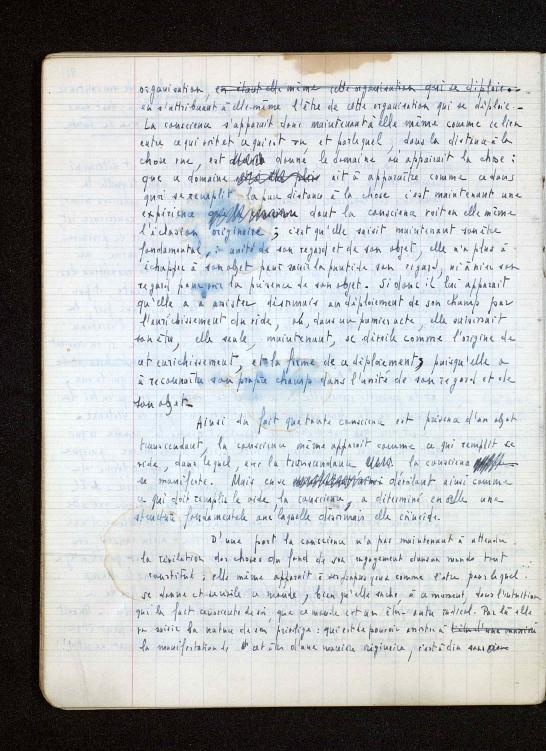 [0068]
organisation en s’attribuant à elle-même l’être de cette
organisation qui se déploie. La conscience s’apparaît donc maintenant à elle-même comme ce
lien entre ce qui voit et ce qui est vu, et par lequel, dans la distance à la chose vue, est donné le
domaine où apparaît la chose : que ce domaine ait à apparaître comme ce dans quoi se remplit
la pure distance à la chose c’est maintenant une expérience dont la conscience voit en elle-
même l’éclosion originaire ; c’est qu’elle saisit maintenant son être fondamental : unité de son
regard et de son objet, elle n’a plus à échapper à son objet pour saisir la pureté de son regard,
ni à nier son regard pour voir la présence de son objet. Si donc il lui apparaît qu’elle a à
assister désormais au déploiement de son champ par l’enrichissement du vide, où, dans un
premier acte, elle saisissait son être, elle seule, maintenant, se dévoile comme l’origine de cet
enrichissement, et la forme de ce déploiement, puisqu’elle a à reconnaître son propre champ
dans l’unité de son regard et de son objet.
[0068]
organisation en s’attribuant à elle-même l’être de cette
organisation qui se déploie. La conscience s’apparaît donc maintenant à elle-même comme ce
lien entre ce qui voit et ce qui est vu, et par lequel, dans la distance à la chose vue, est donné le
domaine où apparaît la chose : que ce domaine ait à apparaître comme ce dans quoi se remplit
la pure distance à la chose c’est maintenant une expérience dont la conscience voit en elle-
même l’éclosion originaire ; c’est qu’elle saisit maintenant son être fondamental : unité de son
regard et de son objet, elle n’a plus à échapper à son objet pour saisir la pureté de son regard,
ni à nier son regard pour voir la présence de son objet. Si donc il lui apparaît qu’elle a à
assister désormais au déploiement de son champ par l’enrichissement du vide, où, dans un
premier acte, elle saisissait son être, elle seule, maintenant, se dévoile comme l’origine de cet
enrichissement, et la forme de ce déploiement, puisqu’elle a à reconnaître son propre champ
dans l’unité de son regard et de son objet.
Ainsi du fait que toute conscience est présence d’un objet transcendant, la conscience même apparaît comme ce qui remplit ce vide, dans lequel, avec la transcendance, la conscience se manifeste. Mais en se dévoilant ainsi comme ce qui doit remplir le vide, la conscience, a déterminé en elle une structure fondamentale avec laquelle désormais elle coïncide.
D’une part la conscience n’a pas maintenant à attendre la révélation des choses du
fond de son engagement dans un monde tout constitué ; elle-même apparaît à ses propres yeux
comme l’être pour lequel se donne et se révèle ce monde, bien qu’elle sache, à ce moment,
dans l’intuition qui la fait consciente de soi, que ce monde est un être-autre radical. Par là elle
va saisir la nature de son privilège, qui est de pouvoir assister à la manifestation de cet être
d’une manière originaire, c'est-à-dire sans
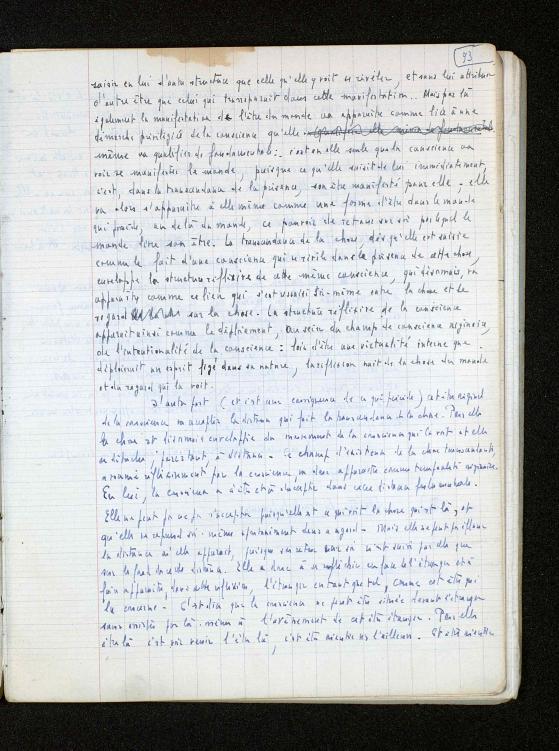 [0069]
saisir en lui d’autre structure que celle qu’elle
y voit se révéler, et sans lui attribuer d’autre être que celui qui transparaît dans cette
manifestation. Mais par là également la manifestation de l’être du monde va apparaître comme
liée à une démarche privilégiée de la conscience qu’elle même va qualifier de fondamentale :
c’est en elle seule que la conscience va voir se manifester le monde, puisque ce qu’elle saisit
de lui immédiatement, c’est, dans la transcendance de la présence, son être manifesté pour
elle ; elle va alors s’apparaître à elle-même comme une forme d’être dans le monde qui
possède, au-delà du monde, ce pouvoir de retour sur soi par lequel le monde livre son être. La
transcendance de la chose, dès qu’elle est saisie comme le fait d’une conscience qui se révèle
dans la présence de cette chose, enveloppe la structure réflexive de cette même conscience,
qui désormais, va apparaître comme ce lien qui s’est ressaisi soi-même entre la chose et le
regard sur la chose. La structure réflexive de la conscience apparaît ainsi comme le
déploiement, au sein du champ de conscience originaire, de l’intentionnalité de la conscience :
loin d’être une virtualité interne que déploierait un esprit figé dans sa nature, la réflexion naît
de la chose du monde et du regard qui la voit.
[0069]
saisir en lui d’autre structure que celle qu’elle
y voit se révéler, et sans lui attribuer d’autre être que celui qui transparaît dans cette
manifestation. Mais par là également la manifestation de l’être du monde va apparaître comme
liée à une démarche privilégiée de la conscience qu’elle même va qualifier de fondamentale :
c’est en elle seule que la conscience va voir se manifester le monde, puisque ce qu’elle saisit
de lui immédiatement, c’est, dans la transcendance de la présence, son être manifesté pour
elle ; elle va alors s’apparaître à elle-même comme une forme d’être dans le monde qui
possède, au-delà du monde, ce pouvoir de retour sur soi par lequel le monde livre son être. La
transcendance de la chose, dès qu’elle est saisie comme le fait d’une conscience qui se révèle
dans la présence de cette chose, enveloppe la structure réflexive de cette même conscience,
qui désormais, va apparaître comme ce lien qui s’est ressaisi soi-même entre la chose et le
regard sur la chose. La structure réflexive de la conscience apparaît ainsi comme le
déploiement, au sein du champ de conscience originaire, de l’intentionnalité de la conscience :
loin d’être une virtualité interne que déploierait un esprit figé dans sa nature, la réflexion naît
de la chose du monde et du regard qui la voit.
D’autre part (et c’est une conséquence de ce qui précède) cet être originel de la
conscience va remplir la distance qui fait la transcendance de la chose. Pour elle la chose est
désormais enveloppée du mouvement de la conscience qui la voit et elle se détache ; pourtant,
à distance. Ce champ d’existence de la chose transcendante, assumé réflexivement par la
conscience, va donc apparaître comme temporalité originaire. En lui, la conscience a à être et
à s’accepter dans cette distance fondamentale. Elle ne peut pas ne pas s’accepter puisqu’elle
est ce qui voit la chose qui est là, et qu’elle se reprend soi-même spontanément dans ce regard.
Mais elle ne peut pas effacer la distance où elle apparaît, puisque son retour sur soi n’est saisi
par elle que sur le fond de cette distance. Elle a donc à se réfléchir en face de l’étranger et à
faire apparaître, dans cette réflexion, l’étranger en tant que tel, comme cet être qui la concerne.
C’est dire que la conscience ne peut être située devant l’étranger sans assister par là même à
l’avènement de cet être étranger. Pour elle être là c’est voir venir l’être là, c’est être orientée
vers l’ailleurs. Et être orientée
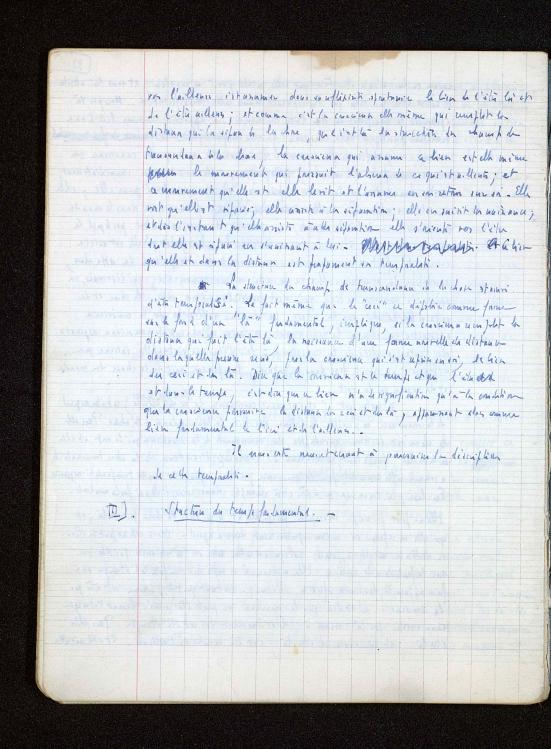 [0070]
vers l’ailleurs c’est assumer dans sa réflexivité spontanée
le lien de l’être-là et de l’être ailleurs ; et comme c’est la conscience elle-même qui remplit la
distance qui la sépare de la chose, que c’est là la structure du champ de transcendance de la
chose, la conscience qui assume ce lien est elle-même le mouvement qui poursuit l’absence de
ce qui est ailleurs ; et ce mouvement qu’elle est, elle le vit et l’assume en son retour sur soi.
Elle voit qu’elle est séparée ; elle assiste à la séparation ; elle en saisit la naissance ; et dès
l’instant qu’elle assiste à cette séparation, elle s’oriente vers l’être dont elle est séparée en
s’unissant à lui. Ce lien qu’elle est dans la distance est proprement sa temporalité.
La structure du champ de transcendance de la chose est ainsi d’être temporalisé. Le fait
même que le “ ceci ” se déploie comme forme sur le fond d’un “ là ” fondamental, implique, si
la conscience remplit la distance qui fait l’être-là, la naissance d’une forme nouvelle de
distance dans laquelle prenne sens, pour la conscience qui s’est reprise en soi, le lien du ceci et
du là. Dire que la conscience est le temps et que l’être est dans le temps, c’est dire que ce lien
n’a de signification qu’à la condition que la conscience poursuive la distance du ceci et du là,
apparaissant alors comme lien fondamental de l’ici et de l’ailleurs.
[0070]
vers l’ailleurs c’est assumer dans sa réflexivité spontanée
le lien de l’être-là et de l’être ailleurs ; et comme c’est la conscience elle-même qui remplit la
distance qui la sépare de la chose, que c’est là la structure du champ de transcendance de la
chose, la conscience qui assume ce lien est elle-même le mouvement qui poursuit l’absence de
ce qui est ailleurs ; et ce mouvement qu’elle est, elle le vit et l’assume en son retour sur soi.
Elle voit qu’elle est séparée ; elle assiste à la séparation ; elle en saisit la naissance ; et dès
l’instant qu’elle assiste à cette séparation, elle s’oriente vers l’être dont elle est séparée en
s’unissant à lui. Ce lien qu’elle est dans la distance est proprement sa temporalité.
La structure du champ de transcendance de la chose est ainsi d’être temporalisé. Le fait
même que le “ ceci ” se déploie comme forme sur le fond d’un “ là ” fondamental, implique, si
la conscience remplit la distance qui fait l’être-là, la naissance d’une forme nouvelle de
distance dans laquelle prenne sens, pour la conscience qui s’est reprise en soi, le lien du ceci et
du là. Dire que la conscience est le temps et que l’être est dans le temps, c’est dire que ce lien
n’a de signification qu’à la condition que la conscience poursuive la distance du ceci et du là,
apparaissant alors comme lien fondamental de l’ici et de l’ailleurs.
Il nous reste maintenant à poursuivre la description de cette temporalité.
III) Structure du temps fondamental 5


